

Université d’Opole
RÉSUMÉ
À travers Les Mandarins, Simone de Beauvoir met en scène la crise qui touche les milieux intellectuels français derrière des personnages d’écrivains aux prises avec les dilemmes idéologiques et politiques de l’après-guerre. Ces personnages, réfléchissant à l’utilité de leurs œuvres, se posent la question fondamentale : « pourquoi / pour quoi écrire et agir ». Dans l’optique beauvoirienne, il y a deux positions : d’une part l’engagement, la nécessité de prendre conscience de la situation, d’agir ; d’autre part l’idée de l’autonomie de la littérature. De cette ambivalence résulteraient la défaite des attentes et des espoirs communs, le conformisme, la polarisation des valeurs ainsi que les échecs sentimentaux. L’histoire des « illusions brisées » de ce milieu permet à l’auteure de rendre compte de l’importance de la morale, de la responsabilité et de la présence d’autrui ainsi que de rejeter le conformisme et la crise des valeurs. La crise des Mandarins s’exprime par leur capacité à révéler le plus intime en l’accordant aux malaises d’une époque pour les transformer en urgences politiques et éthiques.
MOTS-CLÉS — crise, intellectuels, engagement, dilemmes idéologiques, désenchantement, vision pessimiste de la réalité, contradictions
SUMMARY
In the novel The Mandarins, Simone de Beauvoir shows the crisis of French intellectuals, namely writers facing ideological and political dilemmas after World War Two. Reflecting on the usefulness of their works, the main protagonists ask the fundamental question, namely why / for what to write and act. In the writer’s optics, two solutions are possible. On the one hand, the commitment, and the need for being aware of situations and actions. On the other hand, the idea of the autonomy of literature. This opposition seems to cause a failure of common expectations and hopes, conformism, collapse of values as well as love failures. The history of “broken illusions” of a known milieu allows the writer to make us realize the importance of morality, responsibility, and the presence of another human being. The meaning of the crisis in the novel is expressed by exposing what is most intimate, and by ascribing this state of affairs to the ills of the age, which become a political and ethical imperative.
KEYWORDS — crisis, intellectuals, commitment, ideological dilemmas, disappointment, pessimistic vision of reality, contradictions
Œuvre majeure de Simone de Beauvoir, Les Mandarins, le grand roman intellectuel qui a valu à l’auteure le prix Goncourt en 1954, reste indissociable de son contexte historique, l’après-guerre et la montée des tensions aboutissant à la division du monde en deux blocs hégémoniques. S’y trouvent évoqués les enjeux idéologiques et éthiques que découvre une intelligentsia parisienne mal préparée à affronter une réalité où tout se dérobe. Ainsi, l’ouvrage présente « une image assez précise de ce que furent entre 1944 et 1947 la vie, les projets, les soucis, les illusions des “paroissiens” de Saint-Germain-des-Prés »[1], à savoir les désillusions et les contradictions des intellectuels de gauche, leurs relations problématiques avec le parti communiste, leur attitude à l’égard de l’Union Soviétique et de l’Amérique. Beauvoir y dessine « les multiples et tournoyantes significations de ce monde [...] changeant [...] qui n’avait plus cessé de bouger »[2].
Nous chercherons à démontrer que ce texte traduit l’inquiétude beauvoirienne à l’égard du passé, tout autant que sa volonté de saisir les virtualités du présent, entre l’ivresse de la Libération et l’inconnu d’une liberté à venir rêvée avec regret. Ainsi, Les Mandarins se révèlent être le roman de la crise, entendue comme le malaise d’intellectuels tiraillés devant affronter la difficulté de concilier écriture et engagement, les limites de la responsabilité individuelle d’avant-guerre et de la Résistance. Le récit, ambitieux, met en relief la crise, symbolisée par le « cristal noir »[3], qui correspondrait, pour citer Jean-Paul Sartre, à un « mélange amer et ambigu d’absolu et de transitoire »[4], à savoir l’expérience du nihilisme.
La fresque beauvoirienne exprime la prise de conscience de l’histoire et de sa propre authenticité. La chroniqueuse essaie de justifier sa vie et se montre déçue par tout ce qu’elle observe. Ses personnages, qui traversent une période d’angoisse existentielle, incarnent « une morale de l’ambiguïté ». Par leur entremise, Beauvoir suggère que le sens de la vie n’est jamais arrêté une fois pour toutes, qu’atteindre la transcendance n’est pas chose aisée et que cela implique de traverser des épisodes de souffrance. Dans Les Mandarins, à travers les affres d’Anne Dubreuilh, psychanalyste, compagne d’un grand écrivain qui dirige une revue influente, et les élans incertains d’Henri Perron, dramaturge et journaliste, elle décrit la défaite de ce milieu demeurant « sous l’influence conjointe du pacifisme, des courants de pensée d’extrême-droite ou des mouvements de lutte antifasciste »[5], la fin d’une époque[6]. On comprend ainsi que « la réalité n’est pas un être figé ; c’est un devenir, c’est [...] un tournoiement des expériences singulières qui s’enveloppent les unes les autres tout en restant séparées »[7]. De son côté, le mandarin[8], conscient des conséquences des bombardements de Hiroshima et Nagasaki, est mis en demeure de se positionner par rapport aux grands équilibres nouveaux qui vont façonner le monde. Cela ne va pas sans certains embarras de conscience :
Henri ne trouvait pas ça satisfaisant du tout ; il n’aimait pas penser que d’un bout à l’autre de cette affaire il avait été mené en bateau. Il avait eu de grands débats de conscience, des doutes, des enthousiasmes, et d’après Dubreuilh les jeux étaient faits d’avance. Il se demandait souvent qui il était ; et voilà ce qu’on lui répondait : il était un intellectuel français grisé par la victoire de 44 et ramené par les événements à la conscience lucide de son inutilité[9].
Comme document, le roman affronte ici l’histoire et dévoile ses tremblements, faisant obstacle à tout figement idéologique.
Selon le projet de Beauvoir, témoin et historiographe de l’existentialisme, Les Mandarins constituent une chronique d’un passé proche, nettement déterminé : un roman sur les Français des années 40 du XXe siècle, sur leur optimisme à la fin de la guerre et le désenchantement qui a suivi et marque cette période de bouillonnement intellectuel. La chronique des « illusions brisées »[10] se fait inventaire critique du présent par lequel Beauvoir sensibilise aux crises de conscience des intellectuels, « des gens en proie à des espoirs et à des doutes, cherchant à tâtons leur chemin »[11], « espèce à part »[12] forcée de renoncer aux mirages, d’affronter les exigences de la reconstruction et les errements du début des années 1950. Cette exposition du désarroi de l’immédiat après-guerre reflète aussi les inquiétudes du moment, parmi lesquelles la guerre de Corée, l’exacerbation de l’antagonisme entre l’Est et l’Ouest, l’angoisse devant une catastrophe imminente, mise en relief par l’effet de brouillage. La tendance au ressassement confirme ce constat. Beauvoir en propose une interprétation plus optimiste :
J’ai décrit certaines manières de vivre l’après-guerre sans proposer de solution aux problèmes qui inquiètent mes héros. Un des principaux thèmes qui se dégage de mon récit, c’est celui de la répétition, au sens que Kierkegaard donne à ce mot : pour posséder vraiment un bien, il faut l’avoir perdu et retrouvé[13].
Lorsque les communistes accusent Robert de diviser la gauche, ce dernier s’exclame : « Ah ! ils n’ont pas changé, [...] ils ne changeront jamais »[14]. Les Mandarins se heurtent à cette impasse. En témoigne, entre autres, une eschatologie qui se laisse voir dans les premières pages consacrées à la célébration du nouvel an de 1945, promesse de la paix à venir. Mais l’allégresse s’exprime à la forme négative, soulignant la perte des valeurs. Henri dit à un ancien camarade qui multiplie les exécutions sauvages : « Ça vous crève le cœur que l’aventure soit finie, vous faites semblant de la prolonger. Mais bon Dieu ! ce qui comptait : c’était pas l’aventure qui comptait : c’était les trucs qu’on défendait »[15]. Le présent se dissout progressivement, sous l’effet d’un désenchantement corrosif : « Assez fredonné la chanson des lendemains ; demain, c’était devenu aujourd’hui, ça ne chantait plus. Pour de vrai, Paris avait été détruit et tout le monde était mort à la guerre »[16].
Le roman montre les divergences naissantes entre les protagonistes, les brouilles qui surviennent, quand bien même ce ne sont pas les individus qui comptent, mais les idées qu’ils incarnent. Les mandarins s’interrogent : choisir l’écriture ou l’action ? Peut-on être un écrivain engagé sans faire de la littérature de propagande ? Quelle est l’option politique qui aidera le plus efficacement les contemporains ? Existe-t-il une littérature détachée de son temps ? Est-il possible de liquider le poids encombrant du passé dans l’écriture ? Faut-il privilégier la vérité à tout prix ou la sacrifier à une cause finale qui en justifierait les moyens ? Pour Dubreuilh l’essentiel est de se consacrer tout entier à la création d’un mouvement politique :
Nous avons toujours pensé qu’on n’écrit pas pour écrire, dit Robert. À certains moments d’autres formes d’action sont plus urgentes. – Pas pour vous, dis-je [Anne]. Vous êtes d’abord écrivain. – Tu sais bien que non, dit Robert avec reproche. Ce qui compte d’abord pour moi, c’est la révolution. – Oui, dis-je. Mais le meilleur moyen que vous ayez de servir la révolution, c’est d’écrire vos livres[17].
Aussi Henri, dont « [l]es soucis à propos de la guerre, de la paix, de la justice n’étaient pas des fariboles »[18], semble-t-il convaincu que le rôle principal de l’intellectuel est de s’engager[19]. C’est d’autant plus net que « [L]’engagement, somme toute, n’est pas autre chose que la présence totale de l’écrivain à l’écriture »[20]. L’alternance entre périodes d’écriture et de pause caractérise ces intellectuels qui placent l’action au cœur de leurs intérêts, mais aussi la conscience, la question des limites, la responsabilité. Henri, s’interrogeant sur ce qu’il faut dire et taire, demeure persuadé de la nécessité de révéler au grand jour l’impérialisme américain, les menaces de la révolution socialiste. L’intellectuel, perçu comme un propagateur des représentations culturelles et idéologiques au cours de l’« offensive existentialiste »[21], se pose des questions d’ordre ontologique : « Alors que faire ? Céder ? Ne pas céder ? Agir ? Écrire ? »[22]. Aussi Dubreuilh n’est-il pas convaincu de la justesse de ses objectifs et du rôle qui lui revient.
Les Mandarins montrent les hésitations entre des élans vagues et la mélancolie d’un présent en suspens[23] hors d’une histoire fantasmée dont l’épisode final de l’exécution de Sézenac donne la clef, triste parodie d’une épopée obsolète. Anne évoque une vue effrayante : la place de l’Opéra, parée de draperies rouges et empourprée de lumières, y est le lieu d’une épiphanie ambiguë le 14 juillet 1945 : « Rien n’était conclu, le passé ne ressusciterait pas, l’avenir était incertain »[24]. Cette chronique véhicule l’opacité du présent où s’éprouve l’expérience d’une négativité. L’obsession d’un présent insaisissable traduit le fiasco d’un rêve impossible. La fin du roman s’ouvre sur la vague promesse d’un renouveau : Anne renonce au suicide, Henri décide d’affronter le monde dans sa réalité et de poursuivre sa carrière intellectuelle, sans illusion, soucieux de continuer à être soi avec les autres. Dans cette perspective, l’œuvre pourrait témoigner de la nécessité de puiser dans le passé la force d’aller de l’avant. Les Mandarins constituent, en quelque sorte, le roman du deuil des actions collectives et des engagements individuels des intellectuels qui, dans un monde aux valeurs de plus en plus brouillées, aboutissent à la constatation que « l’exaltation de la liberté à reconstruire a un goût amer »[25]. C’est ce qu’ Anne exprime dès les premières pages : « Mais avec ce passé derrière nous, comment se fier encore à l’avenir ? Diego est mort, il y a eu trop de morts, le scandale est revenu sur terre, le mot de bonheur n’a plus de sens : autour de moi c’est de nouveau le chaos. Peut-être que le monde s’en sortira mais quand ? »[26]. Le dilemme consiste à savoir comment se tourner vers le futur et la vie sans trahir le passé ni la mémoire. Il semble que l’écriture permette de surmonter la douleur et d’exorciser la peur du néant.
Indépendamment de l’Histoire, qui occupe une place primordiale dans le roman, Beauvoir attache également une importance particulière aux problèmes sentimentaux. L’un des enjeux consiste ainsi dans la rupture et la réconciliation entre deux amis, Robert Dubreuilh et Henri Perron. Le roman s’attache aussi à un amour malheureux, celui d’Anne Dubreuilh et de Lewis Brogan : « Bien que l’intrigue centrale fût une brisure et un retour d’amitié entre deux hommes, j’attribuais un des rôles privilégiés à une femme, car un grand nombre de choses que je voulais dire étaient liées à ma condition féminine »[27], avance Beauvoir. On lui a souvent reproché d’avoir décrit un microcosme parisien aux figures reconnaissables – Robert (Sartre), Anne (Beauvoir), Henri (Camus), Lewis (Algren) – par le biais d’une chronique romancée. S’agissait-il d’une forme de trahison ? Refusant la condamnation éthique et la disqualification esthétique du recours au modèle[28], l’auteure reconnaissait qu’il y avait dans son texte « des images à la fois déchiffrables et brouillées »[29] et regrettait que le public ait effectivement recherché des clés :
Gallimard organise un gros battage autour, tant mieux car ça me fera du sou, mais tant pis car il laisse croire qu’il s’agit d’un roman à clés ([...] tout ça est absolument faux). Mon projet d’ensemble a été d’évoquer l’état d’esprit général, l’expérience vécue par des écrivains français après la guerre ; j’ai inventé des personnages particuliers qui l’incarnent, c’est très désagréable de penser que les lecteurs considéreront ce livre comme un mot croisé chiffré ou quelque chose dans ce genre[30].
Les Mandarins ne sont pas un texte autobiographique[31], ils constituent une « évocation »[32] de certains éléments de la vie personnelle de Beauvoir. Dans La Force des choses, la romancière admet qu’Anne est inspirée par sa vie, mais précise que c’est « une femme en qui [elle ne se] reconna[ît] pas »[33], et qu’elle incarne des « aspects négatifs »[34] de son existence. Beauvoir, sans narcissisme, s’explique sur cette inscription du vécu le plus intime dans une conférence donnée au Japon en 1966. Selon elle, la pulvérisation du réel permet d’« abolir la pure facticité »[35] de l’univers. « Les vrais malheurs ce n’est pas à moi qu’ils étaient arrivés, et pourtant ils avaient hanté ma vie »[36], constate Anne après la Libération. Ainsi, l’auteure présente le drame de ses personnages : ils sont des survivants, des spectateurs, des acteurs impuissants, lucides et meurtris. Leurs débats politiques suivent une rhétorique claire et tournent autour d’enjeux connus (héritage du passé, solidarité des combattants, responsabilité, exigence de la vérité). Analysé sous cet angle, le roman présente deux positions : d’une part, l’engagement des écrivains ; de l’autre, une idée de l’autonomie de la littérature. Les Mandarins n’ont pas de solution à proposer quant à la dualité entre agir et écrire. Les intellectuels demeurent condamnés à osciller entre ces deux pôles. À la fin du roman, Henri, qui se décide à aller vivre en Italie, doit à nouveau s’engager quand on lui demande, au dernier moment, un article sur l’insurrection malgache :
À Porto Venere comme à Paris, toute la terre serait présente autour de lui avec ses misères, ses crimes, ses injustices. Il pouvait bien user le reste de sa vie à fuir, il ne serait jamais à l’abri. Il lirait les journaux, il écouterait la radio, il recevrait des lettres. Tout ce qu’il gagnerait, c’est qu’il se dirait : « Je n’y peux rien. » Brusquement, quelque chose explosa dans sa poitrine.Non. La solitude qui l’étouffait ce soir, cette muette impuissance, ce n’est pas ça qu’il voulait. Non. Il n’accepterait pas de dire à jamais : « Tout se passe sans moi »[37].
Il va de soi que Beauvoir, travaillée par le désir de se dire, ne se contente pas d’être romancière, philosophe, mais affirme également son identité de femme et d’intellectuelle engagée, qui fait un bilan personnel de sa propre implication au cœur des événements, commandée par une idée-phare, la quête d’autrui, se distinguant par un souci de communiquer et de « servir ». L’écrivaine le mettait elle-même en relief en guise d’introduction au long passage consacré aux Mandarins dans La Force des choses : « Pour parler de moi, il fallait parler de nous, au sens qu’avait eu ce mot en 1944. L’écueil sautait aux yeux : nous étions des intellectuels, une espèce à part, à laquelle on conseille aux romanciers de ne pas se frotter »[38].
Des mandarins s’interrogent sur l’authenticité de leur engagement et, pour cette raison, la capacité à saisir le réel, à expérimenter la liberté au présent, s’avère l’enjeu essentiel du roman : « Nous végétons au hasard d’une histoire qui n’est plus la nôtre »[39], affirme Anne. En réalité, au-delà des questionnements sur sa carrière et sur son comportement, elle se rend compte que tout est vain. Pourtant, le constat du tragique « d’un monde qui a perdu son sens »[40] n’a aucune prise sur son existence. Car « l’Histoire entraîne les personnages à juger la tonalité de leur existence »[41]. Objet de leurs réflexions, de leurs fantasmes, elle offre une image tremblée dans le désarroi des dialogues et l’émiettement des discours intérieurs[42].
En racontant, avec une tendresse indulgente mêlée d’intransigeance cruelle, les dilemmes des mandarins aux prises avec les questionnements idéologiques, Beauvoir met à nu certains aspects de la conscience humaine dans un texte qui se laisse interpréter selon des perspectives diverses. L’auteure écrit à ce propos :
Chose paradoxale, critique de droite comme de gauche, les communistes eux-mêmes l’apprécient. Les premiers y lisent l’histoire d’une défaite, celle de la gauche intellectuelle française ; les derniers celle d’un apprentissage, d’une conversion, celle des intellectuels français qui découvrent la vérité : leur devoir consiste à rallier le Parti communiste. Ni l’une ni l’autre des deux interprétations n’est juste, bien entendu, mais voilà justement pourquoi ce roman me paraît meilleur que mes précédents, on peut en faire différentes lectures, son sens ne crève pas les yeux[43].
Après la consécration, dans un entretien publié dans L’ Humanité dimanche, elle met en relief les exigences de l’engagement politique : « [...] les intellectuels de gauche doivent se tenir aux côtés des communistes et travailler avec eux »[44]. Notons pourtant que son roman est l’amplification d’une désillusion collective : « L’inéluctable transformation de la communauté politique idéale que projettent les intellectuels à la Libération en un espace de malentendus, de rapports agoniques et de contraintes institutionnelles »[45]. Le sens de cette défaite reste ouvert. Le roman est construit sur des structures antagonistes fortes : l’alternance des voix d’Anne et d’Henri, sous deux modalités différentes (journal et récit focalisé), l’opposition entre les intellectuels et les mondains, les anciens résistants et les anciens collaborateurs, les intellectuels de gauche et les communistes, entre la génération du Front populaire et celle de la Libération. Les écrivains prennent la défense des défavorisés tout en étant eux-mêmes des privilégiés. Les dialogues d’opposition et de polémique laissent percevoir une divergence dans le texte entre ambiguïté et maîtrise, ressentie dans une présence diffuse d’une étrangeté menaçante : « Non, ce n’est pas aujourd’hui que je connaîtrai ma mort, ni aujourd’hui, ni aucun jour. Je serai morte pour les autres sans jamais m’être vue mourir »[46], avoue Anne qui, tout ensemble, profite et souffre de cette situation équivoque. Sur le plan idéologique sa liaison avec Henri se révèle une manière de panser la crise : elle suggère également un aspect positif, l’épanouissement libre de l’individu dans sa capacité à s’engager avant la dissipation du mirage :
Ou on sombre dans l’indifférence, ou la terre se repeuple ; je n’ai pas sombré. Puisque mon cœur continue à battre, il faudra bien qu’il batte pour quelque chose, pour quelqu’un. Puisque je ne suis pas sourde, je m’entendrai de nouveau appeler. Qui sait ? Peut-être un jour serai-je de nouveau heureuse. Qui sait ?[47]
Le roman se laisse lire comme superposition brouillée de logiques et de rêveries divergentes. Dans l’optique de Beauvoir, la valeur de son texte consiste dans le dévoilement de la signification métaphysique des événements et de l’attitude à adopter face à la vie : « À travers chacun d’eux, l’homme est toujours engagé tout entier, dans le monde entier »[48]. Le fil sentimental semble aussi riche d’enseignements que le fil politique, qui confirme le fait que les valeurs morales changent selon les circonstances :
La question, affirmait Dubreuilh, c’est de décider parmi les choses qui existent celles qu’on préfère. Il ne s’agit pas de résignation : on se résigne quand entre deux choses réelles, on accepte celle qui vaut le moins ; mais au-dessus de l’humanité telle qu’elle est, il n’y a rien. Oui, sur certains plans Henri était d’accord. Préférer le vide au plein, c’est ce qu’il avait reproché à Paule : elle se cramponnait à de vieux mythes au lieu de le prendre tel qu’il était. Inversement, il n’avait jamais cherché en Nadine « la femme idéale » ; il avait choisi de vivre avec elle en connaissant ses défauts [...]. On n’écrit jamais les livres qu’on veut et on peut s’amuser à regarder tout chef-d’œuvre comme un échec ; pourtant nous ne rêvons pas d’un art supraterrestre : les œuvres que nous préférons, c’est d’un amour absolu que nous les aimons. Sur le plan politique, Henri se sentait moins convaincu : parce que là le mal intervient ; il n’est pas seulement un moindre bien : il est l’absolu du malheur, de la mort. [...] il ne suffit pas de se dire : « De toute façon l’histoire est malheureuse », pour se sentir autorisé à s’en laver les mains [...][49].
Étant donné cet état de choses, on pourrait se demander, à propos des personnages : « [q]ue vont-ils faire de ce passé si lourd, si court, et de leur avenir informe ? »[50]. Ceux qui croyaient retrouver leur vie d’avant-guerre doivent affronter de nombreuses désillusions afin d’accepter la réalité. Plongés dans un présent plein d’angoisse, celui d’une génération désabusée, repliée sur un nombrilisme exacerbé, les mandarins incarnent « la lutte des personnages contre l’amenuisement des espoirs suscités par la Libération, et leur aveuglement sur les raisons de cet échec politique et intellectuel »[51]. En même temps, ils restent profondément persuadés du sens de ce qu’ils font et de la valeur de la littérature autonome, véhicule des véritables enjeux de l’échange d’idées : « Ce qu’il [Henri] réussissait à couler dans des mots lui semblait sauvé, absolument »[52].
En mettant en relief les dilemmes et cas de conscience d’Anne, d’Henri et de leurs proches, le récit beauvoirien, récit d’échecs politiques et sentimentaux, semble imposer une vision pessimiste de la réalité. La lecture des Mandarins prouve « l’abdication de l’individu. [...]. [Les personnages] se servent des idées politiques pour se faire du mal et lutter les uns contre les autres [...] »[53]. La crise résulte de l’ambivalence singulière qui réside dans cette tension entre désir de fuite et tentation de la compromission, du fait de la polarisation frappante des valeurs, des rôles et des symboles. L’omniprésence du passé renforce l’impression de vanité et une insatisfaction chronique. Cette perte de sens implique finalement une remise en question de ce qu’on considère généralement comme normal.
Ainsi, l’auteure réussit parfaitement à montrer l’échec d’un projet de société auquel ont abouti les tentatives des intellectuels d’alors pour maintenir le dialogue idéologique, entre absolu et relatif, « le dialogue entre les forces de gauche indépendantes et le parti communiste »[54]. Une telle problématique reste universelle car elle véhicule aussi la crise politique que traversent les pays occidentaux aussi bien dans les années 40 du XXe siècle qu’aujourd’hui[55] : l’échec des partis et les impasses des démocraties, liés à ces maux endémiques que sont la difficulté à mener une entreprise collective, à consolider la communauté.
Baty-Delalande, Hélène, « Cristal noir. Fausses évidences des Mandarins », in Cahiers de L’Herne. Simone de Beauvoir, éd. E. Lecarme-Tabone, J.-L. Jeannelle, Paris, L’Herne, 2012, p. 160-165
Beauvoir, Simone, de, L’Existentialisme et la sagesse des nations, Paris, Gallimard, 2008
Beauvoir, Simone, de, La Force des choses, Paris, Gallimard, 1963
Beauvoir, Simone, de, Lettres à Nelson Algren. Un amour transatlantique. 1947-1964, Paris, Gallimard, 1997
Beauvoir, Simone, de, Les Mandarins, t. 1 et 2, Paris, Gallimard, 1954
Beauvoir, Simone, de, in Que peut la littérature ?, éd. Y. Buin, Meaux, Union Générale d’Éditions, 1965, p. 73-92
Beauvoir, Simone, de, « Mon expérience d’écrivain », conférence prononcée au Japon, septembre-octobre 1966, in Les Écrits de Simone de Beauvoir. La vie – L’écriture, éd. C. Francis, F. Gontier, Paris, Gallimard, 1979, p. 439-457
Dugast-Portes, Francine, « Le récit dans Les Mandarins : les multiples et tournoyantes significations de ce monde », Roman 20-50, juin 1992, n° 13, p. 65-83
Gagnon, Carolle, « L’intentionnalité dans Les Mandarins : La mise en récit de la double énigme d’un monde qui a perdu son sens et de l’existence même de ce monde comme constitution de la conscience d’Anne Dubreuilh, survivante », in Simone de Beauvoir cent ans après sa naissance, éd. Th. Stauder, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2008, p. 309-319
Holland, Alison, « La voix chancelante dans le monologue intérieur de Anne dans Les Mandarins », in (Re)découvrir l’œuvre de Simone de Beauvoir. Du Deuxième Sexe à La Cérémonie des adieux, éd. J. Kristeva, P. Fautrier, P.-L. Fort et A. Strasser, Lormont, Le Bord de l’eau, 2008, p. 392-396
Jeannelle, Jean-Louis, « Les Mandarins de Simone de Beauvoir ou la crise du dialogue des intellectuels », in Le Débat d’idées dans le roman français, éd. G. Artigas-Menant et A. Couprie, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2010, p. 103-132
Julienne-Caffié, Serge, Simone de Beauvoir, Paris, Gallimard, 1966
Kadoglou, Triantafyllia, « Les Mandarins : un témoignage sociopolitique de signification universelle », in (Re)découvrir l’œuvre de Simone de Beauvoir. Du Deuxième Sexe à La Cérémonie des adieux, éd. J. Kristeva, P. Fautrier, P.-L. Fort, A. Strasser, Paris, Le Bord de l’eau, 2008, p. 370-379
Larsson, Björn, La Réception des « Mandarins », Le roman de Simone de Beauvoir face à la critique littéraire en France, Lund, Lund University Press, 1988
Le Robert des grands écrivains de langue française, éd. Ph. Hamon et D. Roger-Vasselin, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2000
Olmeta-Seigner, Muriel, « Les Mandarins ou le triomphe romanesque de l’écriture mélancolique », Simone de Beauvoir Studies, 2005-2006, vol. 22, p. 25-37, https://doi.org/10.1163/25897616-02201006
Renard, Paul, « Des Mandarins aux Samouraïs, ou de l’engagement existentialiste à l’individualisme post-moderne », Roman 20-50, juin 1992, n° 13, p. 111-124
Sartre, Jean-Paul, Situations II, Paris, Gallimard, 1948
Tegyey, Gabriella, « Anne, scripteur des Mandarins », in Gabriella Tegyey, Treize récits de femmes (1917-1997) de Colette à Cixous. Voix multiples, voix croisées, Paris, Harmattan, 2009, p. 41-80

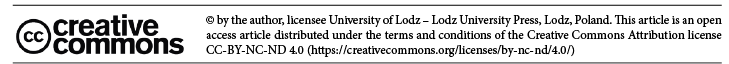
Received: 2021-09-16; Revised: 2022-02-28; Accepted: 2022‑03‑16.