

Université de Łódź
RÉSUMÉ
La Maison d’os de Rolland Dubillard se situe explicitement dans le sillage de la « dramaturgie rhapsodique » qui remet en cause les contraintes de la forme canonique que Szondi a définie comme le « drame absolu ». N’étant pas fondée sur un grand conflit, la construction de l’œuvre ne respecte pas la dynamique de l’action (au demeurant, inexistante), tout en se concentrant sur la confrontation d’un protagoniste avec lui-même. Ainsi, l’intersubjectif, sur lequel est bâtie une pièce traditionnelle, cède la place à l’intrasubjectif qui se manifeste, en l’occurrence, au travers d’un monodrame polyphonique. De fait, en étudiant le texte de Dubillard, on constate que l’auteur renonce à l’ancien paradigme pour mieux explorer l’intériorité du personnage principal. Celui-ci mène une vie de solitaire, entouré par ses nombreux valets qui semblent les pâles reflets de son âme déchirée. S’affranchissant du monologue, l’écrivain conçoit de cette manière un monodrame à plusieurs voix. Ce procédé ne signifie pourtant pas la crise du genre, il constitue une des solutions permettant son évolution.
MOTS-CLÉS — Roland Dubillard, « drame absolu », crise du théâtre, « dramaturgie rhapsodique », « monodrame polyphonique »
SUMMARY
Rolland Dubillard’s House of Bones is openly situated in the wake of “rhapsodic dramaturgy” which challenges the constraints of the canonical form that Szondi has defined as “absolute drama”. Not being based on a great conflict, the construction of the work does not respect the dynamics of the action (incidentally, non-existent), while focusing on the confrontation of a protagonist with oneself. Thus, the intersubjective, on which a traditional play is built, gives way to the extrasubjective which manifests itself, in this case, through a polyphonic monodrama. In fact, by studying Dubillard’s text, we see that the French author renounces the old paradigm in order to explore better the interiority of the main character. He leads a solitary life, surrounded by his many servants who seem to be the pale reflections of his torn soul. Freeing himself from the monologue, the writer conceives in this way a monodrama with several voices. This process does not, however, signify the crisis of the genre, because it constitutes one of the solutions allowing its evolution.
KEYWORDS — Roland Dubillard, “absolute drama”, crisis of the theater, “rhapsodic dramaturgy”, “polyphonic drama”
La mort de l’Autre : une double mort, car
l’Autre est déjà la mort et pèse sur moi
comme l’obsession de la mort[1].
Après la première de La Maison d’os de Roland Dubillard, mise en scène par Arlette Reinerg dans les arènes du Théâtre de Lutèce (1962)[2], Jean-Jacques Gautier ne cache pas son indignation en criant à la « dégénérescence de l’art dramatique »[3] tandis que Gilles Sandier, au contraire, salue cette œuvre comme un exemple indéniable de la « régénérescence de l’art dramatique »[4]. Ces voix discordantes renvoient aux discussions animées sur la prétendue « crise » que la littérature dramatique traverserait de temps à autre, la dernière en date se situant au tournant du XXe siècle. Peter Szondi proclamait ainsi la mise en crise du drame à partir des années 1880, tout en prévoyant, conformément à son esprit téléologique, le sauvetage du drame par un théâtre épique. Theodor W. Adorno ou Hans-Thies Lehmann allaient plus loin en prononçant nettement la mort du drame. Contrairement à Szondi, au lieu d’évoquer une « crise », Jean-Pierre Sarrazac préfère parler de rupture avec le « drame absolu » bâti sur des règles strictes, permettant ainsi l’instauration d’une forme plus ouverte, plus rhapsodique de ce qu’il va appeler : « drame-de-la-vie ». Il n’est donc pas question de la « mort du drame », car celui-ci, dans les crises qu’il subit, continue de se réinventer, en oscillant continuellement « entre contenus nouveaux et formes anciennes »[5].
Il serait alors intéressant de relire La Maison d’os (1966) de Dubillard à travers ce nouveau paradigme qui ne signifie point le dépassement de la forme dramatique, encore moins sa négation, mais son débordement. En y regardant de plus près, on y découvre, en dehors de l’ébranlement de la structure traditionnelle de la pièce, le champ de l’intrasubjectivité qui explore l’intériorité par le biais du monodrame[6] polyphonique. Le dramaturge tente ainsi de privilégier les « micro-conflits internes » aux dépens de l’affrontement intersubjectif, un procédé identifié comme un signe de crise générique. Néanmoins, tournant le dos aux contraintes hégélo-aristotéliciennes, l’écrivain ne remet pas en cause le drame, mais sa forme canonique, tout en s’inscrivant dans « “une poétique du mouvant” qui sied à un art vivant »[7].
Connu pour son humour noir imprégné d’accents venus du théâtre de l’absurde, Dubillard nous introduit dans un univers aussi instable que cocasse. Cependant, contrairement à ses multiples pièces, ici, malgré la présence de son esprit railleur, la tonalité tragique semble l’emporter sur le comique. Qui plus est, l’auteur précise même que, dans ce drame, il donne libre cours à son imagination débridée, tout en renonçant aux prescriptions de la forme traditionnelle que l’on peut encore trouver par exemple dans ses Naïves Hirondelles (1960). C’est d’ailleurs l’un des personnages du drame qui semble confirmer l’approche de l’auteur en la matière en constatant : « mieux vaut parler comme on veut que comme il faut. Ou alors, je vais me taire »[8].
La fable de la pièce, qui se compose de 81 séquences de courte durée, relate l’agonie d’un Maître entouré par une quarantaine de domestiques, les incidents se déroulant exclusivement dans l’intérieur d’une maison vétuste. Ayant pris conscience de sa fin prochaine, le vieillard tente une dernière fois de saisir son for intérieur, donc son moi. Pourtant, dans son chemin de croix version modernisée, il finit par se heurter à un vide ontologique. Les nombreux serviteurs, qui émergent de l’ombre pour aussitôt disparaître dans le néant, se montrent pour le plus grand nombre d’entre eux dévoués à leur patron non sans lui réserver de temps à autre des mots critiques. En récriminant contre les caprices tyranniques du vieil homme, ils semblent personnifier une domesticité anonyme assujettie aux extravagances de leur oppresseur. La majorité des valets sont tout simplement désignés par V-1, V-2, V-3… tandis que les laquais supérieurs (placés plus haut dans la hiérarchie des domestiques) sont signalés par leur fonction : Le Prêtre, le Médecin, le Réformiste, et ainsi de suite.
La Maison d’os est résolument dépourvue d’action au sens classique du terme. Au lieu d’une dynamique dramatique menant à un dénouement final, le dramaturge propose de brefs « sketchs », où nous assistons à des scènes, sans aucun lien logique entre elles, au cours desquelles les personnages expriment leurs détresses aussi triviales qu’existentielles, le loufoque s’entrelaçant toujours avec le « métaphysique ». En effet, à part les jérémiades des subalternes et celles de leur patron, rien ne se passe si ce n’est l’attente quelque peu ennuyeuse du dernier souffle du chef. On pourrait subodorer dans ces scènes, qui se succèdent dans un ordre que l’écrivain n’impose point au metteur en scène, une illustration patente d’une mise en crise de l’art dramatique. Toutefois, Dubillard crée une impression de désordre superficiel en subordonnant tous les épisodes épars de sa pièce à un seul motif : la mort du protagoniste. Dans un entretien de Claude Sarraute avec Dubillard, ce dernier explique que dans son œuvre il n’est point question de sa propre mort, mais de :
celle des autres, celle de quelqu’un, en particulier, que j’ai perdu. Sa mort à soi, ce n’est pas grave du tout, ça ne veut rien dire : la mort, ça n’existe pas. Ce qui est embêtant, c’est qu’il y ait des gens qui meurent auxquels on tient et qui vous laissent dans l’abandon. C’est une pièce sur l’abandon de la mort[9].
En dépit des avertissements de l’auteur, lors de la mise en scène faite par Anne-Laure Liégeois au Théâtre du Rond-Point (2013), Jean-Jacques Birgé constate que dans le drame de Dubillard « il s’agit avant tout d’une pièce sur les rapports de classe d’un vieil homme à la porte de la mort et de ses serviteurs aussi dévoués que critiques. L’humour grinçant fait passer leur relation sordide composée d’un savant cocktail de déférence et d’insolence que seule la promiscuité autorise »[10]. Pourtant, les questions sociales semblent moins préoccuper le dramaturge qui, au détriment d’une fable dramatique ponctuée par des retournements de fortune (drame agonistique), se concentre sur les derniers moments de la vie du protagoniste agonisant (drame ontologique). De fait, comme le remarque à juste titre Sylviane Bernard-Gresh, cette pièce « métaphysique et poétique, parle du temps et de la mort dans une langue qui, embrouillant tout, ouvre des portes sur l’inconnu »[11].
Pour illustrer la « présence-absence d’un être-là pétrifié »[12] face à un destin inéluctable, Dubillard choisit délibérément un personnage sans qualité qui, en perte d’identité, semble s’éparpiller en plusieurs hypostases incarnées par nombre de ses serviteurs. Ce passage au neutre du protagoniste permet au dramaturge d’explorer son intériorité qui se révèle de bout en bout par le monodrame à plusieurs voix. Dans ce contexte, il serait judicieux de se rappeler les observations de Michel Corvin qui attire notre attention sur le fait que tous les personnages de Dubillard reflètent les différentes instances psychiques du dramaturge, car ils « se ressemblent étrangement et conjuguent leurs traits pour composer la silhouette d’un être en état permanent d’absence »[13]. La même relation semble aussi s’instaurer entre le protagoniste et des comparses-satellites qui gravitent autour de lui.
Dans les carnets, qui constituent le manuscrit original de La Maison d’os, à la date du janvier 1959, le dramaturge tâche de rendre compte du schéma dramatique qu’il désire réaliser dans son œuvre :
Le sujet, c’est : le bonheur de se faire servir ; d’arriver finalement à ce que les autres fassent tout à votre place ; vous assument jusqu’aux fonctions les plus intimement physiologiques : vous auriez un domestique pour digérer, comme pour penser. À la limite, vous ne seriez plus qu’un mannequin. Vous seriez mort, et vos domestiques vous maintiendraient en vie malgré vous.
Cela impliquerait une curieuse enfance. Tout le pouvoir à vos parents, pas un désir en vous que les leurs. Vous auriez été dans votre enfance totalement domestiqué. Vos parents seraient morts quand même, et vous continueriez quelque temps à vivre leur vie. Vos domestiques vivraient pour vous comme vous viviez pour vos parents. La vie ne serait plus à personne : ni à vos parents qui vous l’ont donnée, ni à vous qui la leur rendiez, ni à vos domestiques qui ne rêvent que de vous. La vie n’est qu’un héritage qui passe par-dessus la tête de trois générations[14].
Et plus loin d’ajouter : « vos domestiques se distribueraient les rôles que vous étiez seul à jouer autrefois dans la vie de vos parents »[15]. Cette remarque suggère le statut particulier de ces personnages privés de traits individuels qui incarneraient, comme le note l’auteur, « la noblesse d’un parasitisme sous toutes ses formes »[16] d’un enfant ingrat face à ses protoplastes. Tel un gamin vivant aux crochets de ses parents, les valets n’existent que pour leur Maître tout comme celui-ci ne vit qu’à travers ceux qui le « soutiennent » en vie. Une autre observation que le dramaturge fait dans ses carnets à la date du 28 novembre 1959 mérite notre attention. En réfléchissant sur comment interpréter le rôle de ce vieil homme mourant, l’écrivain préconise ceci : « tout au long de la pièce, penser et faire penser au petit garçon qu’il a été, ce vieillard, et qui grandissait presque aussi vite, au même rythme que le vieillard accède à l’âge du calvaire »[17].
Ne remettant pas en cause l’axe social de la pièce qui prend en compte le conflit entre le patron et ses employés, il est légitime, surtout à la lumière des mots de l’écrivain cités ci-dessus, de mettre en exergue dans ce texte une dimension intimiste qui se centre primordialement sur le personnage principal et son ultime calvaire. De fait, en constatant l’absence d’action dans l’acception traditionnelle du mot, le dramaturge tourne le dos au conflit interpersonnel pour privilégier l’expression de l’affrontement intrapersonnel : l’homme agonisant qui se débat avec lui-même face à l’inexorable. C’est dire qu’en renonçant à un enchaînement logique des épisodes conduisant vers la catastrophe, que plusieurs[18] qualifient de crise, le dramaturge ne rejette pas en soi le concept d’action, mais il lui préfère l’examen des « actions internes » qui se déroulent au niveau même du psychisme du protagoniste. Dans cette perspective, la pièce peut être considérée comme un monodrame polyphonique où la véritable action se passe dans l’âme d’un mourant. Au centre, se trouve notre protagoniste moribond, entouré de serviteurs qui semblent sortis de son cerveau. Dubillard ne puise pas dans la tradition symboliste d’un Saint-Pol Roux ou d’une Rachilde qui, tout en se concentrant sur le moi atomisé, ne se limitent qu’à l’évocation allégoriques des comparses, instances psychiques du protagoniste. L’auteur de La Maison d’os va au-delà des symboles, ou mieux, il y recourt cum grano salis à la façon des expressionnistes. De fait, afin de mettre en avant la dimension intime de la pièce, tous les éléments cristallisés sur scène sont des signes qui visent le personnage principal comme les fruits de son âme en détresse. Qui plus est, tous les éléments, y compris le langage, renforcent la métaphore de la décomposition tant de la maison que du vieux maître[19]. C’est dire que tout ce à quoi nous assistons est présenté par le biais du propriétaire de la maison, cette maison en déliquescence incarnant son propre corps.
On pourrait objecter que l’évocation du monodrame à propos de cette pièce est une hypothèse quelque peu douteuse sinon hasardeuse, puisque plusieurs personnages interviennent dans les scènes pendant lesquelles le Maître est absent[20]. Seulement, tous les habitants de la maison ne parlent que de lui et s’ils se permettent d’exposer leurs désarrois personnels, ils finissent toujours par faire allusion à leur patron. De plus, quand ils se prononcent sur le vieillard qu’ils considèrent comme peu sympathique, ils s’expriment à travers des paroles qui semblent dictées par leur patron. En analysant de près leur langue, on s’aperçoit qu’elle est presque identique à celle du Maître. Mêmes observations, mêmes boutades, comme si elles étaient copiées d’après le discours du protagoniste. Il suffit de comparer les répliques véhémentes du patron à celles débitées par ses subalternes pour se rendre compte de l’analogie évidente entre elles, non seulement sur le plan stylistique, mais aussi en ce qui concerne leur contenu. Tout porte à croire que les domestiques existent uniquement dans la tête du vieillard à l’agonie. Ils reflètent aussi l’atomisation du protagoniste qui s’éparpille tant mentalement que physiquement. Pourtant, les valets existent bel et bien physiquement, mais leur présence permet au personnage principal de vouloir saisir son propre moi, comme l’explique pertinemment Michel Corvin en affirmant : « pour se penser pensant, il faut se voir comme les autres vous voient »[21].
Et ces autres lui réservent des mots parfois cruels. De ce tohu-bohu émergent les réflexions du vieil homme en quête de l’essence de sa vie. Tout en essayant de s’imaginer un monde après sa disparition, ses réflexions achoppent sur un vide aussi affligeant que dérisoire, comme si Dubillard désirait « reconnaître dans la parole l’aptitude à rendre les choses absentes, à les susciter en cette absence »[22]. C’est pourquoi la parole proliférante semble se déployer dans la pièce sans aucun contrôle, mais, malgré cette dispersion chaotique des voix confuses, la pièce de Dubillard se manifeste comme tout à fait cohérente. De fait, sur cette confusion superficielle règne le moi du protagoniste qui voit défiler devant lui les domestiques qui ne cachent pas leur indignation à son encontre : « seule la psyché, en son apparente étroitesse, peut rivaliser avec l’étendue sans limites du monde, le moi absorbe le cosmos – dont il réduit le mouvement à sa propre immobilité – et retrouve le visible en invisible »[23].
Dans ce contexte, il n’est donc pas étonnant d’observer que les comparses qui entourent le Maître ne rappellent point des créatures individuées. Qui plus est, tout comme leur patron, ils s’effacent tout en se morcelant. On est témoin du « nouveau personnage qui a abdiqué son ancienne unité organique » pour devenir « un personnage couturé, un personnage rhapsodé »[24], une sorte de porte-drapeau de la crise de la forme dramatique. Les domestiques sont non seulement dépourvus de traits particuliers, mais ils semblent ne pas exister du tout. Myriam constate sur un ton résigné : « Je n’ai été qu’un gros besoin qu’il a eu. […] pour m’effacer. Pour n’avoir plus besoin en moi. Pour avoir tous mes besoins dehors. Pour avoir toute ma vie hors de moi » (MO, 58). Un des nombreux Valets déclare impassiblement : « j’étais faible, oui, sans courage devant la vie ; […] c’était lui l’homme, moi je n’étais qu’un enfant ; j’ai même été jusqu’à dire : une femme » (MO, 109) et, plus loin, de proférer dans un monologue de confession : « je serais serviteur de Moi si j’existais, mais je n’existe pas. Je suis totalement à mon employeur, je lui appartiens comme lui appartiennent ses parties, je suis son instrument » (MO, 110). Un autre Valet observe la déchirure de sa personnalité, la même que ressent douloureusement le vieillard mourant : « j’en ai assez. Je sais bien que je suis deux. Je ne suis pas là, comme un… je suis là. Je suis là, isolé » (MO, 131).
Qu’on assiste à l’expression du solipsisme du Maître, c’est ce dont témoigne également la maison à laquelle celui-ci s’identifie ouvertement : elle incarne, à l’extérieur, son corps et, à l’intérieur, ses organes internes. Elle représente aussi le protagoniste au niveau psychologique. De fait, la maison est divisée entre la partie supérieure où siège le patron et qui semble symboliser son sur-moi, tandis que les caves incarneraient son subconscient. C’est aussi le trou où on jette des cadavres. C’est là-bas que les domestiques butent sur des morts et des créatures mystérieuses qui semblent refléter les désirs refoulés du vieillard. Qui plus est, la maison vit de même que les comparses qui s’y démènent grotesquement. L’auteur va lui donner parfois des traits animés comme dans la scène XXVI, tout entière muette, où une simple didascalie nous indique ce qui se passe sur les tréteaux : « un de ces moments, très courts, d’une fatigue extrême. La maison, saisie par le sommeil, comme un poisson vivant par l’huile chaude » (MO, 53). Preuves à l’appui, on pourrait répertorier quelques remarques des habitants sur la maison dont les descriptions insolites de son intérieur semblent confirmer qu’elle mène une existence mystérieuse :
Les fenêtres. Comme des braguettes arrangées pour rester indéfiniment ouvertes. Les fenêtres semblent laissées là par négligence ; ce sont des oublis dans la forte mémoire des murs ; des oublis que le temps consacra, consacre, des oublis consacrés. Les persiennes qu’on ferme endorment les fenêtres, endorment rien, endorment la lacune. La veuve patiente (MO, 65).
De temps à autre, les domestiques s’efforcent de cerner le fonctionnement interne de la maison, mais tout en scrutant les entrailles de la demeure, ils semblent rendre compte du fonctionnement défectueux des organes du vieux monsieur. Exprimant son mécontentement face aux plombs qui sautent, un Valet constate « l’eau qui vous gicle à la figure. Oh ! – c’est pas de tout repos. Le temps que je passe à essayer de la comprendre, cette pompe ! » (MO, 149) Dans cette perspective, la dégradation de l’équipement sanitaire tout comme celle des étages qui risquent de s’ébouler évoque non moins la décrépitude du corps du vieillard voué à un morcellement inexorable :
Tous ces murs qui s’écroulent, ça m’est bien égal. Des ongles. Des ongles aux murs, qui poussent, voilà. Ça m’est égal, vos ongles, mes murs et ma peau, je vous la jette aux librairies des fauves, tous ses ongles dehors ! la garce ! déshabillé ! tout nu ! Alfred ! retirez-moi ma peau ! … jusqu’à l’os (MO, 69).
Nous assistons ainsi à la déchéance du corps du Maître. Sa désintégration ne se manifeste pas seulement à travers l’état déplorable de la maison qui est sur le point de s’engloutir dans une fosse comme cela arrive dans les pièces d’Eugène Ionesco, mais se fait voir par la réification des personnages ressemblant de plus en plus étrangement à des objets inanimés, tel le nez de l’abbé qui rappelle une poire, « une poire qui tâcherait de ressembler à une horrible bitte » (MO, 105). Quelquefois, on est témoins de la décomposition du protagoniste dont les membres sont ramassés par les hommes de service. Ainsi, le Valet 2 tient dans ses mains le fémur du vieillard mourant tout en grognant contre celui-ci : « Monsieur ne le portera plus. Il a besoin d’être porté, le fémur à Monsieur. Et c’est pourquoi. Dans le trou aux ordures. Quelle autre place pour un fémur. Le fémur de Monsieur a sa place parmi les arêtes de nos derniers brochets. Cuisine » (MO, 138).
André Green constate que le nom de Dubillard figure parmi les modernistes qui n’hésitent pas à révéler sur scène l’inconscient[25]. Cette approche explique pourquoi le dramaturge crée deux espaces dans cette pièce : l’espace du monde (externe) et l’espace subjectif (interne) qui se rencontrent inévitablement à travers l’espace psychique du protagoniste (et celui de l’auteur). De fait, en dépit de la présence de nombreux comparses, le Maître devient « le protagoniste d’un drame intérieur des paradoxes en tant qu’habitant des territoires flous entre le dedans et le dehors dans son existence corporelle »[26]. C’est ainsi que dans la scène XIII, le vieillard s’exclame : « ma maison. Je veux qu’on me donne ma maison. Je ne l’ai pas. Je suis dedans. Le dehors, encore, il nous en reste une idée cohérente. Mais le dedans, c’est l’incohérence même » (MO, 28). Et notre vieillard de rechercher ce qui se dissimule à l’intérieur de la maison-corps, donc, à l’intérieur de lui-même, mais bientôt, en conversant avec le Valet Chose, celui-ci détruit en lui tout espoir en déclarant que derrière le masque (l’extérieur) il n’y a rien. Comme il ne reste que « du vide masqué »[27], le domestique conclut : « Monsieur devrait avoir besoin de mourir » (MO, 127).
Dans la pièce « le dedans c’est le moi enfermé dans son corps et muré dans son silence organique ; le dehors c’est la tentative faite pour entrer, par les mots, dans cette maison »[28]. Mais il y a un problème qui semble insurmontable, car, comme Le Valet répond aux questions pressantes de son maître : « le dedans d’une chose sitôt qu’on y entre, on ne peut pas, Monsieur, regarder cette chose du dehors » (MO, 28). Cette scène résume d’une certaine manière le sens principal de la pièce qui témoigne de la vision scénique émanant de l’âme du protagoniste mourant. De fait, comme le remarque à juste titre Robin Wilkinson, le Maître règne sans partage tantôt en appelant, tantôt en congédiant les domestiques – « le lieu de parole lui appartient tout autant que l’édifice : c’est lui qui nomme, qui dicte, qui ordonne »[29]. Ainsi, l’espace du drame devient par excellence un espace subjectif que nous ne pouvons percevoir qu’à travers les yeux du personnage principal. Au demeurant, le protagoniste déclare à propos de ses valets : « ils n’existent pas du tout. Plus j’y pense, plus y a que moi. Qui existe » (MO, 26). Dès lors, on est face à un monodrame dont la forme « a ouvert la voie à des dramaturgies fondées sur la systématisation du point de vue tournant à l’intérieur de l’œuvre »[30]. Dubillard semble bâtir son texte sur une multitude de voix qui concourent à un monologue dialogué. On y retrouve une approche similaire avec les postulats de Nicolas Evreinov qui, comme l’auteur français, était aussi un praticien du théâtre. Celui-ci déclare : « Ma conception du monodrame doit désigner un type de représentation dramatique dans lequel le monde qui entoure le personnage apparaît tel que le perçoit le personnage à tout moment de son existence scénique »[31]. Les conceptions d’Evreinov semblent rejoindre celles de Dubillard puisque dans la pièce de ce dernier, on se trouve devant une instance psychique paradoxale qui « conceptualise la polyphonie » et qui « finit par prendre consistance et dont l’identité s’impose à travers le défilé profus des intervenants ponctuels »[32].
L’originalité de La Maison d’os de Dubillard provient sans conteste d’« une maîtrise accrue de ses moyens, [d’]une liberté d’invention qui ne s’embarrasse d’aucune contrainte »[33]. La structure même du drame, où les scènes ne se suivent pas selon une continuité logique, rend compte de la mise à mal de la forme canonique. Mais, en 1962, après le succès incontestable du théâtre de l’absurde, cette écriture ne semble pas novatrice. L’enjeu de la pièce ne réside pourtant pas dans son originalité formelle. Cette écriture se loge dans la mise en forme d’un nouveau paradigme dramatique qui n’arrête pas de se questionner et, en conséquence, de se réinventer. Jean-Luc Dejean a raison de constater que Dubillard « nous introduit dans le drame de l’absence ou de la vie qui s’interroge dans l’antichambre de la mort »[34]. L’écrivain choisit le registre de l’intime qui prend naissance dans l’inconscient du personnage. En accord avec ce registre, le vieillard, assujetti à ses propres pulsions et phobies, ne peut pas agir au sens traditionnel du terme et, dès lors, sombre dans son monde interne. Les comparses qu’il croise de temps à autre ou qu’il ne rencontre jamais semblent refléter la conscience du mourant. De fait, le décor de la pièce se limitant strictement à l’intérieur de la maison, où se meuvent grotesquement les valets, incarne l’intérieur du protagoniste. C’est dans ce contexte que le monodrame polyphonique semble s’imposer comme une piste majeure d’interprétation de ce texte insolite. On pourrait constater que le drame de Dubillard s’inscrit dans le paradigme du « drame-de-la-vie » puisqu’il se concentre non point sur l’intrigue, qui au demeurant n’existe pas, mais sur l’itinérance intérieure du protagoniste qui le conduit inexorablement vers le néant.
Quoi qu’il en soit, la prétendue crise de la forme traditionnelle du drame que l’on décèle sans conteste dans cette œuvre ne signifie pas la mort de celui-ci, car elle ne remet pas en question le genre en soi, mais ses contraintes canoniques qui empêchent sa réinvention et donc sa survie. Dans ce contexte, la crise, affublée communément de connotations négatives, devrait être perçue plutôt comme un phénomène tout à fait naturel, positif et nécessaire pour garantir le développement de l’art dramatique, idée qui a été formidablement exprimée par Eugène Ionesco dont nous nous permettons de citer un passage ci-dessous :
La crise du théâtre existe-t-elle ? Elle finira par exister, si l’on continue d’en parler. On pense qu’un théâtre ne peut pas exister dans une société divisée. Il ne peut exister que dans une société divisée. Il ne peut exister que lorsqu’il y a conflit, divorce avec mes administrateurs ou mes administrés (ce qui dépasse la notion des classes sociales), ma femme ou mon amante, mes enfants et moi et moi-même. Il y aura toujours division et antagonismes. C’est-à-dire il y aura division tant qu’il y aura vie. L’univers est en crise perpétuelle. Sans la crise, sans la menace de mort, il n’y a que la mort. Donc : il y a crise au théâtre seulement lorsque le théâtre n’exprime pas la crise.
Il y a crise de théâtre lorsqu’il y a immobilité, refus de recherche ; pensée morte, c’est-à-dire dirigée. Deux dirigismes nous menacent : le dirigisme passif, celui de la routine. Le dirigisme actif ou doctrinaire, apparemment mobile, déjà automatique[35].
Dubillard, Roland, La Maison d’os, Paris, Gallimard, 1966
Aron, Paul, « Mimodrame et monodrame : deux formes méconnues de la crise du théâtre », Études théâtrales, 1999, no 15-16, p. 178-191
Artaud, Antonin, Le Théâtre et son double, Paris, Gallimard, 1938, rééd. 1964, 1985
Bernard-Gresh, Sylviane, « La Maison d’os », Télérama, 1 avril 2013, https://www.theatredurondpoint.fr/spectacle/la-maison-dos/, consulté le 3.05.2021
Birgé, Jean-Jacques, « La Maison d’os, c’est Dubillard ! », Mediapart, 2 avril 2013, https://blogs.mediapart.fr/jean-jacques-birge/blog/010413/la-maison-dos-cest-dubillard, consulté le 3.05.2021
Blanchot, Maurice, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955
Blanchot, Maurice, L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980
Corvin, Michel, « Le dedans et le dehors ou l’être-là dans le théâtre de Roland Dubillard », Europe, 2018, no 1065-1066, p. 11-28
Corvin, Michel, « Roland Dubillard », in Dictionnaire encyclopédique du théâtre, éd. M. Corvin, Paris, Larousse, 2001, p. 533-534
Danan, Joseph, « Monodrame (polyphonique) », in Lexique du drame moderne et contemporain, éd. J.-P. Sarrazac, Circé, 2010, p. 122-124
Dejean, Jean-Luc, Le théâtre français d’aujourd’hui, Paris, Fernand Nathan, 1971
Garcin-Marrou, Flore, « Le drame émancipé », Études théâtrales, 2013, no 56-57, p. 171-181, https://doi.org/10.3917/etth.056.0171
Gautier, Jean-Jacques, « La Maison d’os, de Roland Dubillard », Le Figaro, 23 novembre 1962 https://doi.org/10.1051/jphysrad:01962002302010500
Green, André, Un œil en trop : le complexe d’Œdipe dans la tragédie, Paris, Éditions de Minuit, 1969
Ionesco, Eugène, Notes et contre-notes, Paris, Gallimard, 1966
Járay-Benn, Csilla, « Les objets-personnages et les personnages-objets de Rolland Dubillard. La mobilité des objets dans les œuvres théâtrales », Revue d’esthétique, 1998, no 34, p. 267-284
Klieger Stillman, Linda, « Doubling of Sign and Image in Roland Dubillard’s La Maison d’ os », SubStance, 1979, no 1, issue 22, p. 85-95, https://doi.org/10.2307/3684145
Poudevigne, Sonia, La Théâtralité ou le théâtre dans la vie chez Nicolas Evreinov, Éditions universitaires européennes, 2019
Ryngaert, Jean-Pierre, Sermon, Julie, Le Personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition, Montreuil, Éditions Théâtrales, 2006
Sarraute, Claude, « La Maison d’os : une pièce sur l’abandon de la mort ? », France-Observateur, 29 novembre 1962, in « Roland Dubillard », Revue d’esthétique, 1998, no 34, p. 319-320
Sarrazac, Jean-Pierre, L’Avenir du drame, Lausanne, Éditions de l’Aire, 1981
Sarrazac, Jean-Pierre, Poétique du drame moderne. De Henrik Ibsen à Bernard-Marie Koltès, Paris, Éditions du Seuil, 2012
Sarrazac, Jean-Pierre, Théâtres intimes, Paris, Actes Sud, 1989
Serreau, Geneviève, Histoire du « nouveau théâtre », Paris, Gallimard, 1966
Szondi, Peter, Théorie du drame moderne, [trad. P. Pavis, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983] Belval, Circé, coll. « Penser le théâtre », 2006.
Wilkinson, Robin, « Roland Dubillard, auteur de théâtre », Revue d’esthétique, 1998, no 34, p. 199-219
Wilkinson, Robin, Le Théâtre de Roland Dubillard, essai d’analyse sémiologique, Berne, P. Lang, 1989

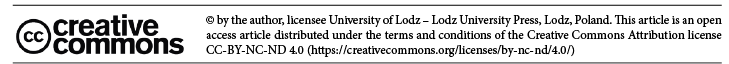
Received: 2021-10-05; Revised: 2022-04-11; Accepted: 2022‑04‑24.