

Université Pédagogique de Cracovie
RÉSUMÉ
Le présent article constitue une tentative d’exploiter, à des fins d’analyse du personnage littéraire, la notion de crise d’identité, récemment développée par Nathalie Heinich dans son ouvrage Ce que n’est pas l’identité. Pour ce faire, l’auteur s’appuie sur des exemples tirés de romans de Leïla Houari (Ni langue ni pays) et de Girolamo Santocono (Dinddra), deux auteurs belges contemporains d’origine migrante. Leurs personnages, migrants ou descendants de migrants, vivent des expériences qui s’apparentent à celle conceptualisée par Heinich. L’auteur interroge les raisons de ces crises identitaires (post)migratoires, leur déroulement et leur issue. Il s’avère que l’identité des migrant(e)s et de leurs descendant(e)s, marquée par une instabilité fondamentale, est particulièrement sujette à la crise. Toutefois, si l’identité (post)migratoire peut souvent être qualifiée de « crisique », les crises que traversent les personnages aboutissent habituellement à un dénouement positif.
MOTS-CLÉS – Crise identitaire, Littérature belge francophone, Migration, Leïla Houari, Girolamo Santocono
SUMMARY
This paper is an attempt to exploit, for purposes of literary character analysis, the notion of identity crisis, recently developed by Nathalie Heinich in her book Ce que n’est pas l’identité. To do this, the author draws on examples taken from novels by Leïla Houari (Ni langue ni pays) and Girolamo Santocono (Dinddra), both contemporary Belgian authors of migrant origin. Their characters, migrants or descendants of migrants, live experiences akin to that conceptualized by Heinich. The author questions the reasons for these (post)migratory identity crises, their course and their results. It turns out that the identity of migrants and their descendants, marked by fundamental instability, is particularly prone to the crisis. While their identities can often be described as being in crisis, the crises they go through usually result in a positive outcome.
KEYWORDS — Belgian Litterature in French, Identity crisis, Migration, Leïla Houari, Girolamo Santocono
Dans cet article, j’essaierai d’exploiter, à des fins d’analyse du personnage littéraire, la notion de crise d’identité, due au psychanalyste américain Erik Erikson et récemment développée par Nathalie Heinich dans son ouvrage Ce que n’est pas l’identité. Pour ce faire, et faute de place pour une analyse d’ensemble du courant (post)migratoire belge, je m’appuierai sur deux exemples. Tout d’abord, j’analyserai un roman récent de Leïla Houari, intitulé Ni langue ni pays, publié en 2018, pour évoquer ensuite brièvement un texte plus ancien, Dinddra de Girolamo Santocono, qui date de 1998[1]. Je vais m’attarder plus longuement sur ce premier ouvrage, qui contient un exemple d’une crise d’identité (post)migratoire vécue au féminin car, l’expérience migratoire étant souvent masculinisée, je préfère examiner plus en détail un cas permettant de considérer les enjeux de la migration pour les femmes, sujet plus rarement abordé. Mais au-delà de la différence de genre, ce qui relie les protagonistes des deux romans que j’aborderai, c’est qu’ils vivent des expériences qui s’apparentent à celle conceptualisée par Heinich.
La sociologue française propose en effet une conception de l’identité où la notion de crise joue un rôle central. Comme elle le formule dans le titre de l’un de ses chapitres, selon elle, « Il n’y a pas de sentiment d’identité sans crise d’identité »[2]. D’après la chercheuse, l’identité « ne se manifeste que lorsqu’elle pose problème »[3]. Elle devient donc perceptible seulement quand elle est problématique. C’est pourquoi, pour parler des crises identitaires, Heinich se sert aussi d’expressions comme « inconfort identitaire » ou « dissonance identitaire »[4]. Les individus « découvriraient » ainsi qu’ils ont une identité au moment où celle-ci devient trouble.
Cette notion de crise d’identité apparaît comme un outil précieux, permettant de mieux comprendre ce qui arrive aux personnages de nombreux romans du courant (post)migratoire en Belgique francophone. Bien sûr, appliquer des théories sociologiques ou psychologiques de l’identité à ces « êtres de papier » que sont les personnages romanesques suppose de les considérer comme des entités anthropomorphes. Dans la mesure où le courant (post)migratoire dans les lettres belges francophones fait habituellement appel à une esthétique mimétique, notamment à travers nombre de textes autobiographiques et autofictionnels[5], l’interprétation de leurs héros et héroïnes en tant que transpositions plus ou moins fictionnalisées d’êtres de chair et d’os semble légitime. Lors de l’analyse, je croiserai cette notion de « crise d’identité », appliquée aux personnages, avec des considérations théoriques générales concernant la crise, formulées par des chercheurs tels que Randolph Starn ou Edgar Morin, mais aussi avec la théorie du sujet de Julia Kristeva. Ces diverses références me permettront d’envisager le phénomène examiné dans une perspective à la fois sociale et psychologique.
Comme on le sait, le terme de « crise » est d’origine médicale, en grec et en latin, il signifiait la « phase grave d’une maladie »[6]. Or, dans le roman d’Houari, la première scène se passe justement dans un cabinet médical. Dans le premier chapitre, intitulé « Cellule de crise », est racontée la visite de l’héroïne principale, Fatima Benghali, travailleuse associative au chômage, écrivaine à ses heures, chez un médecin. L’héroïne lui fait notamment part de ses insomnies et du mal « dans le bas du dos » qui fait qu’elle se sent « coupée en deux »[7]. Fatima vit donc une crise au sens étymologique du mot. La métaphore dont elle se sert pour décrire son ressenti, celui d’être « coupée en deux », fait penser à ce qu’Heinich nomme troubles de la continuité et de la cohérence[8]. Il s’agirait d’une sorte de coupure corporelle menaçant presque l’intégrité physique. Pendant la consultation, le récit de symptômes physiques s’entremêle toutefois avec celui de manifestations psychiques du mal, surtout de cauchemars qui hantent la protagoniste. Le médecin dirige tout de suite l’entretien sur la question des origines de cette dernière. Fatima y répond en disant qu’elle a « l’impression d’avoir toujours vécu dans le brouillard »[9]. Cette réponse métaphorique fait état d’une situation identitaire trouble. Le fait même de passer directement de la question des symptômes à celle des origines, couramment utilisées pour définir l’identité, suggère une interprétation identitaire du trouble qui touche Fatima. À ce propos, celle-ci aborde aussi le sujet de son acte de naturalisation, qu’elle a retrouvé. L’« Avant-propos » du roman, qui précède directement la scène de la consultation médicale, est justement constitué par ce document qui comprend une sorte de fiche d’identité de la protagoniste et nous apprend notamment qu’elle est née à Casablanca, pour être naturalisée belge plus de trente ans après. Le fait que l’acte se retrouve en première page du roman et que son obtention soit longuement discutée dans la première scène suggère son importance. Or, cet acte signale surtout l’absence de continuité entre l’origine géographique et l’identité administrative de l’héroïne.
Fatima mentionne pourtant un autre symptôme de la crise psychosomatique qu’elle est en train de traverser. Il s’agit d’un trouble linguistique. Bien qu’elle ait passé une trentaine d’années à Bruxelles, pour s’installer ensuite à Paris, elle confesse au médecin ne plus savoir « quelle langue est [s]ienne réellement »[10]. Voici comment elle décrit ce symptôme linguistique :
Depuis quelque temps, j’ai un problème qui va sans doute vous paraître anecdotique. Je ne peux plus parler sans que ma langue fourche. Voilà... la voyelle U vire au I. Vous savez, l’expression : « chassez le naturel, il revient au galop » prend tout son sens. Cela me prend comme ça, au moment où je m’y attends le moins. L’autre jour, je parlais à ma fille et voilà que je lui dis « pli tard... ». J’en ai bavé avec les voyelles AEIOU, surtout le U et le I. Des heures d’apprentissage en diction et cela m’arrive de plus en pli... Voilà, j’ai failli me tromper à nouveau. Vraiment pénible[11]...
Fatima interprète les fautes de prononciation qu’il lui arrive de commettre sur le mode du conflit entre les deux composantes linguistiques de son identité : l’arabe, présentée comme « naturelle », et la française, « acquise ». Cet aspect conflictuel de la situation confirme son caractère crisique, dans la mesure où, d’après Edgar Morin, « l’idée de crise […] porte en elle la possibilité, la multiplication, l’approfondissement, le déclenchement de conflits »[12]. Fatima est en proie à un conflit phonétique. Une prononciation arabisante de la voyelle « u », rendue par « i », est pour elle le signe d’un « naturel qui revient au galop ». Son identité linguistique d’origine, celle d’arabophone, vient ainsi troubler celle de francophone. Sa langue qui fourche la ramène à ses origines géo-linguistiques alors qu’à force de travailler sa prononciation française, elle pensait s’en être détachée. La cohérence de l’identité linguistique qu’elle s’est choisie est troublée par des réminiscences de sa langue maternelle.
Par la suite, Fatima nous raconte d’autres accès, parfois encore plus aigus, de ce trouble linguistique. Ainsi, selon sa propre formule, après les attentats contre Charlie Hebdo, était-elle « incapable d’aligner trois mots cohérents en français » ; elle avait « perdu [s]a langue d’adoption »[13]. Elle l’explique par le fait que ce genre d’événements lui « donne l’impression que tout ce qu’[elle a] vécu, appris […] est remis en question »[14]. Selon Heinich, les crises identitaires sont habituellement provoquées par « toute forme de dissociation entre l’autoperception, la présentation et la désignation »[15], les trois dimensions constitutives de l’identité dans sa théorie. On sait que les attentats terroristes commis par des islamistes ont donné lieu à l’amalgame entre ces derniers et l’ensemble des immigrés originaires de pays à majorité musulmane. Leur appartenance aux sociétés d’accueil a été contestée. En parlant des attentats, Fatima fait aussi allusion à ces amalgames[16]. Elle, qui se percevait comme parfaitement acculturée grâce à sa maîtrise du français, se sent vraisemblablement renvoyée à son identité d’origine. Son autoperception et sa désignation par autrui ne coïncident plus, déclenchant une crise d’identité.
La consultation médicale qui nous est racontée au début du roman ne débouche pourtant pas sur une thérapie. L’héroïne ne retourne plus chez le médecin, mais cette consultation inaugurale amorce un travail de réflexion sur soi. En accord avec la théorie d’Heinich, la crise déclenche chez elle une réflexivité identitaire. Or, dans ses réflexions, Fatima revient obstinément sur sa situation linguistique qu’elle caractérise de la manière suivante :
J’ai deux langues. La langue d’ici. […] Je l’apprivoise chaque jour. Il y a aussi la langue de ma mère. Je l’ai perdue en traversant la mer. Parfois, j’imagine qu’elle a été avalée par une méduse géante. De celles qui longent les navires. Il arrive que la langue de ma mère chante dans ma tête. Les arabesques virevoltent, m’entraînent à mille lieues d’ici. C’est troublant. […] j’ai appris la langue à l’école d’ici. […] Ma mère ne sait pas écrire, elle ne sait pas lire. […] J’aime écrire dans la langue d’ici. Je l’ai adoptée. – Je ne sais pas si le contraire est vrai. Je l’aime quand même[17].
La notion de « trouble », que l’on peut tenir, à la lumière de la théorie d’Heinich, pour synonyme de celle de crise, apparaît, sous forme adjectivale, dans cette autoprésentation de sa situation linguistique par l’héroïne. Le trouble vient de la résurgence d’une langue d’ailleurs, celle de la mère, qui réapparaît périodiquement dans l’esprit et la bouche de la protagoniste qui la compare à un chant. On peut relier cette résurgence linguistique quasi-musicale à la question de la prononciation abordée précédemment. La crise, à la fois identitaire et linguistique, que vit Fatima pourrait ainsi être éclairée également par la théorie du sémiotique et du symbolique de Julia Kristeva. La chercheuse franco-bulgare a conceptualisé le sémiotique comme « rapport archaïque à la mère » qui se manifeste dans la sphère symbolique notamment à travers les rythmes, les glossolalies, les écholalies ou encore les intonations[18], bref, l’aspect sonore de la langue. Pour Fatima, l’arabe est « une musique » qui « appelle la poésie »[19]. Or, Kristeva associe justement la poésie à l’intrusion du sémiotique dans la langue qui correspond surtout au symbolique. L’accès à ce dernier est conditionné par l’acceptation de la loi du père. Comme l’écrit Kristeva, « La socialisation de l’individu exige […] le refoulement ou la sublimation de [la] relation primitive à la mère »[20]. L’acquisition de l’identité est à ce prix. Dans le cas de Fatima, ce refoulement semble lié à la perte de la langue arabe que l’héroïne rattache à sa mère analphabète. À l’arrivée en Belgique est associé le silence de la mère et l’insistance du père sur la réussite scolaire. Fatima se rappelle que « pendant [leurs] premières années en Europe », leur mère « ne [leur] parlait presque pas, même pas en arabe »[21]. Quant au père, pour lui, « [r]éussir à l’école était une obligation »[22] qu’il imposait à ses enfants d’une manière violente. Chez Fatima, l’acquisition du français reste donc liée au fait de quitter le territoire natal, maternel (le Maroc), et à la scolarisation dans le pays d’accueil, choisi par le père. Le voyage du Maroc en Belgique équivaut à l’abandon de l’arabe au profit du français, au passage du sémiotique maternel au symbolique paternel et à l’acquisition d’une identité.
Pour expliquer en termes kristeviens l’origine de la crise d’identité qui frappe Fatima, il faut encore une fois souligner que, selon Kristeva, l’entrée dans le symbolique ne signifie pas que le sémiotique ait complètement disparu. Le sujet kristevien est toujours, un « sujet en procès, situé entre deux modalités du langage, entre le sémiotique et le symbolique »[23], comme le rappelle Mirosław Loba. Qui plus est, Kristeva pose le rapport dynamique entre ces deux modalités linguistiques comme base de l’acte créateur. Or, Fatima est écrivaine et femme de théâtre. Bien que le français soit sa langue d’écriture, son rapport à cet idiome reste ambigu. Il est fortement affectif ; l’héroïne personnifie la langue, dit l’avoir adoptée et l’aimer sans être sûre que cet amour soit réciproque. Cette relation est aussi marquée par une instabilité foncière, comme le marquent ses difficultés périodiques à s’exprimer en français. L’identité linguistique de l’écrivaine migrante ne se laisse pas subsumer sous sa langue d’écriture. Son arrivée en Belgique n’est pas pour Fatima synonyme de l’entrée dans le symbolique tout court, mais dans celui de son pays d’accueil. En effet, elle a entamé sa scolarité en arabe, au Maroc, et a dû l’interrompre à cause de l’émigration familiale. Bien que le français soit finalement devenu la langue dans laquelle elle s’exprime, la protagoniste se tient en équilibre instable sur la frontière des langues. Du point de vue linguistique, on a l’impression que non seulement elle vit une crise d’identité, mais aussi que son identité est une identité crisique. Son refus de suivre une thérapie correspond peut-être à la prise de conscience de cet aspect constitutif de la crise pour ce qu’elle est. Elle semble prendre acte de la nécessité de la crise comme partie importante de sa dynamique identitaire.
C’est un voyage au Maroc pendant lequel Fatima rend visite à sa mère qui termine le roman. Elle en revient plus apaisée et son dos lui fait moins mal. Elle se rend compte que « [s]on pays existe », mais qu’« [elle] le porte au bout de [s]a langue »[24]. Une logique identitaire linguistique remplace ainsi le raisonnement topologique. Et par rapport à son identité linguistique, l’héroïne finit par déclarer : « Je ne suis pas une vraie bilingue. Je ne connais pas ma langue maternelle, j’utilise mon bilangage. Normal que je ne sois pas toujours comprise. Ni d’un côté ni de l’autre. J’accepte… »[25]. C’est cette notion de « bilangage », faisant penser à la « bi-langue » d’Abdelkébir Khatibi, qui définit le mieux l’identité linguistique de Fatima. Celle-ci n’est entièrement réductible ni à l’arabe ni au français. Il faudrait donc peut-être parler plutôt d’une identité discursive, individuelle, que d’une identité linguistique, collective. Pour mieux comprendre la dimension langagière de l’identité de Fatima, en plus de la théorie psychanalytique de Kristeva, c’est la perspective de l’analyse du discours qui peut s’avérer utile. Dans ce cadre, Patrick Charaudeau explique que « parler une langue étrangère, […] aussi bilingue que l’on soit, c’est souvent construire un discours propre à son identité culturelle sous l’habillage d’une langue autre »[26]. Ce constat semble correspondre au cas de Fatima, et, plus largement, à celui de nombreux migrants parlant un « bilangage », ou, pour être plus précis, tenant un bi-discours spécifique à leur(s) situation(s) particulière(s).
Dans le roman d’Houari, ce bi-discours affleure de la manière la plus visible dans des fragments qui se trouvent à la limite du compréhensible et que l’on peut décrire comme résurgence du sémiotique maternel. Ce dernier provoque une crise d’intelligibilité du discours. Comme le note le narrateur :
Tout se mélange, des bribes hybrides. Les lettres de sa langue maternelle auxquelles elle avait renoncé depuis des lustres reviennent la harceler, s’entremêlent à sa langue adoptive... leitmotiv absurde dont elle ne peut plus se défaire : – Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, tha, ra, ze, mim, noun, kaf... – Alors qu’il y a largement de quoi faire avec les : AEIOU... AEIOU... AEIOU... Aou... aou... miaou... miaou... aïe aïe... walou... macache... bled... kawa... miam miam... kifach... toubib… miaou… khlass... bezef[27]…
Le passage commence par le constat de l’intrusion dans le français de Fatima de lettres de l’alphabet arabe. Elle perçoit ces lettres et celles de l’alphabet latin comme se faisant concurrence dans son esprit. Après que quelques-unes ont été énumérées, apparaît une série de mots, tout d’abord d’onomatopées, ensuite de vocables arabes empruntés par le français et notés à l’aide de l’alphabet latin. L’arabe et le français, le maternel et le paternel, le sémiotique et le symbolique, loin de s’exclure, fusionnent. C’est aussi pour cette raison que la notion de crise est particulièrement adaptée à la description de la situation identitaire et discursive des migrants, telle qu’elle apparaît dans le roman. Comme le note Randolph Starn, « Cette notion permet […] de saisir, à la fois, la permanence et le changement, car elle implique la continuité […] mais non l’équilibre stable »[28]. Vivant à la frontière entre les pays et les langues, les migrants se trouvent en effet dans une situation d’instabilité constitutive qui peut assez facilement se muer en une crise d’identité sous l’impulsion de facteurs internes ou externes. Si Fatima finit par accepter sa situation de locutrice d’un bilangage, cette situation, source d’inconfort, la plonge quand même périodiquement dans des crises. C’est aussi l’apaisement final, apporté par l’acceptation, qui permet cette qualification de crise car cette dernière, selon Edgar Morin, « se définit toujours par rapport à des périodes de stabilité relative »[29]. À la fin du roman, Fatima regagne une telle stabilité et sa situation crisique trouve un dénouement psychologique positif.
Il en sera de même dans Dinddra de Girolamo Santocono qui constitue un exemple de crise (post)migratoire vécue au masculin. L’intrigue, qui se déroule au début des années 1980, retrace le paroxysme de cette crise que vit Pino Ventini, jeune Belge né de parents immigrés italiens, travaillant dans une société d’assurances à Bruxelles. Ce qu’il traverse, bien que moins spectaculaire que l’expérience de Fatima, s’apparente aussi à une crise d’identité. Voici comment le narrateur décrit l’état de son personnage au début du roman :
[…] malgré la petite vie paisible qu’il s’est aménagée autour de sa famille et ses copains, il ne se sent pas totalement satisfait, le Pino. Oh ! rien de bien précis, juste un léger malaise qu’il n’arrive pas à formuler mais qui l’empêche d’être totalement serein. […] Il a l’impression de poursuivre une existence sans épaisseur, une vie monocorde indigne d’un jeune de sa trempe. À son âge, son père avait déjà accompli l’essentiel de sa destinée alors que lui végète toujours dans un vide profond […] C’est vrai quoi, à vingt ans, Antonio a tout plaqué : amis, parents, soleil et air pur pour venir s’installer dans ce pays […] Pino ne sait pas pourquoi, mais le voyage migratoire de son père l’interpelle […], peut-être parce qu’il entend résonner à son tour l’appel du large ?[30].
Dans ce cas, il ne s’agit donc pas d’une crise psychosomatique, mais plutôt d’une sorte de vague à l’âme diffus. Influencé par son ami Giacomo, Pino se met à rêver de répéter l’expérience migratoire de son père. Il voit ce dernier comme un héros qui a réussi à façonner son destin[31]. Si, chez Fatima, l’expérience crisique avait une forte affinité avec le maternel, chez Pino, elle reste liée au paternel. L’immigré masculin lui apparaît tel un aventurier héroïque, ayant « accompli le voyage fondateur », « l’épreuve initiatique »[32], selon des termes que le narrateur emprunte au discours mental du personnage. La vie de Pino ne correspond pas à cette image mythique idéalisée, il a l’impression de suivre un chemin tracé par son père qui veut qu’il reprenne la petite entreprise de transport familiale. Comme dans le cas de Fatima, son autoperception et sa désignation par autrui ne coïncident pas. La crise de définition de soi qu’il traverse se manifeste surtout par sa tentative de fuir ce destin tout tracé et la communauté d’immigrés italiens au sein de laquelle il a toujours vécu, le « dinddra ». Le roman retrace ainsi notamment les pérégrinations bruxelloises chaotiques du personnage qui semble se chercher à travers ces flâneries.
Le dénouement ressemble à celui de Ni langue ni pays : la crise n’amène pas Pino à un changement spectaculaire. La confession finale de son père sur les difficultés de l’exil lui permet toutefois de remettre en question le mythe héroïque de l’immigré, et il renonce finalement à son projet d’immigration australienne. Sa compagne, Juliette, lui annonce la naissance prochaine de leur enfant. À la fin du roman, la retranscription du discours mental de Pino permet d’apporter une conclusion à son histoire :
« La vie n’est qu’une suite de compositions et de décompositions », dit souvent Roberto l’intello. J’en ai eu la confirmation. Tout ce que j’avais cru dur comme fer, qui semblait le fil conducteur de ma vie, s’est envolé sans que j’aie eu la force, ni l’envie, de le retenir. Un moment tout m’a échappé et j’ai pris une direction opposée à celle que je m’étais fixée. Vouloir à tout prix suivre le chemin que l’on s’est tracé est peut-être l’apanage des forts mais n’est-ce pas aussi la faiblesse de ceux qui ne savent pas composer avec la vie ? […] je regarde Juliette avec son ventre rond et je me dis que l’aventure qu’elle me propose, pour être banale, n’en est pas moins exaltante[33].
Cette conclusion banalise la crise d’identité que vit Pino. Elle l’inscrit comme articulation dans une conception de l’existence faisant alterner les phases d’organisation et de désorganisation. Pino prend finalement ses distances par rapport au mythe héroïque de l’immigration en tant qu’aventure d’une vie. Il devient un aventurier du quotidien. Dans son cas, comme dans celui de Fatima, la crise est le catalyseur d’une évolution psychologique où l’acceptation de sa condition joue un rôle central.
Les crises d’identité (post)migratoire se laissent difficilement ramener à un modèle unique. La diversité des formes qu’elles prennent tient surtout au caractère pluridimensionnel de toute identité. L’origine migratoire de nos protagonistes constitue seulement l’un des paramètres qui définissent qui ils sont. En choisissant un personnage féminin et un protagoniste masculin et en insistant sur le rôle des figures maternelle et paternelle dans leurs parcours respectifs, j’ai pu suggérer l’importance du genre et des configurations familiales pour les constructions identitaires, mais d’autres exemples permettraient de relever l’importance d’autres facteurs. Tout en ayant pris en compte les versants masculin et féminin de l’expérience crisique, je ne prétends donc pas proposer de modèle paradigmatique des crises d’identité (post)migratoire. Ceci dit, quelques remarques d’ordre général peuvent être formulées à partir de ce qui précède.
Comme nous l’avons vu, dans Ni langue ni pays, l’héroïne est touchée par l’accès d’un mal mystérieux, la notion de crise peut donc servir à décrire son état, même prise au sens étymologique. Au fil de l’action, sont signalés les liens de cette « maladie » non identifiée dont elle souffre avec la situation de Fatima en tant que migrante. Cette situation, comme celle de Pino, semble marquée par la crise également dans d’autres acceptions du terme, comme celles de « tension », d’« indécision », d’« incertitude », de « rupture d’équilibre » ou de « perturbation »[34]… Tout ce champ notionnel crisique renvoie à l’idée d’instabilité. Cette dernière peut résulter – c’est le cas de Fatima – d’une configuration identitaire composée d’éléments hétérogènes, potentiellement antagonistes, typique des identités marquées par l’expérience migratoire, celle du passage d’un univers socio-culturel à un autre. Elle peut aussi découler, comme chez Pino, des difficultés à se mesurer avec la dimension mythique de l’expérience migratoire.
Pourtant, plus on avance dans les histoires de Fatima et de Pino, plus la notion de crise perd ses connotations négatives. Si, chez Fatima, la crise a une dimension psychosomatique, et chez Pino, psychologique, dans aucun des deux cas, nous n’assistons à une thérapie au sens médical, mais tout au plus à une autothérapie basée sur la réflexion et l’acceptation de leur situation par les personnages et non un changement de cette situation. L’expérience de la crise se trouve ainsi radicalement dédramatisée. Dans les deux romans du courant (post)migratoire belge analysés, on se rapproche donc de la compréhension de la crise non comme phénomène exceptionnel mais condition même du vivant, telle que conceptualisée par Edgar Morin dans sa crisologie. Sans perdre sa spécificité, la situation identitaire des migrants et migrantes nous renvoie ainsi, en dernière analyse, à notre condition d’êtres vivants. De ce fait, la littérature (post)migratoire et ses interrogations concernant l’identité gagnent une certaine universalité et peuvent nous aider à penser/panser les nombreuses crises d’identité que nous affrontons tous individuellement et collectivement.
Charaudeau, Patrick, « Langue, discours et identité culturelle », Éla. Études de linguistique appliquée, 2001, no 123-124, p. 341-348, https://doi.org/10.3917/ela.123.0341
Chomiszczak, Tomasz, Kukuryk, Agnieszka, Szczur, Przemysław, Wędrujące tożsamości. Trzy studia o migracjach literackich we francuskojęzycznej Belgii, Kraków, Wydawnictwo UNUM, 2020
Heinich, Nathalie, Ce que n’est pas l’identité, Paris, Gallimard, 2018
Houari, Leïla, Ni langue ni pays, Paris, L’Harmattan, 2018
Kristeva, Julia, « Unes femmes », Les Cahiers du GRIF, 1975, no 7, p. 22-27, https://doi.org/10.3406/grif.1975.994
Loba, Mirosław, Sujet et théorie littéraire en France après 1968, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003
Morin, Edgar, « Pour une crisologie », Communications, 1976, no 25, p. 149-163 https://doi.org/10.3406/comm.1976.1388
Santocono, Girolamo, Dinddra, Cuesmes (Mons), Éditions du Cerisier, 1998
Starn, Randolph, « Métamorphoses d’une notion. Les historiens et la crise », Communications, 1976, no 25, p. 4-18
Le Trésor de la langue française informatisé, entrée « Crise », http://stella.atilf.fr, https://doi.org/10.3406/comm.1976.1377

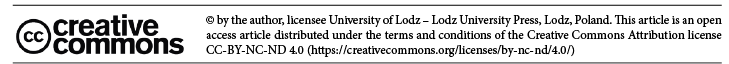
Received: 2021-09-14; Revised: 2022-01-26; Accepted: 2022‑02‑21.