

Université de Toronto
RÉSUMÉ
Après avoir écouté les témoignages de survivants tutsis (Dans le nu de la vie, 2000), l’écrivain et journaliste français Jean Hatzfeld a renversé la perspective en recueillant les récits de génocidaires hutus, avec la publication d’Une saison de machettes (2003). Cet article montre comment les récits des bourreaux sont empreints d’indicible, étant marqués par une démarche discursive calculée et réifiante, qui vise plus à taire qu’à dire en détournant et en orientant l’acte narratif. L’expérience de l’événement y est réduite à sa dimension factuelle, évacuant par l’occasion toute subjectivation. Une telle posture rhétorique, parfois très directe et très crue, mais surtout empreinte d’euphémismes et de détournements, contribue à dépersonnaliser les bourreaux, donc à normaliser l’extrême violence et à occulter le visage tutsi.
MOTS-CLÉS — Rwanda, génocide, trauma, indicible, maldicible, événement, Jean Hatzfeld
SUMMARY
After listening empathically to testimonies from surviving Tutsis (Into the Quick of Life, 2000), the French author and journalist Jean Hatzfeld reversed the perspective by gathering recollections of the events from Hutu murderers, in Machete Season (2003). This paper shows how the executioner stories are immersed in the unutterable, a posture marked by a calculating and reifying discourse that aims to remain silent about the event rather than to relate them, which divert and appropriate speech. The experience of the event is therefore reduced to its factual aspects, which evacuate any form of subjectivization. Such rhetorical posture, very direct and very crude at times, but more importantly forged with euphemisms and diversions, contribute to the depersonalization of the murderers, therefore normalizing extreme violence and concealing the face of the Tutsi.
KEYWORDS — Rwanda, genocide, trauma, unspeakable, unutterable, maldicible, event, Jean Hatzfeld
Avec Dans le nu de la vie[1], premier volet de son cycle sur le génocide des Tutsis de 1994, Jean Hatzfeld a donné la parole aux victimes survivantes. Le journaliste de guerre et écrivain français a écouté ces gens du Bugesera, district au sud de Kigali, lors de témoignages poignants – quatorze survivantes et survivants racontant leur expérience des atrocités vécues et de leur survie inhumaine dans les marais, pendant les six semaines qui ont suivi l’attentat du 6 avril 1994 contre l’avion présidentiel. J’ai travaillé dans un autre contexte[2] sur la question de la dicibilité et ses limites à la lumière du maldicible, un concept nouveau que j’ai forgé et développé dans le cadre de travaux de recherche précédents[3] et qui me semblait requis pour refléter une saisie discursive non seulement consciente, mais empreinte des limites et apories liées à la mise en discours des expériences. Ce concept met également en valeur une posture éthique de la diction, puisqu’il vise une reconnaissance de la nature faillible et partielle de l’entreprise discursive à la suite de l’expérience de l’événement. Le maldicible rend compte ici des tiraillements vécus par le survivant, pris entre le silence traumatique et la nécessité de parler pour faire sienne sa propre histoire. Dans Une saison de machettes[4], deuxième volet du cycle paru en 2003, Hatzfeld offre ce que je décrirais comme une définition « appliquée » du maldicible, lorsqu’il parle du parcours difficile du témoignage tutsi : « Seul face à la réalité du génocide, un rescapé choisit de parler, de “zigzaguer avec la vérité” ou de se taire. De son choix, comme de la confusion de ses souvenirs, il accepte de discuter et de remettre en question à tout moment » (SM, 49). Cette incessante remise en question souligne la précarité et la précarisation d’une diction de l’expérience. Par son préfixe, le maldicible souligne ainsi l’importance de dire les maux tant bien que mal – malgré la mémoire, malgré le langage, malgré le doute, malgré la douleur.
Un autre concept sera requis pour décrire la démarche discursive du bourreau, lui qui minimise, détourne, réinterprète et justifie ses actions sans vraiment les nommer. Nul besoin d’un néologisme ici : une telle démarche discursive, calculée et réifiante – qui vise plus à taire qu’à dire en détournant et en orientant l’acte discursif –, relève à mon sens de l’indicible. J’en reviendrai à Une saison de machettes : après sa description de l’acte de parole du survivant, Hatzfeld en prend le revers et pose les grands traits de l’acte de parole du génocidaire : « Face à la réalité du génocide, le premier choix d’un tueur est de se taire, le second de mentir. Il peut modifier sa décision mais il n’en discute pas. Seul, il ne prend aucun risque, comme il n’en prenait aucun pendant les massacres » (SM, 49-50). La prise de parole marque ainsi un acte contrôlé et contrôlant, pour le langage et ses contextes de production et de réception. Le calcul rend impossible toute reconnaissance – de l’autre, du geste, de l’événement. Le propos peut néanmoins être analysé pour ses angles morts, ses ratages et ses manques, lesquels dévoilent d’autant la posture discursive instrumentalisée par le meurtrier.
Le recours à un terme comme l’indicible et son opposition au néologisme proposé (le maldicible) contribuent par ailleurs à désacraliser une notion autrement absconse[5]. Les difficultés propres à ces deux concepts (indicible et maldicible) soulignent une mise en précarité du sujet énonciatif et du discours qu’il produit – cela de manière radicalement différente. D’où l’intitulé principal du présent article : Crise du dicible. Par essence, la crise est marquée par l’instabilité ; comme moment critique, elle ouvre un espace transitionnel et sous-entend la présence d’une alternative, double voie ou positive (résolution), ou négative (aggravation, voire anéantissement). Dans son étude du terme chez les Grecs, Vivien Longhi rappelle que
[l]a crise est le moment, que le médecin cherche par son art à pronostiquer, au cours duquel la maladie change et se termine, assez fréquemment pour la guérison du patient. […] Presque toutes les maladies sont conçues selon une temporalité « critique », et l’absence de progression identifiable de la maladie est généralement signe de sa grande dangerosité[6].
Comme pour la crise médicale – où le corps seul pourra ou non surmonter le moment critique –, la réponse à la crise du dicible se trouve à l’intérieur du discours lui-même, dans les modalités du langage, dans leurs possibilités et leur volonté d’expression de l’expérience.
Chez le témoin-victime, la résolution de crise passe par une diction du traumatisme, dans une démarche ouverte qui ne saurait être marquée par un achèvement, mais bien par une perfectibilité, laquelle vise moins à surmonter le passé qu’à l’intégrer à l’espace d’expérience (une dynamique mise en lumière par Hatzfeld dans la citation donnée plus tôt). À l’opposé, du côté des bourreaux, la crise du dicible se trouve dans un refus catégorique de l’événement dans son sens événemential (par opposition au sens événementiel associé au fait intramondain), lequel refus mène à une réduction strictement factuelle de l’expérience vécue et lui déniant tout aspect traumatique. Une telle posture vise surtout à prendre le contrôle du discours pour lui ôter toute précarité, et donc toute possibilité de progression (ce qui amène la « grande dangerosité » de la crise). La simplicité factuelle du discours génocidaire montre d’ailleurs une double neutralisation, quant aux actions mais aussi quant à la façon d’en parler ; l’un des interviewés de Hatzfeld, Pancrace, l’expose sans équivoque : « le conseiller nous a annoncé que le motif du meeting était la tuerie de tous les Tutsis sans exception. C’était simplement dit, c’était simple à comprendre » (SM, 15). Cette démarche rhétorique, parfois très directe et très crue, est empreinte d’euphémismes et de détournements – ici, dans l’association indue entre compréhension et application. En outre, dans l’exemple de Pancrace, mais aussi à plusieurs reprises à travers l’ouvrage, les prisonniers se déresponsabilisent des violences meurtrières en évoquant le caractère performatif des discours d’invitation au génocide. Un ordre est donné telle une sentence, une condamnation à mort inéluctable, indiscutable, puisque prononcée par une figure à l’autorité reconnue[7]. Or la dimension performative de tels discours n’est qu’une apparence, un leurre, étant invalidée par l’obéissance aveugle aux ordres sans possibilité d’exercer quelque jugement critique, sans possibilité d’erreur ou d’errance. Car comme le souligne Sandra Laugier, la théorie austinienne des actes de langage montre que « l’acte accompli l’est de manière immanente à l’énoncé (in saying), qui donc ne décrit pas un état de choses (intérieur ou extérieur) »[8]. Dès lors, l’amalgame du langage et des actions auxquelles il enjoint court-circuite les possibilités du discours pour le limiter à sa fonction constative, ce qui dépersonnalise les bourreaux, donc normalise la violence et occulte le visage tutsi. Voilà les principaux enjeux que j’aborderai ici. Mais d’abord, une brève présentation du récit s’impose, laquelle sera également l’occasion de préciser un certain nombre de concepts clés.
Avec Une saison de machettes, Jean Hatzfeld donne la parole aux génocidaires hutus, par des interviews menées à la prison de Rilima auprès d’une bande de meurtriers incarcérés. Selon ses propres dires, les entretiens individuels menés dans un premier temps n’apportent rien de bon, si ce n’est frustrations et colère. Hatzfeld réalise alors que la discussion en petit groupe homogène est plus productive, puisque ces hommes
se sentent ainsi protégés des dangers de la vérité par leur amitié et leur complicité. Des copains tranquillisés par un esprit de bande né avant le génocide, lorsqu’ils s’entraidaient aux champs et vidaient des bouteilles d’urwagwa au cabaret, et fortifié dans le chambardement des tueries des marais, et aujourd’hui par leur incarcération (SM, 50).
Les discussions s’inscrivent donc dans la continuité d’une camaraderie fortifiée par les meurtres de masse. L’ouvrage permet aux tueurs de s’exprimer et leur offre une vitrine qui, par la traduction, l’adaptation, le travail éditorial et la contextualisation, devient littéraire. On ne saurait oblitérer complètement ce travail, qu’on pourrait qualifier de « mise en littérature », réalisé par le journaliste et écrivain[9] ; par exemple, les témoignages de rescapés possèdent une fluidité étonnante, sans les répétitions et silences que l’on retrouve généralement dans les récits de traumatisme. Or nul besoin d’accéder aux enregistrements d’origine pour constater que la démarche de Hatzfeld paraît d’autant plus importante que l’aspect permanent de la crise à travers ses diverses manifestations souligne l’inévitable inadéquation entre l’expérience du monde et sa mise en mots – inadéquation nécessitant un souci de contextualisation pour éviter les manipulations discursives et mémorielles des bourreaux.
Ce difficile enjeu confère une importance particulière aux passages narrés par Hatzfeld et encadrant les récits, mais aussi au travail de montage littéraire. Car si les génocidaires prétendent offrir une forme de vérité, celle-ci est dénuée de toute éthique, puisqu’elle se réfute tout caractère problématisant et toute nature problématique, en refusant d’inscrire sa portée ailleurs que dans le discours (qui gagne alors en facticité[10] – c’est-à-dire en fait et en faux, au détriment de l’expérience événementiale), pour peu qu’on entende à la suite de Wittgenstein qu’« une proposition éthique est une action personnelle. Non la constatation d’un fait »[11]. Un exemple de ce non-engagement à l’égard de l’événement, marqué plutôt par une limitation factuelle, nous est donné par Adalbert : « On est toujours restés amis, toujours pareillement unis malgré les calamités de la vie, de l’exil et de la prison. On fait ce qu’on a à faire en camarades dans toutes les situations » (SM, 39). La généralité du propos et l’absence d’attribution assujettissent les meurtriers aux contingences de la vie, comme s’ils n’étaient pas responsables de leurs propres actes (les calamités) et des résultats de ces actes (l’exil et la prison, faisant ainsi abstraction des meurtres de masse), comme si les différentes parties impliquées dans le génocide étaient minimalement équivalentes, interchangeables, dans un cadre guerrier où l’un est ennemi de l’autre. Une telle tentative de normalisation[12] mérite une analyse serrée, mais restera forcément incomplète parce qu’à laisser ouverte. J’évite volontairement d’utiliser le vocabulaire arendtien et n’associe pas ce processus à une nouvelle représentation de la « banalité du mal » ; il se dégage certes une organisation logistique du génocide rwandais, mais il ne s’agit assurément pas de « massacres administratifs » au même titre que ce que la machine nazie a perpétré par l’action détachée du technocrate Eichmann[13]. Car telle qu’elle est pratiquée par les prisonniers que Hatzfeld interviewe, la tâche meurtrière ne s’offre d’intermédiaire qu’à l’intérieur du discours d’objectivation des mises à mort.
Des glissements discursifs sont en effet perceptibles entre d’une part la conviction de la lutte et la nécessité de tuer en contexte guerrier (d’où l’importance donnée au « courage »), et d’autre part la légèreté du travail, le plaisir retiré de la tâche collégiale bien faite, malgré les petits obstacles rencontrés en cours de route. Le même Adalbert précise :
On se plaisait ensemble au sein de la bande, on s’accordait sur les activités nouvelles, on décidait où l’on allait travailler sur place, on s’épaulait en camarades. Si quelqu’un présentait une petite excuse, on se proposait de prendre sa part de boulot pour cette fois. Ce n’était pas une organisation bien apprêtée, mais elle était respectée et consciencieuse (SM, 16).
On dirait presque qu’il est question de la gestion bon-enfant d’un commerce à la petite semaine. La notion de respect et le souci du travail bien fait sont entièrement vidés de sens. Car c’est toute une vision du monde tordue, parfois quasi schizophrène (tant elle se fait polarisante et contradictoire), qui se donne à lire dans ces tentatives d’explication de l’inacceptable, le calcul n’étant jamais bien loin de l’aveu. La pertinence d’accorder la parole aux bourreaux réside alors justement dans la manifestation de cette posture impossible, réifiante de la réalité événementiale.
Évidemment, le bourreau ne témoigne pas ; il raconte, dit, soumet les faits à sa diction – ce qui est tout le contraire du témoignage, mais aussi du saisissement de l’événement. Et la question de la vérité importe infiniment moins que le potentiel performatif du récit :
Le tueur n’appréhende pas ne pas être cru, au contraire. Il craint que vous ne le mettiez en accusation. Même si vous pouvez le convaincre que ses paroles ne lui porteront aucun préjudice, il redoute, quel que soit l’auditeur, ou plus tard le lecteur, qu’elles ne lui causent plus de tort que son silence ; et aucune relation de confiance ne peut chasser complètement cette inquiétude. Le tueur se tient sur ses gardes car il sent les menaces d’un châtiment au-dessus de sa tête (SM, 47).
Le discours du bourreau cherche à réduire la charge événementiale à sa seule factualité dans le récit objectivant qui en est fait, suspendant le langage dans la crise de dicibilité qui pourtant devrait l’animer. L’apparente permanence de la crise constitue d’ailleurs l’un de ses paradoxes, puisque pour le sujet qui la vit, la crise ne laisse pas entrevoir sa résolution, et ne saurait donc être sur le coup traversée. De surcroît, l’événementialité de la crise fait advenir le sujet dans toute son incertitude, ce qui instigue une discordance entre l’avant et l’après, discordance demeurant imperceptible dans le déroulement du pendant. Autant de caractéristiques non seulement évacuées des récits de bourreaux, mais aussi retournées contre elles-mêmes dans la manière de raconter le génocide, transformant l’événement en simples faits.
Souvent trivial, le fait intramondain est constatable ; il se laisse appréhender, résumer et éclairer par la séquence tout aussi ordinaire dans laquelle il s’inscrit. Tout le contraire de l’événement, inépuisable, marqué par la nuance, et fondamental pour le sujet qui en advient. La distinction proposée par Claude Romano entre le fait intramondain (au sens courant, dit événementiel) et l’événement au sens événemential est des plus éclairantes :
L’événement n’est jamais « objectif » comme peut l’être le fait, il ne se prête à aucune observation impartiale ; celui qui comprend ce qui lui arrive comme lui arrivant précisément à lui-même est ipso facto engagé, comme nul autre dans ce qu’il comprend, en sorte que comprendre l’événement et en faire l’insubstituable épreuve ne font qu’un[14].
Le refus catégorique de l’événementialité s’accompagne d’un refus de compréhension – de là l’impression de neutralité illocutoire chez celui qui raconte le génocide dont il s’est pourtant fait le porteur. L’incompréhension crasse des bourreaux manifestée dans et par leurs récits réduit la catastrophe qu’ils ont provoquée à sa teneur factuelle, lui retirant de fait toute valeur. Il est toutefois possible de détecter l’implication et la survenue événementiale (par exemple à travers son masquage) chez les tueurs dans un certain nombre de stratégies rhétoriques d’évitement – entre autres le vocabulaire de l’atténuation et les décrochages sémantiques, qui contribuent à dévisager la victime (c’est-à-dire lui ôter son visage) dans une dynamique de normalisation des actes.
Dans la bouche du bourreau, les figures d’atténuation ne visent pas à engendrer une plus-value sémantique, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas pour fonction de créer chez le destinataire une image riche en signification et en profondeur dans un processus de transmission de l’expérience – comme ce peut être le cas dans les témoignages parfois hésitants et allusifs du survivant. Au contraire, chez le génocidaire hutu, l’atténuation et la litote remplissent un rôle euphémique qui, si l’on remonte à l’étymon latin euphemein, conçoit l’indicible de manière positive : Giorgio Agamben rappelle que le verbe euphemein signifie « adorer en silence, comme on fait d’un dieu »[15]. L’analogie entre le travail au champ et le « travail » génocidaire est à cet égard révélatrice. Ce terrifiant glissement sémantique souligne la quotidienneté de l’effort et l’atteinte d’un but à travers l’acte destructeur. La mort comme principale occupation, presque comme métier, rend le geste funestement banal et routinier dans la bouche des tueurs. Un exemple, qui saisit par sa normalisation, par sa dépersonnalisation aussi, nous en est donné par Léopord : « Moi, je n’ai pris que la machette. Premièrement parce que j’en possédais une à la maison, deuxièmement parce que je savais l’utiliser. Pour celui qui est habile au maniement d’un outil, c’est facile de l’utiliser pour toutes les activités ; tailler les plantations ou tuer dans les marais » (SM, 43). En retirant toute valeur à ceux et celles qui de part et d’autre de la lame en sont les différents acteurs, le discours du bourreau rend futile tout principe de responsabilité et d’attribution des gestes, normalisant l’horreur et les atrocités sous couvert d’une sorte de chasse de subsistance (le troisième volet du cycle rwandais de Hatzfeld s’intitule d’ailleurs La stratégie des antilopes). La négation initiale est ici parlante : « je n’ai pris que la machette », comme s’il s’agissait d’un seuil minimal, d’un choix obligé de simplicité et de praticité, une sorte d’outil à tout faire qui ne demande qu’à être utilisé.
Le champ lexical de l’agriculture fonctionne d’ailleurs sur le mode de l’euphémisme (qui permet de dire en taisant, en toute adoration du silence) et du parallèle (qui fonctionne comme une figure d’atténuation, en gommant les extrêmes du génocide). Les récits donnent l’impression que les terres furent attaquées d’une plaie et que le travail de tous était requis jusqu’à résolution complète du problème – par exemple, chez Élie : « On devait faire vite, on n’avait pas droit aux congés, surtout pas les dimanches, on devait terminer. On avait supprimé toutes les cérémonies. On était tous embauchés à égalité pour un seul boulot, abattre tous les cancrelats » (SM, 19). Nourri des discours politiques et médiatiques[16], ce parallèle entre agriculture et extermination pose le constat commode d’un impératif de survie comme commune mesure entre le travail au champ et la torture génocidaire. Par la réification de l’acte de mise à mort, de la mort elle-même, le Tutsi n’est pas même réduit à un état animal, mais bien végétal, comme on le voit de manière évidente dans les paroles de Pancrace :
Couper les maïs ou les bananeraies, c’était un boulot égal. Parce que les épis et les bananes sont tous pareils, en rien récalcitrants. Couper dans les marais, c’était de plus en plus harassant, à cause de qui vous savez. C’était un geste comparable, mais une impression non comparable, plus hasardeuse. C’était un boulot agité (SM, 68).
Le glissement est parlant : l’objet de la coupe aux champs est clairement établi (maïs, bananes), mais l’objet de la coupe dans les marais demeure allusif (« qui vous savez ») et requiert un lien avec la négation de la phrase précédente pour dévoiler son sens (« en rien récalcitrants »). On comprend donc que ces « qui vous savez » offraient une certaine forme de résistance à la coupe (crûment physique ou en lien avec la traque des fuyards). C’est là un « boulot agité », certes, mais néanmoins intégré rapidement à la routine, devenant une activité parmi d’autres. Dans les récits des actions propres et directes des génocidaires, aucune place n’est alors aménagée pour les victimes, à qui est refusé un statut humain, un visage.
Il va de soi que d’aborder la question des victimes dans la présence de leur visage nécessite un détour par Emmanuel Lévinas. Le philosophe a développé une pensée qui accorde une place fondamentale à la question de l’humanité du visage, de son incarnation par autrui qui nous renvoie à nous-mêmes, dans la mesure où « [l]e visage est présent dans son refus d’être contenu. Dans ce sens il ne saurait être compris, c’est-à-dire englobé. Ni vu, ni touché – car dans la sensation visuelle ou tactile, l’identité du moi enveloppe l’altérité de l’objet qui précisément devient contenu »[17]. Dans les premiers jours du génocide, les coups de machettes s’abattent un peu au hasard, en l’absence concrète de toute reconnaissance de leur résultat, mais aussi dans l’aveuglement volontaire face aux victimes. Le visage perd son statut lorsque toute réduction lui est imposée par son contexte ; l’autre, qu’il s’agisse de l’ennemi à abattre ou du « cancrelat » à écraser, se trouve radicalement expulsé de la dynamique identité-altérité (puisqu’il ne renvoie plus à soi), justement pour contenir le visage – à la fois physiquement (en évitant de le voir – voir et visage partageant d’ailleurs le même étymon latin) et métaphoriquement (en l’inscrivant dans le projet destructeur d’une lutte sans merci, répondant d’une rhétorique qui vise justement à masquer l’autre, c’est-à-dire à lui donner un faux visage).
Dans le deuxième chapitre de récits, intitulé « La première fois », les tueurs racontent leur premier meurtre – ou plus précisément les premiers meurtres. Car dès le départ, avec le récit de Fulgence, le geste est minimisé, justifié et désengagé : « D’abord, j’ai cassé la tête d’une vieille maman d’un coup de gourdin. Mais, puisqu’elle était déjà allongée bien agonisante par terre, je n’ai pas ressenti la mort au bout de mon bras. Je suis rentré le soir chez moi sans même y penser » (SM, 25). La pas-tout-à-fait-morte n’intime aucun respect et ne suscite aucune réaction chez celui qui l’achève. La conjonction « mais » qui ouvre la deuxième phrase vient d’ailleurs atténuer et justifier le geste violent décrit dans la première phrase ; de l’exécution brutale à l’abrègement de l’agonie et des souffrances, il n’y a semble-t-il qu’un pas. La suite du récit s’inscrit d’ailleurs dans une dynamique de dédouanement, où l’action meurtrière se mêle à la « cohue » générale provoquée par la violence même, confondant de funeste façon la cause et ses effets : « Le lendemain, j’en ai coupé debout vivants. C’était le jour du massacre de l’église, donc un jour très spécial. À cause du brouhaha, je me souviens que j’ai commencé à frapper sans regarder sur qui, au hasard de la cohue si je puis dire » (SM, 25). Sans regarder sur qui : Fulgence faillit à reconnaître justement l’autre, son visage, lui qui ne se résume pas à sa matérialité charnelle, mais renvoie tout geste à son égard et contre son intégrité vers l’actant. Or le meurtrier termine son court récit par une forme de reconnaissance d’autrui et de la violence commise à son endroit : « Cette personne que je venais de frapper, c’était une maman, ça m’avait dégoûté de l’achever malgré la pénombre » (SM, 25). Ce geste violent est empreint de paradoxe : ce n’est pas tant la mise à mort qui provoque le dégoût que les circonstances, le fait de voir malgré la pénombre qu’il s’agit d’une maman, et donc de taire tout ce que cela pourrait signifier – soit qu’il s’agit d’une maman accompagnée, dont l’enfant a subi ou subira le même sort, soit qu’il s’agit d’une maman à venir, donc d’une femme enceinte. Cela isole également cette victime des autres qui demeurent sous-entendues dans la description proposée par Fulgence : ses coups sont certes donnés « au hasard de la cohue », mais il reconnaît d’emblée « en [avoir] coupé debout vivants », le pluriel de ce dernier mot coulant presque comme si de rien n’était dans la transcription de Hatzfeld.
Néanmoins, le visage de l’autre ne saurait échapper totalement au meurtrier qui, par moment et en particulier au début des exactions – avant que ne s’établissent une méthode et une routine, donc un semblant de « normalité » –, parfois reconnaît l’autre comme Autre, c’est-à-dire qu’il retrouve le lien identitaire et humain à travers l’altérité qui s’offre à lui, par delà la réification que le geste d’anéantissement provoque. Ce surgissement phénoménologique au cœur même de l’ivresse génocidaire se trouve dans les arcanes du visage, soit dans le regard – ce qu’exprime clairement Pancrace : « Les yeux du tué, pour le tueur, sont sa calamité s’il les regarde. Ils sont le blâme de celui qu’il tue » (SM, 26). La calamité généralisée du génocide trouve ici son insignifiant contrepoids dans le petit désastre individuel d’un remords découlant non pas du geste posé, mais de la reconnaissance de ce geste par l’Autre, dans l’ultime vision du meurtrier à travers les yeux de sa victime. Le contexte politique explosif et la mission d’extermination pseudo-vengeresse sombrent sous le poids signifiant du regard, et du visage à qui il donne vie. Car « le visage est sens à lui seul. Toi, c’est toi. En ce sens, on peut dire que le visage n’est pas “vu”. Il est ce qui ne peut devenir un contenu, que votre pensée embrasserait ; il est l’incontenable, il vous mène au-delà »[18]. La violence vise ainsi à évider le sens inépuisable du visage, pour ne lui laisser que sa qualité charnelle, physique, classée comme une matière quelconque. Les moments de lucidité marqués par cette bien étrange « calamité » sont provoqués non pas tant par la vision du visage de l’Autre que, à l’inverse, par le fait que le bourreau se trouve saisi, réquisitionné dans son inhumaine humanité, par le regard de cet Autre. Certes, en refusant l’humanité à sa victime, le bourreau réfute son humanité propre ; mais ce que cela signifie plus profondément, c’est que le génocidaire abandonne son visage pour mieux s’inscrire dans son contexte, mieux se laisser définir par lui : il devient contenu indicible de l’idéologie génocidaire, dans une perspective de mise aux normes des gestes commis – et ce, même plusieurs années après les faits[19].
Les récits produits par les génocidaires expriment la confusion (volontaire) entre les simples faits et gestes inscrits presque naturellement dans la routine habituelle, et la portée événementiale qu’ils provoquent. Le désir de normalisation se déploie alors dans la rhétorique guerrière (les Tutsis sont parfois décrits comme des résistants… qui en réalité résistent moins à un régime politique oppressif qu’à leur mise à mort). Et c’est jusque dans des récits marqués par une effroyable candeur que les bourreaux refusent toute réciprocité humaine possible – un tel déni soulignant la déresponsabilisation pour toute relation à l’Autre tutsi. C’est là le noyau critique et indicible des récits de génocidaire, dans toute la discordance entre l’action et sa représentation – laquelle se trouve d’ailleurs au cœur de la notion contemporaine de crise, puisque
[c]e que nous pouvons faire désormais est plus grand que ce dont nous pouvons nous faire une image ; entre notre capacité de fabrication et notre capacité de représentation, un fossé s’est ouvert, qui va s’élargissant de jour en jour ; notre capacité de fabrication est sans bornes, tandis que notre capacité de représentation est limitée[20].
Les bourreaux s’accommodent bien d’une telle équation, soulignant l’écart indicible entre leur fabrication du génocide et ce qu’ils en racontent – Pio, par exemple, disant : « J’avais tué des poulets mais jamais un animal de la corpulence d’un homme, comme une chèvre ou une vache » (SM, 28). La comparaison ici contribue, une fois de plus, à la normalisation d’une boucherie sans nom.
À l’opposé, c’est par une entreprise discursive empreinte de maldicible qu’il est possible de confronter la limite par le témoignage, moins pour surmonter cette limite que dans l’espoir d’en repousser minimalement les frontières – attendu qu’« [a]ucun sens humain, au-delà des logiques destructrices à saisir, ne peut être donné à un génocide, qui reste ultimement “sans raison”. Mais un sens peut revenir à la vie par le témoignage du rescapé, qui fait ainsi retour à l’humanité, tout en donnant accès à l’inhumain traversé »[21]. D’un côté comme de l’autre, la crise du dicible est fondamentalement insoluble ; c’est là sa force aussi bien éthique qu’esthétique, dans l’infinie possibilité de la transmission des expériences humaines. L’opposition indicible-maldicible s’éclaire alors à la lumière de l’écart entre « capacité de fabrication » et « capacité de représentation ». C’est justement dans la volonté de reconnaissance de cet écart que le maldicible trébuche vers l’avant. Et c’est par sa réfutation que l’indicible s’engage dans une trajectoire rectiligne qui se révèle en fait être une argumentation circulaire, raisonnement fallacieux marqué par le fait isolé et isolant, atténuable pour mieux faire concorder l’action à sa diction (tout le contraire du témoignage marqué par le maldicible). Reste pour le bourreau cette inquiétude du « châtiment au-dessus de sa tête » (SM, 47), sentiment perceptible dans les différentes stratégies d’adoration du silence employées. La réflexion autour de l’euphémisme dévoile ainsi une bien vaine litote, marquée par la volonté de dire moins pour faire entendre encore moins ; nous voilà au cœur même de la notion d’indicible. Précisément ce contre quoi s’oppose le maldicible, par les moyens bien faillibles qui sont les siens.
Agamben, Giorgio, Auschwitz. L’archive et le témoin, traduit de l’italien par Pierre Alféri, Paris, Rivages, « Poche », 2016
Arendt, Hannah, Les Origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem, édition établie sous la direction de Pierre Bouretz, Paris, Gallimard, « Quarto », 2002
Augustin, La Doctrine chrétienne, traduit du latin par Madeleine Moreau, Paris, Institut d’études augustiniennes, « Bibliothèque augustinienne », 1997
Chevrette, Eric, Vigiles de mémoire. Esth/éthique du maldicible chez Modiano, Ernaux, Le Clézio, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, « Espace littéraire », 2020
Coquio, Catherine, Rwanda : le réel et les récits, Paris, Belin, « Littérature et politique », 2004
Godin, Christian, « Ouvertures à un concept : la catastrophe », Le Portique, 2009, no 22, https://doi.org/10.4000/leportique.1993
Hatzfeld, Jean, Dans le nu de la vie. Récits des marais rwandais, Paris, Seuil, « Fiction & Cie », 2000
Hatzfeld, Jean, Une saison de machettes, Paris, Seuil, « Points », 2005 [2003]
Hron, Madelaine, « Gukora and Itsembatsemba: The “Ordinary Killers” in Jean Hatzfeld’s Machete Season », Research in African Literatures, 2011, vol. 42, no 2, https://doi.org/10.2979/reseafrilite.42.2.125
Laugier, Sandra, « Actes de langage et états de choses : Austin et Reinach », Les Études philosophiques, 2005, no 72, https://doi.org/10.3917/leph.051.0073
Lévinas, Emmanuel, Éthique et infini : dialogues avec Philippe Nemo, Paris, Fayard, 1982
Lévinas, Emmanuel, Totalité et infini, La Haye, Martinus Nijhoff, 1961
Longhi, Vivien, Krisis ou la décision génératrice, Villeneuve-d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, « Cahiers de philologie », 2020, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.100037
Pleasants, Nigel, « Ordinary Men: Genocide, Determinism, Agency, and Moral Culpability », Philosophy of the Social Sciences, 2018, vol. 48, no 1, p. 3-32, https://doi.org/10.1177/0048393117739974
Riffaterre, Michael, « Le témoignage littéraire ». Romanic Review, 2002, vol. 93, no 1-2, p. 217–235, https://doi.org/10.1215/26885220-93.1-2.217
Romano, Claude, L’Événement et le monde, Paris, Presses Universitaires de France, « Épiméthée », 2021
Wittgenstein, Ludwig, Carnets de Cambridge et de Skjolden. 1930-1932, 1936-1937, traduit de l’allemand par Jean-Pierre Cometti, Paris, Presses universitaires de France, « Perspectives critiques », 1999

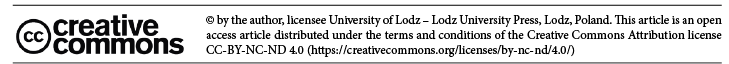
Received: 2021-09-27; Revised: 2022-02-28; Accepted: 2022-03-31.