
Université Cergy Pontoise / Paris Seine
RÉSUMÉ
Depuis son roman Archéologie du chaos (amoureux) paru en 2007, Mustapha Benfodil s’applique à mettre en œuvre le programme énoncé par l’un de ses personnages : DECONSTRUIRE L’ORDRE NARRATIF NATIONAL. Son dernier roman, Alger, journal intense, publié en septembre 2019, en témoigne. Dans celui-ci comme dans tous ses textes, Benfodil fait exploser la langue, les genres, les formes discursives et éditoriales. Avec jubilation, colère et humour, il met à nouveau l’écriture en crise pour conter l’Algérie victime, depuis octobre 1988, d’une terrible série de crises. Ainsi, douze ans après, nous verrons comment, grâce à l’écriture déjantée de la fiction, Benfodil saisit le chaos historique dont l’Algérie post-coloniale essaie de sortir.
MOTS-CLÉS — Crises, journal intime, Algérie, écritures du trauma, fiction et politique, processus créatif, Mustapha Benfodil
SUMMARY
Since the publication his novel Archaeology of chaos (in love) in 2007, Mustapha Benfodil has applied himself to implementing the program set out by one of his characters: the DECONSTRUCTION OF THE NATIONAL NARRATIVE ORDER. His latest novel, Alger, journal intense, published in September of 2019, realises this project. As in his other texts, Benfodil challenges the rules of languages, genres, and even discursive and editorial forms. With jubilation, anger and humour, once again he puts writing in crisis to tell the story of Algeria that has been the victim of a terrible series of crises since October 1988. Twelve years later, Benfodil’s unstifled writing style captures the “historical chaos” from which post-colonial Algeria is trying to recover.
KEYWORDS — Crises, diary, Algeria, trauma writings, fiction and politics, creative process, Mustapha Benfodil
Petit avertissement à la lectrice et au lecteur.
Étudier l’œuvre de Mustapha Benfodil est entrer dans son univers littéraire hors normes et jouir de son écriture inclassable. C’est accepter joyeusement d’enfreindre les règles du style académique.
Ah ! L’Algérie, cette « Alchérie » […]
que nous haïssons amoureusement
dans une improbable passion oxymorique.
Mustapha Benfodil[1]
À la deux centième page de son dernier roman, Alger, journal intense, publié d’abord en 2018 aux Éditions algériennes Barzakh sous le titre très différent de Body Writing et, en 2019, en France aux Éditions Macula, le héros Karim Fatimi écrit dans son journal personnel : « Ma foi, même Lui [Dieu] n’a rien compris au Big Bordel Algérie ! ». Cette expression qui manifeste avec humour le désespoir du protagoniste face à son pays perpétuellement en crise peut également être empruntée par celui ou celle qui s’attaque à l’analyse de l’écriture de Mustapha Benfodil. En effet, depuis son roman Archéologie du chaos (amoureux), paru en 2007, Mustapha Benfodil s’applique à mettre en œuvre le programme énoncé par l’un de ses personnages : DECONSTRUIRE L’ORDRE NARRATIF NATIONAL. Son écriture déjantée est un Big Bordel jubilatoire au service, dans Alger, journal intense, d’un chaos à la fois collectif et intime.
Le changement de perspective induit par la transformation française du titre donné en Algérie est révélateur de la tension qui existe entre les deux pays dans le domaine de la diffusion des littératures francophones. Mustapha Benfodil, reporter au quotidien algérien El Watan, est un journaliste engagé, qui, depuis son premier roman, Zarta, publié en 2000, tord la langue française et bouscule les genres littéraires pour exprimer par l’imaginaire la lutte corps à corps qu’est la vie dans son pays, l’Algérie.
Ainsi, le titre originel du roman, Body Writing, exprime tout particulièrement l’écriture tripale qui lui est propre. L’écriture de l’intime est de plus renforcée par le sous-titre : « Vie et mort de Karim Fatimi, écrivain (1968-2014) », précision totalement absente de l’édition française.
Mustapha Benfodil, lui-même, insiste sur la connotation volontairement biologique du premier titre :
Dès l’écriture de la toute première mouture de ce texte, et qui remonte à 2008, le titre Body Writing s’était imposé à moi comme une évidence, et c’est ainsi que je l’ai senti. Cela fait d’emblée penser bien sûr à « Body Painting », une discipline artistique donc qui nous renvoie, a priori, à l’univers de Mounia, la narratrice[2].
Le second titre, Alger, journal intense, modifie considérablement l’horizon d’attente proposé au lectorat. En effet, si le genre de la littérature de soi persiste, la synecdoque déplace le motif de la capitale, Alger, au pays, à l’Algérie tout entière.
De façon implicite, le caractère personnel de la crise contenu dans le titre algérien – Body Writing ou « écriture du corps » en français –, disparaît pour orienter la focale sur la crise de la société algérienne.
Mustapha Benfodil avoue être à l’origine de cette désincarnation afin de satisfaire le désir de l’éditeur :
Lorsque les éditions Macula m’ont proposé de publier le roman en France, ils ont exprimé très rapidement des réserves au sujet du titre, arguant du fait que les anglicismes et les titres en anglais n’étaient pas très bien vus dans le champ éditorial parisien. J’avoue que je n’ai pas protesté, étant parfaitement d’accord sur le fait que le choix du titre est du domaine discrétionnaire de l’éditeur. J’ai compris donc que « Body Writing » ne les emballait pas trop, après quoi, je leur ai fait d’autres suggestions parmi lesquelles « Alger, journal intense », et c’est celui-là qui sera finalement retenu[3].
Toutefois, ce changement considérable obéit sans les nommer à deux impératifs. Le premier est économique : Mustapha Benfodil est un auteur qui, en France, a une notoriété encore confidentielle, malgré la réalité de son talent. La diffusion de ses ouvrages, comme pour nombre d’autrices et auteurs francophones, demeure difficile.
Le second impératif est historique et mémoriel. Alger, journal intense est un titre qui anonymise le héros. La mise en valeur du nom de la capitale de l’Algérie, renforcée à la fois par la virgule et la connotation journalistique soutenue par l’adjectif intense, revitalise la perception de l’Algérie post-coloniale historiquement et perpétuellement en crise. Sur la couverture, le titre de 2019, en supprimant les bornes temporelles, fait référence à la fois au contentieux mémoriel entre les deux rives de la Méditerranée et à l’actualité récente, celle du Hirak[4], afin de mieux intriguer et interpeller le public français. La médiatisation du titre est volontaire et permet de réactiver ad libitum chez la lectrice et le lecteur les représentations des événements ou phénomènes liés à des crises historiques ou sociétales : la guerre d’Algérie, l’immigration et l’émigration, la banlieue, les années 1990, la Révolution, les manifestations, les mouvements sociaux, le patriarcat, etc.
Le marketing, le commerce du livre, nécessite la spectacularisation qui émeut et incite à l’achat, puisque comme l’exprimait déjà, en 1967, Guy Debord, « [s]ous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissements, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante »[5].
Enfin, la distance entre les deux titres n’est pas étrangère au contexte de publication et au double statut de l’auteur, à la fois journaliste et écrivain. En Algérie, Mustapha Benfodil est un journaliste critique du pouvoir. Ses articles sont remarqués. Et, sa plume, souvent acerbe, commentée :
Sur le plan psychologique et existentiel, disons pour aller vite que mon rapport au journalisme participe de l’hyper-réalité, d’une présence au monde, d’un engagement au premier degré dans la société, dans les urgences du moment, avec parfois une nette dimension militante, et avec, à la clé, une écriture « premier degré »[6].
La réception de ses écrits est fortement dépendante de sa posture de journaliste. Reporter au quotidien El Watan, tel un Albert Londres algérien, il couvre des événements sensibles et, dans un pays où la liberté d’expression est souvent malmenée, ose prendre des risques comme le prouve le communiqué inquiet de son journal, le 8 octobre 2019, à 11 heures :
Notre journaliste-reporter d’El Watan, Mustapha Benfodil a été interpellé, aux environs de 10h25, alors qu’il était en mission de couverture de la marche des étudiants à Alger. Il est injoignable.
Cette interpellation constitue une entrave supplémentaire à l’exercice du métier de journaliste. Rappelons que les services de sécurité n’hésitent pas à interpeller des journalistes dans l’exercice de leur métier. Précisons que les policiers ont procédé, ce matin, à plusieurs arrestations pour empêcher la marche hebdomadaire des étudiants. Le collectif des journalistes du journal El Watan dénonce le harcèlement policier, pressions et intimidations dont font l’objet les journalistes dans l’exercice de leur fonction, et exige la libération immédiate de leur collègue Mustapha Benfodil[7].
Sa double posture, loin d’être exceptionnelle dans l’histoire de la littérature, est à l’origine de son processus de création original et singulier : « Tandis que l’écrivain, lui, [dit-il] s’amuse à vampiriser ce matériau livré par le journaliste pour aussitôt le sublimer, le transgresser, le subvertir »[8]. Sa stratégie créative est magistrale et lisible dans Alger, journal intense. Son outil favori est « La pluie tectonique des lettres » (AJI, 81) afin de dynamiter le fond et la forme.
Alger, journal intense est le récit d’un enchevêtrement de crises.
Crise existentielle du héros dépressif, Karim Fatimi, physicien reconnu, qui se tue sur la route près d’un lieu réel, la Maison hantée. Crise personnelle de sa femme qui, tout en découvrant les écrits tourmentés de son défunt mari, rédige son propre journal. Crise de l’Histoire et de la mémoire qui imprègne l’ensemble de la fable : événements douloureux d’Octobre 1988, la décennie noire, la naissance de la fille des protagonistes et une date mystérieuse, le 28 novembre 1994. Enfin, crise économique, culturelle et sociale de l’Algérie au début du XXIe siècle.
Autrement dit, en s’appropriant une des expressions de l’auteur : « un beau foutoir » de crises à écrire. En ce sens, la métaphore explosive s’impose pour distinguer les effets de souffle, constitutifs du chaos apparent qu’est l’écriture de M. Benfodil.
Sur la couverture, au-dessus de la photo d’une demeure visiblement abandonnée, la Maison hantée nommée dans le récit, est écrit en petits caractères le genre de l’ouvrage : roman. Catégorie littéraire suffisamment plastique pour désigner l’Objet littéraire non identifié qu’est Alger, journal intense. En effet, ni journal intime, ni autobiographie, ni bande dessinée, ni chronique, ni reportage, ni document, ni manifeste, ni autofiction, ni correspondance, ce roman foutraque est tout à la fois. D’ailleurs, son éditeur algérien Barzakh le présente comme un « roman-kaléidoscope » en écho avec les crises intimes et collectives qui y sont contées.
La place conventionnelle de la dédicace mise à part, sa structure d’emblée détonne.
Le roman s’ouvre sur un poème-adresse à tonalité très personnelle avec l’emploi du pronom personnel « vous » assorti de la photo d’un homme jeune qu’il n’est possible d’identifier que dans l’édition algérienne au sous-titre révélant le nom du héros, Karim Fatimi. Dans l’édition française, sans indices, le lecteur, vu le caractère affectif et sentimental de l’adresse, peut considérer la photo comme celle de l’auteur. La piste autobiographique est également renforcée par les deux longues citations qui suivent. La première extraite du Livre de l’intranquillité de Pessoa utilise le « je » comme celle qui suit, tirée de Coma, de Pierre Guyotat. Toutefois, même si les deux insistent sur la nécessité existentielle de l’écriture, leur place, après cet énigmatique portrait en noir et blanc, pose la question de l’identité de l’auteur. Qui écrit « je » ? Qui éprouve le besoin vital d’écrire ? Qui est le narrateur ? Un personnage nommé Karim ou l’auteur lui-même ? Une fois la lecture achevée, la question demeure et Mustapha Benfodil accomplit avec brio son intention esthétique :
En réalité je brouille les frontières entre autobiographie, autofiction et documents. Ce sont trois registres qui renvoient au réel, à ma vie, mais que je manipule avec beaucoup de malice. C’est presque jouissif chez moi de brouiller les frontières. Même mes frères et sœurs seraient incapables de démêler ce qui est vrai, de ce qui ne l’est pas. À partir du moment où je me sers d’un matériau et que je décide d’en faire une fiction, j’ai besoin de cette liberté pour en faire ce que je veux. C’est pourquoi je peux dire que Karim Fatimi n’est pas mon double littéraire[9].
Une telle affirmation règle la question du genre littéraire mais laisse en suspens celle de la composition et de l’écriture du récit.
En effet, qui dit autobiographie, autofiction, voire la très contemporaine « non fiction narrative » ou roman-vérité à la Truman Capote, sous-entend le respect dans le discours de la linéarité du temps, indication de la fin et du début de l’histoire. En est-il de même chez Benfodil pour qui l’écriture comme l’écrivain est le « sismographe du monde » ? Écrire par l’imaginaire les cataclysmes intimes et collectifs modifie-t-il, chez lui, le continuum et le sens de la fable ?
Au premier regard, la division du roman en quatre parties de dimension inégale, intitulées « Papiers », « Octobre », « Oranges sanguines » et « Je » laisse supposer une juxtaposition de textes autonomes, sans lien les uns avec les autres.
L’aspect bouleversé de la composition, remarquable dès l’incipit, n’est pourtant qu’apparence. Même si le début de la première partie saisit par sa forme et n’encourage guère le lecteur à poursuivre, sa surprenante originalité conforte le caractère désordonné de la structure. Entamé par la page sept déchirée du roman inachevé du héros, elle-même suivie par celle de son journal intime datée du jeudi 17 avril et illustrée par un dessin d’enfant, le texte change de police pour introduire, en caractères différents, un nouveau narrateur. Désormais, et pour un court instant, l’héroïne Mounia parle et sa main tremble à l’idée d’entamer son propre journal. L’entrée in medias res dans cette structure désorganisée, véritable patchwork de textes, donne le ton extravagant de l’ouvrage tout en proposant son mode de lecture.
Paradoxalement, en jouant avec les différentes temporalités contenues dans les fragments de journal intime, d’archives et de notes retrouvées, dans les poèmes, les performances scripturales et iconiques de l’auteur et de sa fille, le fil de la narration reste continu. L’histoire qui se déroule sous nos yeux est celle d’une femme qui, en écrivant son « contre-journal », cherche à faire le deuil de l’être aimé et finit par se trouver elle-même, bien et plus que vivante (AJI, 230). Mounia trie et range les papiers, se souvient des bons et des mauvais moments passés, affronte les mensonges et les secrets, dévoile ses envies et ses désirs.
Toutefois, si son journal intime respecte, à partir de la page 23, les règles formelles du genre telle que l’égrenage des jours en lettres capitales en un lancinant refrain : « SEPTIÈME JOUR SANS TOI [...] QUINZIÈME JOUR SANS TOI (AJI, 39) [...] DEUX MOIS SANS TOI (AJI, 163) [...] », sa cohérence discursive se tisse à partir du désordre chronologique produit par ses découvertes et par sa pratique déboussolée de lectrice. Mounia tient un discours sur des documents non classés. De plus, elle mène son étude de façon vagabonde, s’interrompt, revient en arrière, saute des lignes, rompt le flux du discours. Penaude, elle l’avoue sans fard au QUATORZIÈME JOUR SANS TOI :
Je t’avais dit que j’avais lu tes dernières notes, celles commencées à « 16h10 », convaincue d’y trouver un signe prophétique, un message subliminal, une amulette magique qui agirait sur mon âme comme un placebo. Tout à l’heure, sous l’effet de l’ennui, de la solitude, ou plutôt du désir féroce, oui, du désir féroce de te retrouver, de te parler, de te ramener à la vie, j’ai lu à rebours les passages précédents, et, pour tout t’avouer, j’ai lu les trois pages de cette funeste journée, ce sinistre 17 avril. Poussée par la curiosité, j’ai remonté les autres pages aussi, toutes les pages, jusqu’aux premières notes du cahier (AJI, 33).
Ce jeu incessant sur les temporalités et les contextes se poursuit jusqu’à la fin du journal de Mounia, datée de février 2014. Il sert cependant une analyse plus politique dans la seconde partie, « Octobre », consacrée aux crises politiques connues par l’Algérie depuis son indépendance. Celle-ci s’ouvre sur un poème « Octobre, Novembre, Décombre », écrit par Karim Fatimi en octobre 88, aux images et sonorités particulièrement suggestives. Ces vers libres rappellent l’événement fondateur de l’engagement de l’auteur-narrateur-personnage. Au son de la musique et des balles matérialisé phoniquement par la répétition graphique de la syllabe TA sous la forme d’une trompette TATATA..., le héros appelle à étendre la révolte entamée en Kabylie, fait historique d’octobre 1988, souvent lu au Maghreb comme les prémisses du « Printemps arabe » de 2011.
Dans cette partie qui narre la guerre, la Révolution, la décennie noire, la langue déglingue les formes pour exprimer de façon aiguë et épidermique la crise collective.
La langue chez Mustapha Benfodil est avant tout performative. Elle est activiste et provoque chez le lecteur non seulement une émotion esthétique mais également une réaction sensorielle. Son écriture surprend le lecteur ou la lectrice. Déstabilisé(e), il ou elle peut soit tenir bon soit renoncer à la lecture. Tourner la page ou fermer le livre peut être sa première réaction physique. Benfodil est un écrivain manuel : la langue est son matériau qu’il façonne comme un artisan. Son écriture est une poïétique qui débouche sur une création nouvelle : une poétique « abrasive ».
Dans la première partie, « Papiers », Benfodil, comme à son habitude, prend son « stylet organe externe qui calque [son] pouls et relaie [...] son cœur quand [son] cœur n’y arrive plus » (AJI, 15). Il pétrit la syntaxe, le rythme et le lexique pour exprimer les sentiments et sensations intimes. La langue, servante de la crise personnelle, est d’abord celle du cœur et des corps émus. Il en est de même dans la troisième partie, « Oranges sanguines », centrée sur la relation des deux diaristes, dans laquelle l’héroïne, Mounia, dialogue avec son cher disparu et poursuit son travail de deuil. De toute évidence, Mounia, en lisant l’aimé, se découvre, ose se regarder et, sans complaisance avec leur amour et elle-même, avoue tout : la passion, le plaisir, les déceptions, les remords, les regrets, les blessures, les frustrations, les petites morts. L’écriture est soin et révélation. La quatrième partie, très courte, intitulée « JE », inverse alors la perspective, et centre le discours non plus sur le défunt Karim mais sur elle, la bien vivante. Désormais, il est temps pour la femme archiviste et scribe qu’elle est devenue, de tout « remettre dans l’armoire métallique » et de jeter à la mer la clef et son chagrin. En effet, si la littérature fait parler les morts, elle ne peut nous contraindre à vivre avec : « J’ai fermé l’armoire à clé. J’ai pris la clé, j’ai sauté dans la voiture avec Neïla. [...] C’est fini. OUF ! » (AJI, 235).
Mounia revisite son histoire d’amour en crise avec la langue du cœur et du corps. Tiraillée entre chagrin infini et sentiment d’abandon, elle règle son écriture sur le tempo donné par le journal de Karim. Pour exemple, après avoir lu et ressenti l’inquiétude éprouvée par Karim, le mercredi 14 avril 2010, devant la fragilité de Neïla, bébé âgé de deux mois, elle décrit le cauchemar qu’ont suscité ces lignes : « Je suffoquais dans mon sommeil, et je me figeais dans mes photos, et tu te fichais de tout, de tout... ». Cette mise au diapason créée par l’empathie est immédiatement relayée dans le corps du récit par un fragment, extrait du journal de Karim :
Lundi 17 février 2014. J’ignore l’heure qu’il est. 2h du matin ? Fièvre. Frissons. J’ai comme... perdu connaissance. Je ne me suis pas rendu compte, je… je me suis assoupi près de Neïla et je me suis réveillé en sursaut, le front brulant et le corps fébrile. Je l’avais mise au lit et j’avais improvisé une histoire. Ma langue délirait tandis ma tête n’arrêtait pas de penser aux trous noirs, ma marotte de toujours [...] (AJI, 207).
La nuit de Karim décédé répond à la nuit de Mounia en vie. Elle suffoque, il frissonne. La langue « délirante » est bien celle du cœur et des corps consentants. Souvent insuffisante parce qu’il y a un trop plein d’amour, un greffon linguistique est nécessaire. C’est ce que fait Karim lorsqu’il invente le curieux dictionnaire de Neïla. Un petit dictionnaire d’enfance – que tout parent a un jour voulu écrire – un lexique éphémère singulier et tendre comme l’est celui du Neïlatou, le parler de leur fille : « Pom ça : Comme ça ; Ma-mna : Manger ; Nma : Eau ; Eddas : Regarde » (AJI, 143)...
Dans la troisième partie, « Octobre », la langue est une hydre à quatre têtes : le français, l’anglais, le tamazight[11] et quelques mots d’arabe fusha (littéraire) et deerja (dialectal). Servante du collectif, elle est celle qui tord les boyaux, elle fait mal, elle est à corps défendant.
Sa dynamique est ravageuse, son énergie dévastatrice est décuplée pour rendre compte de la violence politique sur le corps civique, celui du peuple algérien. Elle redouble de force, d’invention et d’indécence stylistique et esthétique. L’écrivain Benfodil poursuit avec obstination son programme existentiel : DECONSTRUIRE L’ORDRE NARRATIF NATIONAL.
Par là même, « Octobre » est un exemplaire morceau de la Pop littérature combattante parce qu’on ne peut parler de la crise d’Octobre 1988, de la décennie noire, de la faillite du FLN historique, de l’Irak, de la Palestine, et de l’enlèvement du héros le 28 novembre 1994, disparu comme tant d’autres, que de façon percutante et performante.
La langue doit inciter à l’action. Pour cela, les phrases vibrent, ondoient et se déglinguent sous nos yeux et à nos oreilles, constituant des vagues de sons et d’images, des mélopées et des dessins, des litanies et des flyers, des slogans et des manifestes-articles de presse. Ce matériel iconique et textuel né de la langue exprime de façon sensible la crise du politique par celui qui la subit, le peuple descendu dans la rue :
Je m’attache, oui, à ramasser les instantanés du langage recueillis dans la bouche de la rue, des cafés, des taxis, des marchés, des coiffeurs, des bouis-bouis, des bars, des hôpitaux-mouroirs, et dans la voix plaintive des mendiants et des destins abimés, et dans le brouhaha des souks, et dans la violence des stades et les écritures piétonnières, les graffitis sauvages et les manifestes des chômeurs tagués sur les murs d’Alger (AJI, 129).
Variant les graphies, usant du calligramme, mêlant discours direct et indirect par à-coups, jouant avec les points d’exclamation, et les interjections, dégueulant de points de suspension et de silences, se délectant d’onomatopées improbables, s’enivrant de répétitions, Benfodil excelle dans les figures de style et constructions sonores : les jeux de mots, les anaphores, les calembours, les néologismes et la concaténation. Sens et jeux linguistiques sont indissociables. Les phrases sans ponctuations sont des torrents de mots, d’images, de sons, de citations tronquées ( Char, Genet, Fanon, Darwich) pour que l’écriture devienne une langue de feu, un tsunami, un monstre enfantant un « GIGANTEXTE » (AJI, 35) qui doit suffisamment piquer, brûler pour mettre debout toutes les victimes de la crise.
Par là même, l’hommage au grand poète palestinien Mahmoud Darwich, long poème en prose ou « ode à la digne extinction de la métaphore » (AJI, 74) titré « Darwish Graffiti », entamé comme une calligraphie arabe, poursuivi en français, doit être sans hésitation oralisé pour mieux entendre le grondement de la poésie, seule capable d’attaquer le ciment des palissades à détruire :
ta voix cassée qui essaie de se frayer un chemin vers les vivants et tente vainement de transpercer le mur transpercer le mur transpercer le mur du sens et le mur et le sang et le mur et le sens et le sang et le poème et le mur et la mort et ton poème assiégé et le sens et le sang et le sens et le sang et le sens et le sel et le ciel (AJI, 77)...
La littérature subversive et invincible est une arme pour répondre à la crise collective, elle est politique, et l’aède se fait résistant pour ceux et celles qui veulent vivre libres et en paix :
Nous ne savons décidément pas ériger des palissades aède ! Nous savons seulement taguer des graffitis sur les décrets hiératiques de l’interdit VOUS QUI PASSEZ PARMI LES PAROLES PASSAGERES RAMASSEZ VOTRE MERDE ET PARTEZ ! J’apprends à écrire dans l’alphabet des pierres qui ont composé l’insurrection des damnés et qui jonchent tes tiroirs (AJI, 77)...
Karim Fatimi / Mustapha Benfodil, Muska Fatiben / Pharim Mifodil suit avec respect et allégresse ceux qui l’ont précédé et inspiré. Tous ont affronté la catastrophe, la crise collective sous toutes ses formes avec la poésie et la magie des phrases et des mots écrits ou mis en musique : Char, Darwich, Benjamin, Blanchot, Calvino, Fela Kuti, Pierre Michon, Thelonious Monk, Fanon, Ibn Khaldoun, Miles Davis, Ghassan Kanafani, Herbie Hancock, Genet, Chick Corea, Mohammed Dib, Bill Evans, Kateb Yacine, Sartre, Marcus Miller, Malek Haddad, Karim Ziad, Pasolini, Artaud, Camus...
Alger, journal intense est un des plus beaux livres de l’obsédé textuel (AJI, 52) qu’est Mustapha Benfodil, dévoué corps et âme à la même maîtresse que celle de son héros Karim Fatimi, « L’écriture et ses avatars ». Dans ce magnifique roman, à côté de l’intrigue au demeurant fort mince, Benfodil, par l’entremise de ses personnages, analyse sa pratique et son rapport à la langue, aux langues. Il s’agit pour lui d’arriver à faire vivre « la poésie brute du réel ». Un tel viatique se prête incontestablement à l’analyse de l’écriture de la crise, phénomène existentiel et commun à tout un chacun, et, de surcroît, situé dans un espace traversé par un pays en crise(s) : l’Algérie. Cependant, Alger, journal intense pose une dernière question théorique : qui est capable d’écrire la crise ? Faut-il être en crise pour écrire la crise individuelle ou collective ? La crise vécue nourrit-elle son écriture ? Mounia, à la fin du roman, l’affirme. Elle comprend que la bacchanale des mots à laquelle se livrait son mari manifestait sa crise intérieure profonde et lui permettait de vivre. En collectionnant les bouts de papier et les écrits sous toutes leurs formes pour rendre compte des crises successives traversées par l’Algérie et son peuple, Karim produisait le sens, la sève qui le maintenait en vie : « tout était précieux, le moindre fait, le moindre brin de vie, jusqu’au détail le plus insignifiant ; tu t’es voué à cette tâche sans relâche et sans répit, te tuant à redonner sa dignité au réel ».
Encore une fois, Mustapha Benfodil, avec sa « langue fourchue des harragas du langage » (AJI, 129), plaide, comme Michel Foucault, pour une esthétique de l’existence[12]. Pour que nos vies, grâce à la littérature, deviennent des œuvres d’art.
Benfodil, Mustapha, Alger, Journal intense, Paris, Éditions Macula, 2019
Brodziak, Sylvie, « Mustapha Benfodil, la littérature comme “maison du jouir”, dans La Littérature maghrébine de langue française au tournant du 21e siècle : Formes et expressions littéraires dans un monde en mutation », Radia Benslimane et Sabrina Fatmi-Sakri (dir.), Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique-Université Alger 2, 2016, p. 159-174
Debord, Guy, La Société du spectacle, Barcelone, Folio-Gallimard, 2018
Foucault, Michel, Dits et écrits, Gallimard, 1978

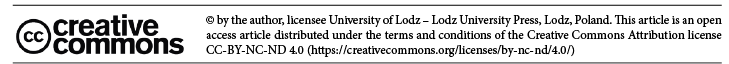
Received: 2021-09-20; Revised: 2022-03-03; Accepted: 2022‑04‑07.