

Université de Łódź
RÉSUMÉ
L’article présente l’image de la crise telle qu’elle émane de Dans le puits, texte à valeur autobiographique écrit par Rachilde durant la Première Guerre mondiale. Le livre donne accès à la perception qu’a l’auteure de la guerre, de la peur et de l’impossibilité d’écrire de la fiction en ces temps de réalité traumatique. Rachilde, d’habitude écrivaine prolifique, qui a toujours écrit au moins une œuvre de fiction par an, se trouve réduite au silence, incapable d’exprimer la cruauté de la guerre. Dans le puits est sa seule publication un peu longue de cette époque, en même temps qu’une tentative de décrire les faits à travers sa subjectivité, afin de découvrir leur vraie signification.
MOTS-CLÉS — Première Guerre mondiale, crise, Rachilde, écriture autobiographique, fiction, peur
SUMMARY
The article deals with the image of crisis as it is presented in Rachilde’s autobiographical text Dans le puits, written during the First World War. The book offers an insight into the author’s perception of the war, of the fear and of the impossibility of fiction during this time of traumatic reality. Rachilde, usually a prolific writer, who has always produced at least one fiction a year, finds herself silenced, unable to speak up about the cruelty of war. Dans le puits is her only longer publication of that time, an attempt to relate the facts through her subjectivity, in order to discover their true meaning.
KEYWORDS — First World War, crisis, Rachilde, autobiographic writing, fiction, fear
Outre sa réputation de romancière sulfureuse, Rachilde en a bien gagné une autre, celle de travailleuse acharnée, publiant au moins un roman par an, lisant une quarantaine d’ouvrages tous les mois, pour produire, toutes les deux semaines, des comptes rendus dans la rubrique « Romans » qu’elle a tenue pendant plus de vingt ans au Mercure de France. Ce flot de mots semble ne jamais se tarir, correspondant à un besoin viscéral d’écrire[1].
À une époque cependant, le silence s’installe. Dès l’entrée de la France en guerre, Rachilde interrompt ses fameux mardis ; elle arrête sa rubrique au Mercure[2] ; et, tout au long de cette période, elle n’écrit aucun roman. En 1918 sort toutefois, au Mercure de France, Dans le puits ou la vie inférieure 1915-1917[3]. Cas unique dans sa production littéraire[4], sans comparaison avec ses autres ouvrages, même ceux à caractère (auto)biographique, il s’inscrit dans la thématique de notre volume, constituant, à plusieurs niveaux, le récit d’une crise. L’extension de ce concept a été mise en évidence par plusieurs analyses, dont celles, devenues classiques, d’Edgar Morin. Si le chercheur ressentait, en 1976, le besoin de fonder une « crisologie », c’est que cette notion, à le lire, devenait « comme vidée de l’intérieur », et, qu’ayant, au départ, signifié « décision », elle évoluait vers le sens d’« indécision »[5]. Il en appelait à assumer ce nouvel état et à l’intégrer au concept de crise, afin de pouvoir en exploiter, au profit des sociétés modernes, le potentiel de révélateur et d’effecteur[6]. Cinquante ans plus tard, on n’a pas fini de cerner la notion, comme l’atteste un tout récent volume[7] où, entre plusieurs contributions de haute valeur, celle de Laure Lévêque évoque la toute fin du XIXe siècle comme le dernier moment avant que « la crise des institutions démocratiques [soit] pleinement ouverte »[8]. La Grande Guerre fut certainement cette brèche ouvrant sur un monde irrévocablement changé et en proie désormais à des crises sans cesse renouvelées, au point de devenir une constante. Mais avant d’en arriver à cette vision moderne de la crise, on pouvait encore, en plein essor d’un conflit mondial, s’attacher à ses définitions antérieures, reposant sur la notion d’arrêt, de césure entre deux périodes – celle d’avant et celle d’après[9]. C’est dans ce sens que j’interprèterai la crise qui émane du texte que je me propose d’examiner – tout en repérant sa dimension généralisante, et sans doute utile pour qui voudrait la traiter comme un avertissement pour notre monde moderne. Une autre définition, variante de la première, sera opératoire pour parler de l’état psychosomatique de la narratrice, également vu comme une période de transition entre deux phases de maladie, censée apporter un changement dans cet état[10]. Crise nationale, crise intime, crise de l’écriture – autant d’étapes qui vont me guider à travers cette analyse.
La guerre apparaît sans conteste comme une large crise, un bouleversement soudain de toutes les pratiques et habitudes. Rachilde dénonce le chaos décisif des autorités : elle critique le manque de réaction immédiate de la part de René Viviani à la mobilisation, comme elle dit, de « nos amis les Russes »[11] ; elle commente ironiquement la décision du gouvernement de quitter la capitale : « Au fond, personne n’a besoin du Gouvernement ; cependant, quand il s’en va, c’est un peu comme si on décrochait la panoplie du bureau » (151). Elle juge nuisible le mélange de gloriole et de mystère offert par les journaux où le discours nationaliste et militant côtoie les larges fragments de « blancs » censés cacher les opérations militaires[12], « les endroits où l’on sent que les armes de notre panoplie nationale ont été décrochées pour servir à on ne sait quel ténébreux complot contre la sûreté… de nos cerveaux », écrit-elle (232).
D’autre part, elle est un témoin attentif des changements que la guerre entraîne dans la vie quotidienne. Elle note la désorganisation immédiate de la routine, le facteur, le boulanger qui ne circulent plus, les « gerbes non rentrées, son grain encore par terre, le premier mort de ce premier champ de bataille » (62). Elle raconte longuement le périple de sa propre famille, sa fille, son mari et les nombreux chats et rats apprivoisés, lors de leur fuite de Paris. L’absurdité de ce parcours, sa fin qui rejoint son début, en rajoutent à l’impression générale de chaos qui ressort de toutes ces descriptions. C’est à peine si le départ des trains chargés de matériel militaire, qu’elle observe du balcon de sa maison de campagne, a l’air de « la plus belle organisation du monde au milieu du désordre inévitable » (63). Mais même cela, elle s’en rend bien compte, n’est qu’une apparence, destinée à nourrir le sentiment patriotique des Français. Aussi les convois ornés de drapeaux lui rappellent-ils « ces guirlandes bien régulières que les bouchers font à l’étal de leurs chairs primées » (63). Et, incapable de les entendre de loin, elle voit, dans sa jumelle, « le dessin de leurs cris : “Patrie ! France ! République ! À Berlin !ˮ » (63). Cette bravoure la fige dans l’horreur du sort qu’elle pressent pour les soldats. Elle juge criminel cet écart entre la vision réelle de la guerre et celle fabriquée pour les besoins de la propagande, qui captive tant de gens[13]. La guerre, note-t-elle amèrement, a « un attrait irrésistible. On apercevra du nouveau. On aura de l’appétit : l’air, ça vous creuse. Et de crier si fort, ça vous donne soif : on boira. On fait la guerre… qui vous refait » (59). Mais pour elle il ne fait pas de doute que commence « le macabre enchaînement de la tuerie » (139) qui probablement s’éternisera. Car, elle le répète à deux reprises, « on apprend à tuer. De génération en génération, maintenant. On aura le goût du sang » (17)[14]. Choquée par cette soif du meurtre, elle y cherche une raison plus profonde, précisément à l’image d’une crise qui précipiterait la sortie de la maladie : « La guerre ? Ne serait-ce pas, par hasard, un gros abcès qui crève ? Est-ce que le globe n’aurait pas besoin d’évacuer toutes ses humeurs noires ? » (142)
Toutes ses observations la mènent à une conclusion, à une réaction possible : fuir. Le mot revient à plusieurs reprises[15] et il est important pour Rachilde, qui s’est toujours présentée comme courageuse dans plusieurs circonstances de sa vie. Or, la guerre la fait réfléchir au sentiment de la peur. Assaillie par des déclarations, venant de toutes parts, du courage des guerriers et des civils, elle se demande à quel point ce courage est factice ou résulte du manque d’imagination. Pour elle, la seule appréciation possible de la guerre, c’est de constater son « infiniment grande horreur » (56) et d’avouer sa terreur à elle : « …j’ai crié, parce que j’ai eu peur tout de suite et j’ai pris le parti, plus courageux que vous ne le pensez, d’avoir peur pour tout le monde puisque tout le monde était brave » (56). Sur un plan plus personnel, elle subit aussi une crise, psychosomatique, au moment où il lui faut se préparer à quitter Paris :
Je n’ai eu peur, dans mon existence tourmentée, semée des plus cruelles aventures, ni d’un chien enragé, ni d’un cheval emballé, ni d’une femme hystérique. […] Mais lorsqu’il fallut commencer à emplir des valises où il serait contenu le strict nécessaire pour un voyage d’une durée indéterminée, cela, réellement, me causa la possible sensation physique de la peur. Cela venait comme une goutte d’amère ironie faisant enfin déborder le vase. […] C’était, à mes yeux, tellement ridicule, que j’en préférais la paralysie… (153-154)
Ce qui se produit en effet : durant 48 heures, elle demeure au lit sans pouvoir bouger, chose qui ne lui est jamais arrivée[16]. Elle y met fin en réalisant que c’est sa manière de « désert[er] à l’envers. Fuite en avant, fuite en arrière, peu importe comment on se dérobe. Le devoir de la femme est toujours plus ordinaire que les grandes circonstances. Il était urgent de revenir […] au strict nécessaire de la vie » (156).
Elle traverse donc les étapes de plus en plus insensées de leur exode qui les fera vagabonder, elle et sa famille, en province durant quelques mois, pour enfin revenir à la capitale. Et c’est alors que la romancière décide d’effectuer sa fuite personnelle : elle refuse de rentrer à Paris et choisit de vivre seule dans leur maison à la campagne[17], où son mari – « le bon compagnon » comme elle l’appelle – ne reviendra que pour les fins de semaine. Ainsi commence pour elle
Avant d’examiner les aspects de cette infériorité, il convient de comprendre les raisons de la choisir. Car il s’agit bien d’une décision raisonnée quoique découlant également des émotions. Le sentiment le plus vif est celui de l’impossibilité de continuer à vivre comme avant. Et la sensation qu’on est seule à percevoir cette impossibilité, seule contre tous ceux qui s’obstinent à conserver le style de vie d’avant la guerre en y voyant une preuve de courage. Le livre s’ouvre (et se ferme) sur l’image symbolique du puits où la narratrice a l’impression de descendre, incapable de se maintenir à la surface et de supporter « l’hypocrisie de cette période angoissante où chacun tâchait de persuader à l’autre que tout était pour le mieux », consciente qu’elle est « toute seule à descendre si bas » (6). En effet, elle souligne à plusieurs reprises le caractère isolé de ses opinions et démarches, qui vont à l’encontre de celles de la communauté. Le slogan général étant de « tenir », elle s’y oppose en jouant sur le mot : « ce verbe indique un appui matériel, un bâton, un fusil, une rampe, un livre, quelque chose enfin à quoi l’on tienne. Or, personnellement, je ne tiens [à] rien du tout et je ne tiens pas qu’on tienne à moi. L’idée de simple cohésion m’horripile » (31)[18]. Le vocable d’individu[19], qu’elle choisit pour parler d’elle-même, accentue encore davantage l’opposition entre elle et les autres : « On se mit à rire de l’individu qui osait songer à la possibilité d’une guerre longue, d’une guerre kolossale¸ alors que la bonne société n’y songeait pas » (68). Elle s’éloigne ainsi de ceux qui sont restés à Paris, refusant d’adopter leur attitude, « exaspérant[e] de tranquillité, sinon de parfaite inconscience » (31). Elle y détecte une fausseté qui lui répugne, elle qui pourtant était jadis capable de grands gestes théâtraux et publics. Parlant des femmes qui, en temps de paix, composaient son cercle et qui continuent leur vie d’autrefois (« par devoir »), elle constate : « Elles et moi nous vivons dans un mensonge, mais, moi, en fuyant la société qui tient…à le propager, je respire » (33). Elle semble ainsi retrouver sa liberté, revenir à elle-même. En se rappelant son « ex-frivolité » (32) qui la caractérisait lors de sa vie parisienne, elle l’interprète à présent comme une sorte d’oubli de soi-même, de concession de sa propre volonté[20]. Ainsi s’explique le sens de sa descente dans le puits où elle découvre un personnage énigmatique, à l’aspect vaguement féminin, nu et suintant l’humidité qu’il est permis d’identifier comme la Vérité[21]. En la retrouvant, la narratrice commence une vie nouvelle, où elle n’entend « servir que la nature qui, seule, a des droits sur nous » (24)[22]. Et c’est elle qu’elle choisit pour ce temps de crise : « Je ne comprends plus ma vie intellectuelle et lui préfère ma vie inférieure » (33).
Ce choix n’élimine pas la souffrance. La conscience de la guerre accompagne le sujet parlant au quotidien, lui fait confronter chacun de ses gestes à la tragédie qui dure, comme lorsqu’elle refuse de se chauffer par attention aux soldats dans les tranchées[23] ou quand elle nettoie la basse-cour, « les mains sans gants, les pieds dans les sabots, […] avec ma robe déjà ourlée de boue » (87). Mais c’est surtout la conscience de rester en vie au milieu de tant de victimes : « Mais pourquoi est-ce que je vis, pourquoi ai-je le droit de regarder le jour en face alors que sont fermés les yeux des jeunes morts qui sont encore dans la nuit, qui seront éternellement dans la nuit ? » (51) Et l’inquiétude, que peut-être elle demeure toujours dans le faux, en dépit de ses prétentions à la sincérité, puisqu’« [i]l est facile de renoncer au monde, à ce à quoi on tient le moins. Ce qui m’est le plus cher, ici, c’est le silence […]. Est-ce que je ne devrais pas sacrifier aussi la tranquillité de ma retraite ? […] Il me faudrait, pour mon purgatoire […] une lutte perpétuelle contre mes goûts, une emprise sur toute ma volonté et moi cédant toujours de plus en plus liée, sinon vaincue, par la conscience » (79).
C’est ce qu’elle connaîtra peut-être[24], en définitive, veillant sur la « femme-fantôme », un personnage mystérieux et inquiétant qui vit dans sa propriété, le mari parti faire la guerre. La femme a trois enfants et en attend un quatrième, mais son attitude farouche et le silence dont elle entoure sa grossesse font que Rachilde s’inquiète pour le sort du fœtus. Aussi, en dépit de sa répugnance pour la femme-fantôme, décide-t-elle de s’instaurer sa gardienne : « Je l’aurai vivant, le petit dont elle ne veut pas. Il faut qu’il naisse et c’est à moi de le porter dans mon cerveau. On fait ce qu’on peut. Ce n’est pas un guerrier de plus que j’offrirai à mon pays, mais un futur travailleur[25] » (236). Ce qui ne l’empêche pas d’avoir des paroles de révolte contre le sort des femmes obligées, telles des bêtes, « à la parturition forcée » (237) et ne connaissant de droits que ceux de l’homme (238). Elle veut garder cet enfant en vie surtout pour sa propre tranquillité d’esprit. En ce temps de mort universelle, perdre une existence de plus semble un crime trop grave pour sa conscience. D’où aussi son refus de tirer sur un homme qui, une nuit, fait intrusion dans sa cour. Il s’avère le lendemain qu’il s’agissait d’un déserteur que « la femme-fantôme » massacrerait, à l’entendre, sans hésitation, pensant à ceux qui luttent à sa place. Et la narratrice de réfléchir : « A-t-elle raison ? A-t-elle tort ? Ma mansuétude est-elle plus ridicule en temps de guerre que son accès de fureur ? Qui oserait me répondre ? […] J’aime encore mieux donner la vie… » (252)
De vies, mais non humaines, elle a plusieurs à sa charge. Entourée de chats, rats, chiens, lapins et de toute une basse-cour, elle se doit de les nourrir et protéger. Les animaux ont une grande importance pour Rachilde dès sa plus tendre enfance, elle en parle toujours avec attention et attendrissement. Dans cette vie inférieure qu’elle a choisie, elle est non seulement leur protectrice, mais se sent l’une d’entre eux : « Nous sommes, ici, des tas de frères inférieurs obligés à la vie en commun. Tâchons de démontrer à l’homme que nous pouvons, nous, les bêtes, avoir l’esprit de savoir nous borner… sans écrire ! » (93)
« Sans écrire » – ces mots referment un chapitre pour être repris au début du chapitre suivant, et commentés : « Sans écrire ? Je n’appelle pas écrire penser tout haut, sur ce papier, dont je ne ferai rien, ni pour moi ni pour les autres et qui ne servira pas la cause littéraire, en honneur, en ce moment, dans la vie parisienne » (94). Nous l’avons déjà vu, Rachilde se sent étrangère à cette vie, qui lui est devenue insupportable à cause de sa fausseté. Or la sincérité semble lui importer avant tout : toute interprétation, tout ajout sont en quelque sorte obscènes. Devant les écrits sur la guerre, y compris ceux des écrivains, elle a un sentiment de superflu, voire d’inutile : « Une chose trop vaste ne peut pas, ne doit pas, être embrassée avec cette frénésie. Je crois que la censure est une demi-censure maladroite : il fallait tout couper, surtout les informations à côté, le pittoresque. […] Ah ! pourquoi ne s’est-on borné à un communiqué officiel sincère, tout nu, la conscience de toutes nos consciences ? » (53)
Attentive aux mots, lectrice invétérée, en ce temps de crise, elle réagit encore et toujours aux mots. Le sérieux, le tragique de la guerre devrait, selon elle, imposer un silence digne de cette circonstance grandiose à tous ceux qui se prononcent à ce propos, sans en avoir vraiment le droit. D’autant que ce qu’ils disent, soupçonne-t-elle, est peut-être dicté par des « mots d’ordre » qui viennent des autorités désireuses d’encourager le sentiment patriotique. Et, face à la guerre, les manifestations de courage de la part des civils qui ne courent aucun danger lui semblent une sorte de trahison vis-à-vis des soldats qui meurent au front : « Je ne crois pas à la beauté d’une fiction lorsqu’il s’agit d’égarer les masses. Quoi qu’il arrive, mentir, même dans la meilleure intention, c’est trahir et mentir en temps de guerre, c’est trahir deux fois » (54). Signalons aussi cette formule par laquelle elle commente certaines élucubrations de la presse et qui est en lien direct avec le titre de notre volume : « Le lecteur est un peu commotionné quand il a passé par cette ambulance spirituelle où l’on panse des maux avec des mots » (232).
Pour sa part, cette romancière prolifique déclare ne plus savoir écrire : « La fiction, en présence de la réalité, me paraît un crime qui permet à l’autre crime de s’étaler plus monstrueux, plus terriblement invraisemblable. Quiconque ose écrire un roman me fait l’effet d’une main inopportune agitant un éventail, un écran, en face d’un incendie » (41). Elle opère une distinction entre la littérature qui « est un luxe », et celle qui « demeure un état d’âme » : seulement la deuxième a encore droit d’exister, à condition de « nous conduire à la réalité. Les histoires que nous racontons sont bonnes pour endormir les peines, mais elles sont mauvaises quand elles endorment aussi les consciences » (100)[26]. C’est également pourquoi elle refuse de prendre part à toute forme de propagande, en utilisant sa plume à encourager les combattants : « être complice est plus lâche à mon avis qu’être bourreau » (147) ; « je dis ces choses comme je les pense, je les pense comme une femme, instinctivement, sans me demander d’abord s’il est bon de les écrire et ce qu’elles rapporteront à mon patriotisme. S’il y a des mots d’ordre, je ne les connais pas et ne veux point les connaître » (53). Pour qui connaît les vues politiques antérieures de Rachilde et de son milieu[27], une telle attitude, résolument pacifiste, a de quoi surprendre.
Ce qui compte peut-être davantage ici, du point de vue de l’analyse de la crise, c’est le mutisme bien réel qui a dû affecter l’écrivaine au cours de l’automne 1914. Non seulement la précision donnée dès le titre – 1915-1917 – suggère le temps de la rédaction, mais encore les événements qui ont eu lieu avant cette date sont évoqués de mémoire et rédigés au passé. Or pour Rachilde écrire est un besoin vital : « Chez moi, il n’y a pas d’art d’écrire. La littérature fut mon infirmité dès mon plus bas âge. Je m’en suis cachée, dès son début […]. Je n’ai jamais rien trouvé à louer dans cette fonction d’un cerveau sans cesse obsédé d’images » (102). La guerre la frappe, dès le début, par l’abondance d’images que son imagination lui met sous les yeux[28]. L’impossibilité de le coucher par écrit doit signifier pour elle l’une des plus profondes crises, qu’elle met du temps à adoucir. La conversation avec le personnage rencontré au fond du puits est très probablement une relation métaphorique du point culminant de cette crise qui, dès lors, semble changer de forme et permet le retour à l’écriture. Par ailleurs, la description de cette personne mystérieuse, « pas belle » (7), tournant en rond dans « ce cachot obscur, demi-prison, demi-tombe » (8), ses cheveux pareils aux algues ou « au serpent d’écailles d’or » (256), « nue et luisante comme la nacre qui vient de la mer » (254) offre un exutoire à l’imagination longtemps comprimée de l’écrivaine[29].
Mais à part cette seule extravagance, elle limite son tempérament de romancière, tout à fait consciemment[30]. Suivant le conseil obtenu au fond du puits, elle écrit en s’accrochant à la réalité, elle la restitue au quotidien sans l’embellir, et le récit lui-même s’y soumet, en épousant la forme de sa pensée, au fil de la plume, côtoyant parfois le monologue intérieur. C’est péniblement qu’on y trouve des chapitres de longueur inégale qui paraissent d’ailleurs aménagés après coup, pour la publication. D’autre part, on observe le désir de ne rien modifier à l’état premier du texte ce dont témoigne telle note de bas de page : « J’ai écrit cela en 1916. Je n’en veux rien retrancher » (79). Le texte vise cependant des lecteurs – et plutôt qu’une formule de ses chroniques du Mercure, ou le besoin de s’adresser, dans sa solitude, à quelqu’un, il semble qu’il faille y voir encore l’expression de son individualisme farouche. Convaincue que ses opinions vont à l’encontre des vues générales sur la guerre, elle affronte également son lecteur, soupçonné d’être son juge condescendant, qui la prend pour une hystérique ou une folle : « Ne souriez pas. Je sais où je vais. Ce n’est pas à la gloire certainement » (57) et n’invite à sa table que ceux qui sont prêts à y goûter le « pain de guerre » (47), ou encore « le détail sauvage » (55), le seul récit dont elle est à présent capable, mais qui « contient souvent l’image du monde » (55).
La peur, la fuite – nous l’avons vu – sont les mots qui conduisent la narratrice à travers ce récit. Ils prennent corps surtout dans ce renoncement à l’écriture, qui la plonge au sein de la vie inférieure, au fond du puits. Mais si elle refuse d’inventer, se limitant à observer et à reproduire le plus fidèlement possible, elle se fait un devoir d’« examiner sa conscience » – troisième mot à revenir fréquemment[31] – et de la garder éveillée, de ne pas la berner par des paroles mensongères. C’est pourquoi la fiction devient impossible – et aussi parce que la réalité la dépasse. Cette vie inférieure ne signifie cependant pas une perte de sensibilité ou d’acuité de perception. C’est avec ses sens de romancière que Rachilde observe et traduit en paroles ce qu’elle constate autour d’elle. C’est peut-être aussi pour cela que la naissance de l’enfant a pour elle une telle importance. Le petit garçon n’est-il pas une création qui remplace ses ouvrages ? Ne devient-il pas sa petite contribution, plus importante que ses fictions en ce temps où la vie humaine compte pour si peu ? Ce qui est sûr, c’est qu’il préside à la clôture de l’histoire : lorsque la femme-fantôme fait observer à la narratrice que « les hommes ne valent pas mieux que les femmes », vu la manière dont ils utilisent leur force, celle-ci constate : « C’est peut-être la morale de l’histoire, de mes histoires, de toutes mes histoires ! » (253) Il semble qu’à rechercher cette morale, elle obtient cette « visée universalisante » dont parle Lucienne Frappier-Mazur et qui, paradoxalement, consisterait à ne pas utiliser « certains modes de distanciation que [la romancière] a toujours pratiqués dans ses romans » et à « mett[re] en vedette son énonciation féminine[32] et […] sa propre subjectivité au moment où elle ambitionne un vrai passage à l’universel »[33]. S’en prenant au cataclysme de la seule manière qui lui soit possible, par l’écriture, Rachilde arrive, par un effort remarquable de sincérité, à le cerner – en le pensant. Cet effort a-t-il suffi pour panser la crise ? On peut en douter, surtout face à d’autres crises qui n’ont pas tardé à venir. Mais cent ans plus tard, au milieu de nos crises modernes, la lucidité de Rachilde ne semble pas une posture périmée.
« Dits, œuvres et opinions de Madame Rachilde : bouquet réuni à l’occasion du trentième anniversaire de son occultation », Organographes du Cymbalum pataphysicum, no 19-20, Paris, Viridis Candela, 1983
Bouron, Françoise, « Censure et dessin de presse pendant la 1e guerre mondiale », in Les Médias et la guerre, sous la dir. d’H. Coutau-Egarie, Sorbonne, Economica, 2005, p. 432-445
Charasson, Henriette, « La Vie littéraire. Des livres de femmes », Le XIXe siècle, 10 mars 1919, p. 4
Dauphiné, Claude, Rachilde, Paris, Mercure de France, 1991
Forcade, Olivier, La Censure en France pendant la Grande guerre, Paris, Fayard, coll. « Histoire », 2016
Frappier-Mazur, Lucienne, « Rachilde : allégories de la guerre », Romantisme, 1994, no 85, « Pouvoirs, puissances : qu’en pensent les femmes ? », p. 5-18, https://doi.org/10.3406/roman.1994.6226
Holmes, Diana, Rachilde. Decadence, Gender and the Woman Writer, Oxford-New York, Berg, 2001
Lévêque, Laure, « Camille Mauclair et la crise de la conscience européenne : L’Orient vierge, roman épique de l’an 2000 (1897) entre renaissance orientale et déclinisme occidental », in Pour une histologie de la crise, sous la direction scientifique de Laure Lévêque et Anita Staroń, Arcidosso, Effigi Edizioni, 2021, p. 139-151
Morin, Edgar, « Pour une crisologie », Communications : « La notion de crise », 1976, no 25, https://doi.org/10.3406/comm.1976.1388
O’Brien, Catherine, « Beyond the can[n]on: French women’s responses to the First World War », in French Cultural Studies 1996, VII, p. 201-213, https://doi.org/10.1177/095715589600702008
Rachilde, À mort, Paris, Monnier, 1886
Rachilde, C. R. d’Henri Barbusse, Le Feu, Mercure de France, 1 février 1917, no 447, p. 493
Rachilde, C. R. de René Boylesve, Tu n’es plus rien, Mercure de France, 16 mai 1918, no 478, p. 300
Rachilde, Dans le puits ou la vie inférieure 1915-1917, Paris, Mercure de France, 1918

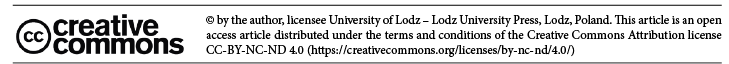
Received: 2021-11-20; Revised: 2022-02-25; Accepted: 2022-04-05.