

Université de Varsovie
RÉSUMÉ
Le thème de l’animal dans la littérature contemporaine répond au besoin de faire face à une crise de l’humain, amenée par une globalisation sauvage et une marchandisation de la vie qu’accompagnent une mise à mal de plus en plus menaçante de la planète que l’homme détruit dans sa poursuite du gain et dans son triomphalisme revendiqué. La littérature réagit à cette action destructrice de l’anthropocène et travaille à restituer à la nature et à l’animal la présence qu’ils ont toujours eue à côté de l’homme, mais que l’homme a irrespectueusement sous-estimée. L’article étudie le cycle Les Petits Dieux de Sandrine Willems et se focalise notamment sur la représentation du rapport entre le monde humain et le monde animal. Il s’agit de voir comment l’écriture de Willems thématise l’idée de l’espace partagé, de la rencontre, du regard et du sens qui découle du croisement des destins humains et animaux. La réflexion de Jean-Christophe Bailly nourrit les analyses présentées dans l’article.
MOTS-CLÉS — Sandrine Willems, Jean-Christophe Bailly, crise, animal, espace partagé
SUMMARY
The theme of the animal in contemporary literature responds to the need to deal with a crisis of the human, brought about by a savage globalisation and commercialisation of life, accompanied by an increasingly threatening destruction of the planet, which man is destroying in his pursuit of gain and undeserved triumphalism. Literature reacts to this destructive action of the Anthropocene and works to restore to nature (including the animal) the presence it has always had alongside man, but which man has disrespectfully underestimated. The article examines the cycle Les Petits Dieux by Sandrine Willems and focuses in particular on the representation of the relationship between the human and animal worlds. The aim is to see how Willems’ writing thematizes the idea of shared space, of the encounter, of the gaze and of the meaning that arises from the crossing of human and animal destinies. Jean-Christophe Bailly’s reflection feeds the analyses presented in the article.
KEYWORDS — Sandrine Willems, Jean-Christophe Bailly, crisis, animal, shared space
« Chaque animal est un frémissement de l’apparence et une entrée dans le monde.
Chaque entrée dans le monde est un monde, un mode d’être au monde [...] »[1]
Il y a quelque chose d’angoissant dans le fait que le thème de ce colloque imaginé par nos collègues il y a déjà quelque temps n’ait rien perdu de son actualité. Plus encore, les raisons pour lesquelles il acquiert une importance toute particulière se sont encore multipliées au cours de cette dernière année. La crise pandémique a profondément modifié nos modes de vie, labouré nos consciences, mis à découvert nos faiblesses, elle nous a forcés à repenser nos priorités, elle a dévoilé notre fragilité et, enfin, elle nous a, peut-être, sensibilisés à l’état de la nature et nous a rendus, peut-être, plus attentifs au monde. En effet, dans différentes tentatives d’expliquer la généalogie de la crise du coronavirus, elle a également été mise en rapport avec le monde animal ; elle s’est donc de cette manière doublée d’une autre crise, en cours depuis des décennies, celle qui affecte notre environnement. L’animal est au cœur de cette crise qui semble être due, pour le dire en termes très généraux, à une crise de la sensibilité. Baptiste Morizot, dans son ouvrage Manières d’être vivant (2020), explique cette dernière comme « un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre, et tisser comme relations à l’égard du vivant »[2]. Le problème central est pour lui l’habitude narcissique de l’homme de conférer au vivant un statut subalterne de « décor », de « ressource », de « lieu de ressourcement » ou bien encore « un support de projection émotionnel et symbolique »[3]. Or, une telle attitude qui entraîne l’irrespect et l’irresponsabilité, devenue un mode de vie et une politique, est à l’origine des ravages qui menacent le monde des humains et qui sont en passe de le détruire. Parler du vivant, et notamment du vivant non-humain, lui accorder une place d’importance est donc une manière d’essayer de panser la crise qui affecte le monde humain. L’animal est l’enjeu d’une mutation qui se laisse observer dans différents domaines de la vie sociale et dont l’essentiel consiste à rappeler à l’homme ce qu’il oublie trop souvent, à savoir qu’il partage le monde avec d’autres êtres.
La littérature est bien évidemment là pour rendre compte de ce déséquilibre, dénoncer les méfaits de l’homme, sensibiliser le public, mais aussi pour œuvrer à inventer des manières de penser l’homme dans son rapport fondamental au vivant, y compris à l’animal ; proposer des moyens de mettre fin à ce que Jean-Christophe Bailly appelle « le narcissisme d’espèce »[4] ; chercher des lieux de rencontre, des voies d’accès à cet univers dont nous sommes cohabitants ; inventer enfin des langues ; formuler des sens[5].
Parmi les nombreux auteurs (critiques, penseurs, philosophes) qui se penchent sur la problématique de cette crise de sensibilité écologique ou environnementale, nous aimerions distinguer Jean-Christophe Bailly auquel le sujet de l’animal est particulièrement cher, et cela depuis le début des années 1990[6]. Pour éclairer notre propos, nous nous référerons à deux de ses ouvrages : Le Parti pris des animaux (2013) et Le Versant animal (2018). Dans ces deux livres, il insiste, en effet, sur la nécessité de sortir de « l’exclusivité humaine »[7] qui installe l’homme au cœur de toute pensée. Dans Le Parti pris des animaux, il encourage à abandonner « l’idée d’une compétence humaine qui serait seule régulatrice et lucide »[8], idée qui empêche l’ouverture au sens que nous communiquent des animaux. « Qu’on en finisse, enchaîne-t-il dans Le Versant animal, avec ce credo sempiternellement recommencé de l’homme sommet de la création et unique avenir de l’homme », responsable de notre surdité aux autres êtres vivants et de notre sentiment de solitude. Il réfléchit finalement sur la langue qu’il faudrait retrouver ou inventer, une langue susceptible de rendre notre relation aux vivants non-humains plus épaisse, capable aussi de conférer à l’animal une sorte de plénitude, de « pensivité »[9], dit Bailly, donc une présence concrète que l’on ne saurait ignorer. Impossible de ne pas voir dans cette réflexion de dimension critique, voire militante. Elle se situe au cœur des préoccupations qui, liées aux changements climatiques et à la sixième extinction de masse, émergent de plus en plus dans le débat public.
De cette vaste réflexion, nous retiendrons deux moments qui nous seront particulièrement utiles dans notre analyse de l’œuvre de Sandrine Willems[10]. D’abord, l’idée de partage, qui englobe celles d’ouverture, de croisement et de limite, et qui renvoie à l’espace et à l’expérience commune. Bailly est, en effet, persuadé que la frontière entre le monde humain et le monde animal est flottante : tantôt elle s’efface pour permettre des passages et des interférences, tantôt elle se fait étanche et révèle davantage des incompatibilités.
La deuxième idée, qui découle de la première, touche à la rencontre : le plus souvent furtive, éphémère, une « présence absentée », comme le dit Bailly, nourrie de « l’éclipse, [de] l’intermittence, [de] l’effacement »[11], mais aussi, une rencontre plus durable, renouvelée, susceptible de tisser un lien. Une rencontre qui fait place au regard, à l’échange de regards, substitut d’un langage apparemment impossible. Et qui est de plus génératrice de sens, d’un sens qui se forme pour nous dans le prolongement de la rencontre, l’animal représentant l’ouverture à quelque chose d’autre, d’indéfini ou d’indéfinissable pour l’instant, de crucial peut-être ; d’un sens également auquel nous n’avons pas accès, car le côtoiement du monde animal nous révèle aussi nos limites ; d’un sens enfin, d’ordre esthétique ou poétique, qui relie le monde animal et le monde humain dans une sorte d’élan créateur commun.
Ces deux idées – partage et rencontre – que complète celle d’un sens qui se forme, seront les vecteurs de notre analyse du roman de Sandrine Willems Les Petits Dieux, publié entre 2001 et 2002. Il s’agit, en effet, d’une série de onze romans-miniatures dont chacun présente un personnage historique ou mythique en compagnie d’un animal. On trouve ainsi dans cette série Artémis, Abraham, Saint Jérôme, Nietzsche, les personnages fictifs de Carmen ou de Tchang (un héros de Tintin), les artistes Chardin, Borgès et Franju. Chacun de ces romans met en scène le personnage éponyme qui s’exprime à la première personne, sous forme, par exemple, d’un journal intime (comme pour Borges) ou d’une lettre (Carmen écrit à Georges Bizet et Chardin à Denis Diderot).
L’idée de partage renvoie donc d’abord, chez Willems, à l’espace. Dans Les Petits Dieux, nous en trouvons quelques exemples intéressants dans la mesure où ils révèlent l’ambiguïté inhérente à l’espace que nous avons en partage avec des animaux. Quatre cas de figure sont à envisager sous ce rapport : le jardin zoologique, la chasse, le corrida et l’abattoir. Chacun de ces espaces suppose, en effet, l’existence d’une frontière apparemment infranchissable et instituée par l’homme entre un monde humain de prédateurs et de dominateurs, et un monde animal de victimes prisonnières et exploitées. Les récits de Willems nous montrent néanmoins que cette frontière n’est pas si étanche que l’on pourrait le croire, et que le statut de dominateurs et de dominés n’est pas non plus immuable. L’auteure nous invite à regarder de près les moments où se croisent les destins des deux parties et à y discerner la possibilité d’une ouverture vers quelque chose d’autre, qu’il s’agisse de se regarder autrement ou d’en revenir à une forme de cohabitation perdue.
Lorsque le héros de L’Homme et les loups (patient de Freud[12]) visite le jardin zoologique de Vienne, il exprime le désir d’être enfermé comme les animaux qui s’y trouvent : « [...] je veux que mon espèce aussi soit représentée, afin de compléter vos taxinomies »[13]. Refusant l’exceptionnalité humaine, une égalité de statut s’exprime, une communauté de destin s’affirme. Il considère, en effet, les animaux en cage comme ses frères dont il partage la condition de prisonniers et, également, celle d’exilés, lui-même étant originaire des taïgas, banni de son pays par la révolution et coupé de ses racines. Il partage aussi les rêves qui les transportent au-delà de cet espace imposé, piètre copie des lieux de leurs vies antérieures. Sandrine Willems, dans le « Mot de l’auteur » que publient sur leur site Internet les éditions Impressions nouvelles, ne cache pas la visée écologiste des textes formant le cycle des Petits Dieux et s’installe volontiers dans le vaste courant de la réflexion sur les « lignes de démarcation » entre le monde animal et le monde humain. Elle se sert, dans L’Homme et les loups, de ce personnage, prétendument fou, pour dénoncer justement les comportements humains invasifs et nuisibles qui font tenir les animaux « à distance pour que notre raison n’en soit pas dérangée »[14]. Le héros dit ceci à propos de ceux qui enferment des lions en cage « pour leur faire payer un cuisant complexe d’infériorité » :
Ils feraient mieux de pleurer, afin de marquer leur unique supériorité : les hommes, paraît-il, ont entre toutes les bêtes les plus grosses des glandes lacrymales. Mais qu’ils cessent de se prendre pour la providence, et la conscience de ceux qui n’en ont pas[15].
L’Homme et les loups se présente comme un véritable plaidoyer dénonciateur des ravages que l’enfermement produit chez des animaux. Le héros observe « les oiseaux qui s’arrachent les plumes », « le chimpanzé qui secoue sa cage comme un forcené », « la gazelle, qui frappe la grille de son front, jusqu’à ce qu’il s’ouvre », « la panthère, qui se gratte à se faire saigner, et [...] remâche une chasse dans la savane »[16]. Le zoo lui paraît être l’ultime preuve de la souffrance que le genre humain inflige à l’animal, rien qu’en lui enlevant la possibilité de ce que Bailly définit comme « le libre passage de la visibilité à l’invisibilité, qui est comme la respiration même du vivant »[17]. Le jardin zoologique impose la visibilité et la surveillance permanente : « Certains nouveaux venus en meurent au bout de quelques jours, après avoir vainement cherché un coin où se cacher [...] »[18].
Le plaidoyer exprimé dans L’Homme et ses loups place le lecteur face à une question fondamentale pour la crise de sensibilité dénoncée par Morizot : celle de la distance toujours croissante entre l’homme et l’animal. Loin de rendre la présence animale plus proche ou plus familière, le zoo, création éminemment artificielle, ne fait que creuser le fossé. John Berger l’explicite bien dans sa contribution à la Philosophie animale (2015) quand il dit que « le zoo, où les gens se rendent afin de rencontrer, d’observer, de voir des animaux, matérialise en fait l’impossibilité de telles rencontres »[19]. Car le zoo humilie et marginalise l’animal, le vouant à une existence qui n’a rien de commun avec son entourage authentique et qui, au bout du compte, lui fait « adopter cette attitude exclusivement humaine qu’est l’indifférence »[20]. Les conclusions de Berger rejoignent notre propos et mettent en évidence le lien entre l’état des relations entre l’homme et l’animal et une certaine crise des relations sociales. Berger considère, en effet, que la marginalisation de l’animal observée dans le zoo a pour conséquence « la marginalisation et l’élimination de la seule classe qui, tout au long de l’histoire, a gardé un lien de familiarité avec les animaux, et a conservé la sagesse qui en découle : la paysannerie, petite ou moyenne »[21].
Le territoire de la chasse est un autre lieu évoqué par Willems où s’entrecroisent les destins des hommes et des animaux. S’y entremêlent de grandes passions et valeurs telles que la pitié, la responsabilité, le regret, l’amour, le dévouement, la peur – propres tant aux chasseurs qu’aux traqués. C’est un territoire que se partagent, d’une part, la vie la plus débridée et la plus épanouie, et de l’autre, la mort ; où se révèlent à la fois la puissance et la faiblesse de l’homme. Le récit Artémis et le cerf met en lumière l’ambiguïté fondamentale de la chasse qui, loin de révéler la supériorité de l’homme, en dévoile, au contraire, la misère qui se traduit, d’abord, dans l’ignorance de la langue dont se servent les animaux pour baliser leur terrain, et, ensuite, dans la peur de la mort que les animaux ignorent. Étranger et aveugle sur ce terrain que sillonnent des pistes animales éphémères, marqué par des traces illisibles pour lui, l’humain en est réduit à tuer, ce qui est pour lui la seule manière de s’imposer en vainqueur. Mais c’est une victoire illusoire : « toujours il échoue, les fauves seront toujours plus puissants, car eux ignorent souverainement la mort, l’homme ignorant seulement la saveur que celle-ci donne à sa vie »[22]. Les animaux sont, comme le dit Bailly après Rainer Maria Rilke, « libres de mort », c’est-à-dire vivant dans l’ouvert libérateur : « L’ouvert, écrit Bailly, n’est que l’éternelle présentation au présent et il est, comme tel, sans passé et sans avenir [...] »[23]. Les animaux vivent et meurent au présent, dans une forme, à la fois, d’insouciance et d’intensité.
Les récits de Willems nous disent bien le défi que représente pour nous cet espace partagé avec les animaux, qu’il soit celui de la chasse, de la corrida ou tout autre. Comme nous le faisons pour les lieux que nous traversons, les animaux impriment leurs traces sur l’espace ; ils laissent des signes, des messages, des appels, tout un langage qui reste pour nous le plus souvent obscur et que nous sommes enclins à interpréter trop souvent de manière biaisée[24]. Dans Carmen et le taureau, l’héroïne parle de la corrida dont elle est, bon gré mal gré, une habituée, comme d’une mise en scène réalisée dans l’ignorance complète du langage animal ou, ce qui est pire, en dépit de ce langage qu’avec un rien de bonne volonté on pourrait comprendre :
Le matador [...] outrepassa cette frontière imaginaire, et provoqua la bête de sa mante rouge pour qu’elle s’y engouffre comme en son propre sang. Si elle se laissait berner, et fonçait sur le leurre plutôt que sur l’homme, on la proclamerait brave ; sinon, elle serait qualifiée de féroce. Or le taureau voit mal, ses yeux sont mal placés, il doit tourner la tête, et prendre du recul, pour discerner ce qui se passe. Le torero peut donc tout à loisir devancer l’offensive [...]. La bête écume, mais c’est de peur et non de rage, elle demande grâce, mais on feint de l’ignorer, elle ne sera graciée que si elle tue un homme, et cela elle s’y refuse. Alors elle baisse la tête, et s’arrête. Le torero, cependant, veut en finir, et il l’appelle, pour montrer que c’est elle qui a envie de mourir. Alors elle vient, docile, une dernière fois, comme en un pré, voulant une dernière fois prouver sa fidélité, à ce maître imbécile. Et celui-ci trace dans sa gorge une croix, car il est bon chrétien, et y plonge l’épée[25].
L’extrait n’est pas le seul à dénoncer cette résistance de l’homme devant le langage de l’autre, résistance qui, au bout du compte, se fait complice du crime. Le récit retrace l’évolution du personnage qui, d’abord témoin de ces spectacles sanglants, en devient, en tant que torera, une actrice principale pour ensuite, ayant découvert une communauté de destins et d’expériences (la mort sur l’arène), décider de venger des animaux. À la fin, Carmen mène une vie paisible au milieu des vaches, « ces humiliées qu’on mange » et qu’elle « avai[t] volées aux abattoirs »[26].
Le partage, mode privilégié de notre rapport au vivant, exige donc la responsabilité, celle-là même que nous devons aux membres de notre famille. C’est ainsi que Willems montre les relations possibles entre les hommes et les animaux. Plusieurs récits présentent ces derniers comme frères, membres de la famille, voire congénères, ce qui rend pour le moins floue toute frontière supposée entre les mondes. On le voit par exemple dans Abraham et l’agneau où le héros éponyme déclare avoir survécu « par [ses] brebis » : « Enfouissant mes tristesses dans leur toison, le soir, quand tout dormait. Dormant contre elles, puisque ma femme, ma sœur ne voulait plus de moi. Me revêtant des peaux de celles qui mouraient, et me nourrissant de leur lait »[27]. Dans un autre roman, Tchang et le Yéti, le héros se voit adopté par le Yéti qui reverse sur lui son instinct inassouvi de parent. Ce côtoiement du singe, tendre et protecteur, incite le héros à regarder d’un œil critique la manière dont les hommes jugent les yéti (et peut-être tous les fauves qu’ils ne connaissent pas) : « Telle est l’humanité, qui prétend sanguinaires ses propres martyrs »[28].
L’animal est présenté comme « frère », car malgré les nombreuses différences qui le séparent de l’homme, il lui ressemble par ses besoins, ses réflexes, ses manières de vivre parfois. C’est ce que Chardin explique dans sa lettre à Denis Diderot dans le récit Chardin et le lièvre quand il lui rend compte de la différence entre les lapins et les lièvres :
Si je le sais si bien, c’est de leur ressembler : un lièvre n’a pas de terrier, il vit dans les buissons et les rochers – et moi, dans la cité, je suis un exilé ; le lièvre ne peut digérer que ce qu’il a déjà recraché – et moi, de tableau en tableau, je ressasse mon unique souci ; enfin mon frère se dépouille en hiver de toutes ses couleurs – de même, régulièrement, je lâche mes pinceaux par découragement[29].
Sandrine Willems propose un autre parallèle qui établit un rapport spéculaire entre le monde des humains et le monde des animaux. Dans Franju et le porc où elle donne la parole à Georges Franju, Willems retrace le chemin qui mène le réalisateur à son premier court métrage sur les abattoirs (Le Sang des bêtes, 1949). À l’image de l’animal se superpose, dans le parcours du cinéaste, celle de l’homme, du Juif, traqué, humilié, annihilé : « Afin de m’immerger par étapes, je filmai d’abord les convois qui amenaient les bêtes. Ces trains-là en rappelleraient d’autres, où les Juifs étaient entassés à l’égal du bétail, manquant d’eau comme d’air »[30].
Franju et le porc, en dehors d’offrir l’image d’une communauté d’expérience et de destins entre les humains et les animaux[31], propose aussi une réflexion sur le regard, et notamment sur le regard de l’animal mis à mort par l’humain, un regard qui témoigne d’une « crise de la familiarité avec les animaux »[32]. Le narrateur de Franju et le porc décrit ainsi le croisement des regards dans un abattoir, moment qui signe une rupture radicale des liens entre les univers humain et animal : « C’est là que regarder devient un supplice. Moi je n’avais jamais vu de si près l’œil d’un mouton, je ne savais pas que la pupille en est aussi rectangulaire qu’un écran, et opaque comme un miroir nous renvoyant nos crimes »[33].
Le regard, dans Les Petits Dieux, est le lieu de la rencontre avec l’autre, c’est là que l’énigme s’installe qui nous renvoie à notre impuissance d’aller plus en profondeur, de comprendre, et qui nous force à formuler des réponses incomplètes et imparfaites. Le regard est cette ouverture au sens possible que nous devinons comme tel, mais qui refuse de se former. Jean-Christophe Bailly[34] ouvre son essai Le Versant animal par le souvenir de sa rencontre avec un chevreuil qu’il voit, au milieu de la nuit, à la lisière du bois, dans la lumière des phares de sa voiture. Ce bref moment, apparition fugace, le laisse méditatif :
Le chevreuil était dans sa nuit et moi dans la mienne et nous y étions seuls l’un et l’autre. Mais dans l’intervalle de cette poursuite, ce que j’avais touché, justement, j’en suis sûr, c’était cette autre nuit, cette nuit sienne venue à moi non pas versée mais accordée un instant, cet instant donc qui donnait sur un autre monde[35].
Ce croisement des regards, Bailly le perçoit comme une chance et un privilège, une promesse peut-être aussi d’un rapprochement compréhensif possible, pourquoi pas d’une nouvelle alliance. C’est, en effet, une autre forme de rencontre qui révèle toute la complexité de la relation interspécifique dont nous parlons : « ce face-à-face [...] pose surtout la question vertigineuse de ce qui se passe en cet instant souvent très furtif ; il renvoie à l’envers des masques et des postures, à leur instabilité, à leur labilité, il chasse vers l’ailleurs [...] – ailleurs d’une créature autre et ailleurs de soi-même comme autre »[36]. Les Petits Dieux de Willems s’installent dans cette voie ; plusieurs romans-miniatures évoquent, en effet, le regard de l’animal pour dire son intensité et son poids, pour en dévoiler des potentialités et des limites, comme on l’a vu dans l’exemple de Franju et le porc :
Et qu’on ne vienne plus me dire qu’un animal n’a pas de regard[37].
[Carmen, devenue torera, regarde le taureau qu’elle doit combattre] Nul autre n’aurait ce regard-là, de ce noir-là, ombré de pareils cils, voilé de telles larmes. J’aurais voulu me jeter à genoux, non pour une passe prestigieuse, mais pour qu’il me gracie à son tour, non pas en m’épargnant, mais en m’accordant son pardon[38].
La puissance du regard de l’animal que les personnages de Willems essayent de pénétrer ou de soutenir réside dans le fait qu’il remplace la parole. Son intensité est proportionnelle au manque de précision qu’aurait pu assurer la parole. Faute de parole, c’est le regard qui parle. Le manque de langage chez les animaux fait que « leur regard est si désarmant lorsqu’il se pose sur nous »[39], si inquiétant quand il ouvre des espaces abyssaux et nous donne ainsi « le sentiment d’être en face d’une force inconnue [...] qui nous traverse », « d’une autre forme de pensée »[40] qui résiste à notre entendement.
La question du regard animal s’ouvre, chez l’autrice belge, sur le problème du sens qui se forme ou non à l’issue d’une rencontre avec l’animal ou bien, plus largement, de l’expérience d’un monde partagé. Cette problématique s’est déjà laissé entrevoir dans les analyses qui précèdent. On a vu l’idée d’un espace traversé de signes semés par des animaux, dans la plupart des cas – inintelligibles pour l’homme. On a vu des abus que peut entraîner le désir de traduire ces signes sans le respect de l’autre et dans le but unique de répondre au besoin humain du moment.
La figure de l’animal que Willems explore à travers des siècles d’histoire humaine renvoie aussi aux questions d’ordre esthétique ou artistique, et semble participer du sens que des productions artistiques acquièrent au contact de la bête[41]. Quatre romans notamment sont à signaler dans ce contexte : Carmen et le Taureau, Nietzsche et les oiseaux, Chardin et le lièvre et Borges et la lézarde. Si, dans le premier, se lit en filigrane une longue méditation sur l’aventure du personnage et la manière dont l’art (Mérimée et Bizet en particulier) s’en sert, si le deuxième est une évocation, en toile de fond, de la musique de Wagner, dans les deux derniers, le thème du rapport de l’animal et de l’artiste passe au premier plan.
Chardin, dans sa longue lettre à Denis Diderot, s’applique à expliquer au critique la genèse de son autoportrait, dernière toile du peintre. Ce souci d’être bien compris s’avère vite un prétexte servant une justification que l’artiste estime nécessaire à la compréhension de son œuvre et à la paix de sa conscience. L’aveu « Je suis un criminel, Monsieur »[42] oriente d’abord le critique et le lecteur vers des intentions meurtrières liées à la jalousie mal contenue du jeune peintre face à son rival Watteau. Avant de désigner un autre crime, dont il s’est rendu coupable lors d’une chasse, qui l’a dessillé sur l’horreur de cette pratique[43]. Il tue accidentellement un lièvre (rappel de son lapin tué presque sous ses yeux dans son enfance), ce qui le conduit à prendre la résolution de ne plus peindre que des lapins et des lièvres. Ainsi, Chardin entend non seulement expier son crime, mais aussi appeler au respect des animaux : « [...] les hommes, on les a si souvent représentés, et puis ils savent parler, que diable, qu’ils se débrouillent tout seuls. Ce sont les autres, les doux muets, qu’il faut défendre, en respectant leur silence »[44].
Dans Borges et la lézarde, nous découvrons l’écrivain[45] qui, dans son journal intime tenu dans les journées ayant précédé sa mort survenue le 14 juin 1986, reconstruit sa vie en y mêlant le souvenir de différents animaux – authentiques et fictifs, rencontrés et rêvés, écrits et dessinés – qui, d’une manière ou d’une autre, ont marqué son existence. Chiens, tigres, léopards, lézard(e)s[46] et tortues défilent, mais l’expérience cruciale vient vers la fin du récit. Quelques jours avant sa mort, l’écrivain aveugle fait la rencontre d’un chien dont l’entrée dans sa chambre « coupe [sa] vie en deux, et tant pis si l’après ne dure que quelques jours, quand l’avant a duré quatre-vingts et des ans »[47]. L’écrivain trouve chez l’animal non seulement un soutien et un apaisement que lui assure le toucher de son doux pelage « de tigre », mais il découvre la quantité de sensations que le chien aurait pu lui procurer et dont la cécité l’a privé : « Je crois qu’il m’inspirerait mes meilleurs poèmes, s’il m’importait encore de les écrire ; car juste à temps il m’a rendu un corps, par mille et une sensations de pur plaisir, qui maintiendraient en vie une momie. Avec lui j’ai deux peaux, quatre narines et cent pupilles [...] »[48].
Le point de départ de Sandrine Willems est la reconnaissance de l’importance fondamentale de la présence animale dans la vie de l’homme. Convaincue que « ces vivants d’un autre règne ouvrent [...] des questions abyssales »[49], elle trouve nécessaire d’en rendre compte, et le moyen auquel elle recourt paraît fort heureusement choisi. Mettre en scène une galerie de personnalités-témoins, présentes dans notre culture, dans notre histoire et dans notre imaginaire, revient, en effet, à retracer l’histoire des rapports entre les mondes humain et animal, et à montrer que les interrogations qui nous travaillent aujourd’hui sont universelles. C’est aussi rendre compte de l’éloignement progressif de ces deux univers. À considérer les exemples de relations, que Willems multiplie dans sa série, on voit bien que plus on avance dans le temps, plus le lien entre l’homme et l’animal se relâche. Plusieurs cas de figure que révèlent les récits successifs – complicité, communauté d’expérience, partage, affinité, recherche de langue commune – non seulement nous disent l’inouïe complexité du rapport interspécifique, mais témoignent d’une « évolution de la familiarité vers l’étrangeté des bêtes »[50], cette dernière étant inscrite en filigrane dans tout lien homme-animal depuis la nuit des temps. Chronologiquement parlant, les deux dernières figures évoquées par Willems, le Yeti et le porc, montrent deux pôles de ce lien : la possibilité de proximité et la rupture définitive. Le constat de l’éloignement entre l’homme et la nature ou, comme le veut André Benhaïm, de « l’étrangement »[51] qui caractérise aujourd’hui l’attitude de l’homme face à l’animal et qui est l’effet d’un long processus de marginalisation des animaux, nous amène à la nécessité de mettre en rapport des processus évoqués et des crises d’aujourd’hui. Celles-ci installent la nature au cœur et à l’origine de nos préoccupations. René Fregni, dans sa contribution au volume Tracts de crise. Un virus et des hommes (2020), voit l’origine de la crise sanitaire dans l’écart qui se creuse depuis longtemps entre nous et la nature : « La vie lentement s’écarte de nous, remarque-t-il, se méfie de nous, sécrète ses anticorps dans les profondeurs des racines et les molécules de l’eau, de l’air »[52]. Et il invite, dans la conclusion, à aller la rejoindre, à la retrouver dans le respect et l’amour.
L’animal, que la prose de Sandrine Willems place en vedette, doit donc être vu comme une chance de retrouver l’équilibre dans notre vie d’humains. « Figure de l’autre » pour Jan Baetens, il est un « représentant modeste [...] de tout ce qui nous échappe et nous questionne dans le monde »[53]. Le (re)voir vraiment et enfin, avec toute l’attention qu’il exige et mérite, le considérer comme notre « maître silencieux »[54] peut être un moyen efficace de panser nos crises présentes et futures, personnelles et collectives.
Baetens, Jean, « Postface. Pour une tradition incandescente », S. Willems, Les Petits Dieux, Bruxelles, Labor, 2017
Bailly, Jean-Christophe, Le Parti pris des animaux, s. l., Christian Bourgois éd., 2013
Bailly, Jean-Christophe, Le Versant animal, Montrouge, Bayard, 2018
Berger, John, « Pourquoi regarder les animaux ? », in H.-S. Afeissa, J.-B. Jeangène Vilmer (dir.), Philosophie animale. Différence, responsabilité et communauté, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2015, p. 29-54
Frégni, René, « Les Jours barbares », in Tracts de crise. Un virus et des hommes 18 mars/11 mai 2020, Paris, Gallimard, 2020, p. 54-58
Morizot, Baptiste, Manières d’être vivant, s. l., Actes Sud, 2020
Romestaing, Alain, « Du face-à-face à l’effacement : écrire la mort des bêtes », in Revue des Sciences humaines, 2017, no 328 (Zoopoétique. Des animaux en littérature moderne de langue française), p. 153-164
Willems, Sandrine, L’Homme et les loups, Paris, Les Impressions nouvelles, 2001
Willems, Sandrine, Artémis et le cerf, Paris, Les Impressions nouvelles, 2002
Willems, Sandrine, Borges et la lézarde, Paris, Les Impressions nouvelles, 2002
Willems, Sandrine, Franju et le porc, Paris, Les Impressions nouvelles, 2002
Willems, Sandrine, Les Petits Dieux, Bruxelles, Espace Nord, 2017

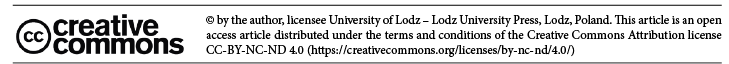
Received: 2021-09-30; Revised: 2022-01-06; Accepted: 2022‑02‑28.