

Université Adam Mickiewicz
RÉSUMÉ
Les récents travaux des historiens des sciences ont démontré que la conscience environnementale n’est pas le propre de notre « modernité réflexive ». Dès le XVe siècle, l’agir humain est envisagé comme facteur de changement dans diverses théories du climat qui oscillent entre l’optimisme et la peur de la catastrophe. Cette conscience climatique imprègne la littérature catastrophiste qui, dès le XIXe siècle, réfléchit sur les pouvoirs et les conséquences néfastes de la technoculture propre à la société industrielle. L’étude des œuvres de Jean-Baptiste Cousin de Grainville, d’Alfred Bonnardot et de Camille Flammarion permet d’observer comment la littérature à la fois s’empare des savoirs et détourne ceux qui portent sur l’économie de la nature et sur le climat, désamorçant les peurs et produisant un certain inconscient de la crise climatique.
MOTS-CLÉS — crise écologique, réflexivité environnementale, littérature catastrophiste, Georges-Louis Leclerc comte de Buffon, Jean-Baptiste Cousin de Grainville, Eugène Huzar, Alfred Bonnardot, Camille Flammarion
SUMMARY
Recent work by science historians has shown that environmental awareness is not unique to our “reflexive modernity”. As early as the 15th century, human agency was envisaged as a factor of change in various climate theories which oscillated between optimism and fear of disaster. This climate awareness informed 19th century catastrophist literature which examined technoculture specific to industrial societies in terms of both its power and negative consequences. The works of Jean-Baptiste Cousin de Grainville, Alfred Bonnardot and Camille Flammarion provide an insight into how literature both appropriates and subverts the knowledge of the economy of nature and of climate, defusing fears and producing a certain kind of the environmental unconscious.
KEYWORDS — ecological crisis, environmental awareness, catastrophist literature, Georges-Louis Leclerc comte de Buffon, Jean-Baptiste Cousin de Grainville, Eugène Huzar, Alfred Bonnardot, Camille Flammarion
La crise écologique est sans conteste le défi majeur de notre siècle. Depuis des décennies, les scientifiques alertent sur le changement climatique qui menace tous les écosystèmes et mène à la sixième extinction de masse. La perte de la biodiversité, les phénomènes climatiques extrêmes, bientôt même des guerres pour les ressources naturelles dessinent un avenir apocalyptique qui redéfinit les enjeux de la politique globale tout en suscitant chez une partie de la population la solastalgie, c’est-à-dire une nouvelle forme de détresse psychologique ou d’éco-anxiété face à l’ampleur de la crise et à l’inaction généralisée. Selon le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), publié en août 2021, c’est l’homme qui est responsable du changement climatique. La notion d’anthropocène, désignant cette nouvelle époque de l’homme devenu la force géologique majeure, est de plus en plus largement adoptée dans le discours scientifique[1]. Le chimiste Paul Creutzen, qui a popularisé ce terme au début du XXIe siècle[2], a identifié la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle comme le commencement de l’ère de l’homme agissant sur le climat. Souscrivant à cette thèse, l’historien Dipesh Chakrabarty a avancé que cette dégradation environnementale se serait passée sans que ses acteurs intègrent « la moindre conscience de la puissance d’agir géologique que les hommes étaient en train d’acquérir au même moment »[3]. Or, les récents travaux des historiens des sciences montrent que les savoirs climatiques sont beaucoup plus anciens que ne veulent le croire les partisans de la conception de « modernité réflexive »[4] qui conçoit notre époque comme la première à identifier les risques de la productivité industrielle et capitaliste. Manifestement, nous ne sommes ni les seuls, ni les premiers à nous effrayer de l’influence anthropique sur la biosphère.
Dans le présent article, je voudrais explorer quelques points de croisement entre le discours savant sur le climat et sa représentation dans la littérature du XIXe qui n’a pas été insensible aux questions environnementales. La crise écologique contemporaine invite à interroger ce corpus d’œuvres des auteurs qui ont été les premiers témoins de l’accélération de la dégradation moderne du climat. Il s’agirait donc d’investiguer sur les traces de ce que l’historien des sciences Jean-Baptiste Fressoz appelle la « réflexivité environnementale »[5] des sociétés modernes, ou, autrement dit, leur savoir sur l’« économie de la nature »[6] avant même la naissance de l’écologie comme discipline autonome, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. La littérature peut donner un certain aperçu de la manière dont les enjeux climatiques, définis et interrogés par les hommes de science, ont été assimilés (ou pas) dans la société. De fait, les écrivains n’ont pas attendu l’invention de l’écologie d’un côté, ni celle de la science-fiction de l’autre côté, pour dessiner les catastrophes climatiques et les apocalypses naturalisées[7] dans leurs œuvres. Je proposerai une vue cavalière du corpus dix-neuviémiste pour poser les questions suivantes : est-ce que la littérature catastrophiste a pu identifier et penser ce que nous appelons aujourd’hui la crise de l’anthropocène ? Est-ce qu’elle a pu et voulu alerter, sensibiliser les lecteurs à la question du climat ou, au contraire, a-t-elle transformé la catastrophe en un topos littéraire en désamorçant les peurs et produisant plutôt une inconscience de la crise ? Ces questions me semblent d’autant plus importantes qu’elles permettent de réfléchir sur l’utilité du paradigme de la production culturelle catastrophiste (littéraire, cinématographique, philosophique) qui a récemment regagné les faveurs du grand public.
Dans le corpus dix-neuviémiste choisi pour cette étude, on observe une corrélation troublante : plus la menace est considérée comme sérieuse par les hommes de science, plus elle est traitée à la légère dans la littérature, et inversement. Les littéraires et les scientifiques sont rarement sur la même longueur d’onde quand ils abordent la question environnementale. On peut s’en convaincre en analysant la théorie du climat, foncièrement optimiste, du comte de Buffon, et sa reprise dans l’épopée apocalyptique Le Dernier homme (1805) de Jean-Baptiste Cousin de Grainville. Un décalage analogue, quoiqu’inverse, est visible entre l’essai techno-catastrophiste La Fin du monde par la science (1857) d’Eugène Huzar et sa caricature chez le nouvelliste Alfred Bonnardot (Fantaisies multicolores, 1859). Enfin, à l’aube du XXe siècle, les diagnostics littéraire et scientifique semblent pour une fois concorder : dans le roman La Fin du monde (1894) du célèbre astronome et vulgarisateur des sciences Camille Flammarion, la peur est résolument exorcisée, l’homme dédouané de toute responsabilité relativement au climat, le catastrophisme s’avérant un mythe scientifique d’un côté, une vulgaire plaisanterie journalistique de l’autre.
Les historiens des sciences Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher l’ont bien démontré, les savants de l’époque moderne ont élaboré plusieurs paradigmes de réflexion sur le changement anthropique du climat. Dès le XVe siècle, celui-ci est considéré tout autant comme une menace – l’activité humaine peut déséquilibrer la nature – que comme un espoir d’amélioration des conditions de vie[8]. Si la conscience climatique de l’époque moderne n’a rien à voir avec nos théories contemporaines, en revanche, les hommes de science, les ingénieurs, les forestiers des siècles passés étaient persuadés que le déboisement, la transformation du sol et du couvert végétal modifient le climat. Comme l’expliquent Fressoz et Locher :
[...] ce n’est pas l’influence des gaz à effet de serre qui pousse les savants des XVIIe et XVIIIe siècles à s’intéresser au changement climatique, mais mille autres motifs : coloniser l’Amérique du Nord ; percer le secret des cycles météorologiques ; prévoir l’avenir thermique de la Terre et comprendre les effets de l’action humaine sur le monde végétal, le cycle de l’eau, et, par son entremise, sur le climat. [...] La pensée et les savoirs contemporains du changement climatique héritent d’une longue histoire[9].
Dès le XVIIe siècle, le climat est donc envisagé du point de vue de l’influence anthropique, même si les enjeux théoriques sont différents des nôtres. Ainsi par exemple, au seuil du XIXe siècle, on craignait non pas tant le réchauffement mais le refroidissement du climat[10]. C’est l’hypothèse défendue notamment par le comte de Buffon dans les Époques de la nature (1778), un véritable best-seller de l’époque dans lequel l’auteur soutenait que la Terre ne cessait de perdre son principe de chaleur interne – constitutif de la chaleur ressentie sur la surface du globe et nécessaire pour la survie des espèces – et finirait par devenir une planète morte comme la Lune qui, étant plus petite, a épuisé ses ressources caloriques plus vite. L’homme peut toutefois s’opposer à ce principe géologique de refroidissement grâce à une politique globale sagement menée et orchestrée depuis l’Europe, foyer de la transformation rationnelle du climat. Selon l’auteur de l’Histoire naturelle, l’emprise de l’homme (européen) sur la planète ouvre une nouvelle époque géologique qui, dans l’interprétation de Fressoz et de Locher, « est un anthropocène, où agir humain et processus naturels s’interpénètrent pour créer une nouvelle nature, à l’échelle de la planète »[11]. Pour Buffon, cette entrée dans une nouvelle « époque de la nature » est une promesse, non une source d’inquiétude ; le naturaliste proclame que l’humanité peut « modifier les influences du climat qu’elle habite et en fixer pour ainsi dire la température au point qui lui convient »[12]. Le changement climatique apparaît donc comme une chance d’endiguer le refroidissement de la planète et de rendre la terre plus fertile pour plus longtemps.
Malgré les réserves de certains scientifiques qui mettaient en doute les calculs et les déductions de Buffon, les deux dernières décennies du XVIIIe siècle semblaient alors conforter sa théorie : les hivers sont rudes (particulièrement entre 1788-1794) ; partout en France on rencontre des problèmes d’approvisionnement et des pénuries de grain ; c’est bientôt la disette qui hante la population – prélude à la vague de mécontentement qui déclenchera la Révolution française, perçue par ses acteurs non seulement comme un effondrement politique, mais aussi climatique[13].
Écrite aux lendemains de la Révolution, l’épopée en prose Le Dernier homme de Jean-Baptiste Cousin de Grainville (1746-1805) témoigne de cette anxiété climatique ; elle la transpose en une vision d’apocalypse qui a un caractère à la fois religieux[14], politique[15] et écologique. De fait, le refroidissement de la planète, l’épuisement des ressources naturelles, la dégénérescence et la stérilité des espèces vivantes décrits dans Le Dernier homme expliquent peut-être mieux encore que les raisons politiques ou religieuses l’inévitabilité de la fin du monde et de l’extinction de l’espèce humaine[16].
L’action de l’épopée se déroule dans un avenir lointain et, paradoxalement, elle est extrêmement simple : c’est la rencontre entre Adam, le père des hommes, et Omégare, le dernier humain. Après une longue discussion, lors de laquelle le lecteur découvre l’état de la planète et la dégénérescence de l’humanité, Omégare décide de quitter son épouse Syderie, ce qui signifie son assentiment à la fin du monde, voulue par Dieu[17]. Tout à fait inusité dans le genre d’épopée, ce dépouillement de l’action (dans le sens de la mimesis aristotélicienne) – qui se résume à un seul geste, celui, pour le personnage central, de quitter son foyer familial et de déclencher l’apocalypse – contraste avec son caractère sublime[18] : elle est tout aussi simple qu’un fiat lux biblique, et tout aussi décisive pour le genre humain. Au verbe divin créateur de l’univers correspond ici, de manière symétrique, le silence d’Omégare qui s’en va, résigné, vers l’inconnu, laissant derrière lui les débris du monde.
Mais avant même que le dernier homme ne prenne sa décision fatidique, la planète ne ressemble qu’à une « ruine immense »[19]. Adam a du mal à reconnaître sa patrie, qu’il a connue au moment de sa beauté première, dans le jardin d’Éden :
De quel étonnement le père des humains est frappé, lorsqu’il voit les plaines et les montagnes dépouillées de verdure, stériles et nues comme un rocher ; les arbres dégénérés et couverts d’une écorce blanchâtre, le soleil, dont la lumière était affaiblie, jeter sur ces objets un jour pâle et lugubre […]. Après avoir lutté pendant des siècles contre les efforts du temps et des hommes qui l’avaient épuisée, elle (la terre) portait les tristes marques de sa caducité[20].
L’état déplorable de la planète a une cause civilisationnelle. L’humanité, après avoir atteint le sommet de prospérité se manifestant par le plus haut degré de perfectionnement des sciences et des arts, connaît une époque de lente décadence. Celle-ci est – pour reprendre la formule de Jean-Baptiste Fressoz et de Fabien Locher[21] – une conséquence directe de l’économie de la nature déstabilisée par l’agir humain. Selon Grainville, l’hybris de la civilisation était inscrite au cœur même de l’Histoire :
Semblable à tous les ouvrages créés, la terre ne pouvait pas être immortelle, la nature calcula l’instant de sa décadence, et comme une tendre mère, elle avait préparé les moyens de la régénérer ; mais la terre a devancé les temps marqués par la nature, et ce sont les hommes qu’elle nourrissait de son sein, ce sont ses propres enfants, qui, tout chargés de ses bienfaits, ont été parricides. Les fruits abondants qu’ils recevaient de ses mains libérales, n’ont point assouvi leurs désirs. Ils se sont hâtés d’exprimer de ses entrailles jusqu’aux derniers principes de sa vie[22].
Dieu a prévu un terme à la vie sur Terre, qui devait finir comme toute chose créée, mais l’homme n’a pas respecté ce calendrier cosmique : avide et féroce, il a commis un « parricide » en surexploitant les ressources naturelles sans laisser à cette « mère », pourtant « libérale » et prodigue, le temps de se régénérer. Les signaux d’alerte étaient nombreux, mais l’homme n’a rien voulu voir de la catastrophe qui approchait. La Lune s’est éteinte la première, annonçant – tout comme chez le comte de Buffon – le futur destin de la Terre. Depuis lors, la mort thermique n’a cessé de progresser : le froid gagne tous les continents, les sols deviennent de moins en moins labourables, l’humanité commence à souffrir de faim et à migrer – inutilement, parce que le froid et la dégénérescence la suivent partout.
Pour endiguer cette décadence, l’humanité entreprend les travaux qu’on ferait aujourd’hui relever de la géo-ingénierie : on change le cours de fleuves pour fertiliser les sols, on repousse les limites de l’Océan pour gagner une terre labourable, on fait l’impossible, mais rien ne semble suffisant pour contrer la détérioration du climat. L’ingénierie – en laquelle le comte de Buffon plaçait tout son espoir pour enrayer le refroidissement de la planète – s’avère chez Grainville inefficace face à l’ampleur de la catastrophe. Les travaux sont d’ailleurs abandonnés au moment où l’humanité elle-même devient stérile tout en découvrant que l’enfant d’Omégare et de Syderie – qu’on croyait longtemps le dernier espoir pour la régénération de l’humanité – doit mourir pour ne pas donner vie à une race avilie, fratricide et proprement monstrueuse[23]. La fin du monde est non seulement inévitable à cause de l’état de dégradation de la planète, mais aussi souhaitable à cause de la gravité de la faute morale de l’homme[24]. Dans ces conditions, la volonté de survivre apparaît comme une tentation diabolique[25] à laquelle Omégare doit résister, en choisissant la mort de son espèce.
Dans son épopée, Grainville articule ensemble le catastrophisme environnemental et l’apocalyptisme religieux : ces deux composantes sont complémentaires pour concevoir l’hybris de la civilisation qui nécessite une punition : manifeste dans les phénomènes naturels (épuisement des ressources, stérilité, refroidissement), elle obéit pourtant au cycle de l’histoire tracé par Dieu – elle est une eschatologie naturalisée. Si l’on peut discerner chez Grainville une certaine réflexivité environnementale, elle est intrinsèquement liée à la conscience religieuse : chez ce prêtre défroqué, la peur de la fin du monde ne se conçoit pas hors du cadre du récit d’apocalypse.
Ce double discours religieux et proto-écologique sera repris dans la seconde moitié du siècle par Eugène Huzar (1820-1890), avocat et amateur de sciences, auteur de deux essais, La Fin du monde par la science (1855) et L’Arbre de la science (1857), qui lui ont valu l’étiquette d’inventeur du catastrophisme technologique[26]. Dans son édition critique des essais de Huzar, Jean-Baptiste Fressoz a opéré d’importantes coupures ne gardant que ce qui concerne directement l’économie de la nature et les risques technologiques liés à la civilisation industrielle. Significativement, toute l’argumentation religieuse en faveur du catastrophisme (nota bene, c’est la plus grande partie des deux essais huzariens) a été supprimée par l’éditeur moderne[27]. Pourtant, ces textes – tout comme l’épopée de Grainville – présentent un curieux mélange de pensée religieuse et de critique du progrès technologique en s’inscrivant dans le courant de sécularisation de l’apocalypse.
En écrivant La Fin du monde par la science, Huzar s’est inspiré non seulement de ses observations d’amateur de sciences qui fréquentait les laboratoires[28], mais aussi des textes sacrés (la Bible, les Védas, l’Avesta), adaptant la méthode de l’orientaliste allemand Georg Friedrich Creuzer[29]. Comparant les mythes du péché originel, qu’il retrouve dans toutes les religions anciennes, Huzar en déduit que l’histoire de l’humanité forme des cycles qui obéissent au même schéma : après de longs siècles du perfectionnement des sciences et des arts, venait toujours le moment d’excès qui entraînait la punition divine pour l’orgueil de l’homme et sa libido sciendi (c’est selon Huzar le sens du mythe biblique de l’arbre de la science[30]). Toutes les civilisations du passé ont fini écrasées sous le poids de leurs propres inventions, et après leur chute, l’humanité reprenait le travail de Sisyphe en refondant une nouvelle civilisation. Ces cycles obéissent à la loi de l’éternel retour : l’homme a péché dans le passé et il péchera à l’avenir par le même orgueil. Celui-ci trouve une forme particulière dans le contexte de la technoculture du XIXe siècle : selon Huzar, l’homme « voudra un jour diriger et gouverner les énergies de la nature, mais il arrivera un moment où il n’en sera plus le maître, elles lui échapperont quand il croira le mieux les étreindre, et notre humanité disparaîtra comme le cycle humain qui l’a précédée »[31].
De fait, ce qui importe dans ce catastrophisme, et ce qui rapproche Huzar de Grainville, étudié précédemment, c’est le rôle des sciences et des techniques dans le schéma apocalyptique pourtant profondément religieux. Les deux auteurs soulignent que l’apocalypse vient mettre un terme à la civilisation excessive et à la surexploitation des ressources naturelles. Huzar répète à plusieurs reprises que « la fin du monde [doit] arriver fatalement par l’exagération de la science et de la puissance »[32]. Celle-ci s’est manifestée de diverses manières au cours des cycles de l’humanité. Au XIXe siècle, elle prend la forme de la civilisation industrielle qui détériore l’environnement. Huzar observe que l’homme, dans sa frénésie de progrès, a détruit les forêts qui régulaient le cycle des eaux ; il percé les montagnes qui protégeaient les champs contre des phénomènes atmosphériques extrêmes ; il a rompu les isthmes en troublant l’harmonie des mers ; bref, il a « bouleversé l’économie géologique du globe »[33]. Or, il s’est avéré seulement ex post que ces agissements impliquaient des conséquences avec lesquelles l’homme n’avait pas compté : le déboisement amène les inondations ; la combustion du charbon est nuisible à l’atmosphère ; son excavation massive peut déstabiliser l’axe de rotation de la Terre, etc.[34]. L’imprévoyance ou l’« imprescience »[35] de la science moderne doit un jour provoquer une catastrophe qui mettra fin à la civilisation parce que les rapports de force sont renversés : « c’est l’homme qui est infini, grâce à la science, et c’est la planète qui est finie. [...] [On] peut se demander quelle action peut avoir un jour cette puissance illimitée sur notre pauvre terre si limitée et si bornée aujourd’hui »[36].
L’essai de Huzar a eu un grand retentissement dans la presse[37] mais il n’a pas été pris au sérieux par les hommes de science, ni d’ailleurs par les littéraires. Dans la fiction, le thème de la fin du monde par la science, des apocalypses ou des ruines du futur est souvent traité à la légère. C’est notamment le cas d’Alfred Bonnardot (1808-1884), historien, archéologue et écrivain, qui dans sa nouvelle Archéopolis fait explicitement référence aux travaux de Huzar et à son catastrophisme technologique. Le narrateur de la nouvelle est un historien du futur – procédé souvent exploité dans la cli-fi contemporaine – qui décrit les causes de la catastrophe civilisationnelle advenue au XXIe siècle :
Vers le milieu du XXIe siècle, les sciences, les arts et l’industrie avaient atteint leur apogée chez les nations civilisées du globe, reliées entre elles par des voies de fer, des télégraphes électriques et des tunnels sous-marins. Les machines, multipliées à l’infini, appliquées à tout, avaient supprimé ou à peu près, l’emploi de la force humaine[38].
À cette époque, la force musculaire n’est plus nécessaire pour accomplir les divers travaux – les machines ont remplacé l’homme dont la seule occupation est de surveiller celles-ci. Or, ce qui semblait un retour à l’« âge d’or » s’est rapidement transformé en un nouvel « âge de fer »[39]. Le diagnostic des causes de la catastrophe est une reprise, parfois mot à mot, de l’essai de Huzar :
De l’état de bien-être matériel acquis à l’humanité devait naître sa ruine. Il semblait que Dieu voulût châtier l’homme pour avoir dérobé trop de fruits à l’arbre de la Science. La multiplication sur certains points du globe des chemins de fer et des fils télégraphiques contrariaient [sic] l’action normale de l’électricité de l’atmosphère. Ces immenses réseaux métalliques, dans certaines conditions, repoussaient, l’hiver, la neige fertilisante ; l’été, les orages bienfaisants. Des maladies jusqu’alors inconnues sévissaient sur l’espèce humaine, comme sur les plantes et le bétail qui servait à l’alimenter[40].
Outre ces phénomènes naturels qui annoncent la catastrophe qui approche, l’humanité souffre d’un mal encore plus irrémédiable – c’est l’ennui. Civilisés à l’extrême, privés de la nécessité d’un travail manuel, les gens se suicident par milliers[41]. Les pays, traversés par des crises politiques, tombent en ruine. Ainsi, le paysage de la France est proprement post-apocalyptique : les villes sont détruites et désertes, les fleuves se sont transformés en des torrents de boue, la végétation se réduit à des ronces et des orties. Le climat en Europe devient hostile à la vie. Seules quelques familles de rescapés qui ont réussi à survivre aux émeutes et à la pénurie se sont réfugiées en Afrique qui jouit seule d’un climat tempéré et propice à la vie[42].
En l’an 9957, bien des siècles après l’effondrement de l’Europe, la civilisation humaine s’est renouvelée : dans les rues d’Archéopolis, la nouvelle capitale africaine, la vie a repris son cours. Les sciences et les arts sont pratiqués par les habitants de cette nouvelle terre promise. On le voit bien, le schéma de l’intrigue reproduit l’idée des cycles huzariens, mais avec une légère modification : la nouvelle humanité est plus laide et plus bête. Bonnardot cible dans son récit la gent académique, et plus précisément les archéologues[43] qui se querellent vainement sur l’emplacement des anciens monuments du vieux monde (qui se résume, mégalomanie oblige, au Paris du XIXe siècle). Pendant une séance à l’Académie, les débats sur les artefacts du passé sont si aberrants et comiques que le narrateur éclate de rire et... se réveille dans son lit. La vision apocalyptique du futur – les villes détruites, la nature déréglée – n’était qu’un rêve. De cette manière, la valeur critique du récit s’estompe. La peur d’un monde post-apocalyptique se transforme en rire. En ceci, Bonnardot n’est pas vraiment original : dès que l’apocalypse se sécularise, elle se banalise en accusant un potentiel non pas tant critique, mais humoristique. La quasi-totalité des récits de la fin du monde de la deuxième moitié du siècle finit soit pas le réveil du narrateur, soit par la victoire de l’homme sur la nature qui le menace[44]. La croyance en la technique et en l’ingénierie est si forte que l’apocalypse ne peut pas vraiment avoir lieu. C’est un topos littéraire à la mode et en tant que tel, elle est souvent employée à des fins didactiques : pour montrer aux lecteurs qu’aucune menace n’est réelle.
Selon Fressoz et Locher, au moment de l’accélération de la détérioration du climat vers la fin du XIXe siècle, les sociétés européennes se sont rendues « peu à peu insensibles à la menace d’un changement climatique »[45]. C’est la confiance en l’industrie et en la technique qui leur a permis de croire en la possibilité de surmonter les aléas climatiques – grâce aux avancées économiques liées à la première globalisation, les sociétés occidentales se pensent à peu près indépendantes des vicissitudes du climat[46]. Les visions de la catastrophe naturelle, prises relativement au sérieux dans la première moitié du siècle, deviennent désormais un sujet politique et littéraire qui prête davantage à rire. Ceci se voit dans de nombreuses œuvres de fiction qui exploitent le thème de la fin du monde. Significativement, le péril vient non du cœur de la civilisation, comme ce fut le cas chez Grainville et Huzar, mais de l’extérieur : ce sont surtout les comètes et les extraterrestres qui menacent l’humanité. De surcroît, la plupart de ces récits, à de très rares exceptions près[47], se clôt par un happy end : l’homme peut surmonter le danger, combattre l’ennemi ou maîtriser les forces naturelles pour préserver sa civilisation.
Dans son roman d’anticipation La Fin du monde (1894), l’astronome et vulgarisateur des sciences Camille Flammarion (1842-1925) a noté, non sans une certaine malice, que tout au long du XIXe siècle le public avait une « prédilection particulière »[48] pour les récits apocalyptiques. Il a décidé d’exploiter cet engouement populaire dans le but de mener à bien son projet didactique qui résidait en une démystification du catastrophisme. Dans son roman, c’est une comète qui doit amener la destruction de la Terre. L’intrigue contient tous les éléments qui deviendront des passages obligés des blockbusters cinématographiques des XXe et XXIe siècles : de la peur, encore de la peur, et la victoire de l’humanité.
Quand les résultats des calculs astronomiques annonçant le passage d’une comète mortifère fuitent de l’Observatoire de Paris, tous les habitants du globe se préparent au pire : « […] c’était la population tout entière, inquiète, agitée, terrifiée, indistinctement composée de toutes les classes de la société, suspendue à la décision d’un oracle […] »[49]. Pour décrire le bolide qui menace la Terre, le romancier a recours à un imaginaire cométaire pluriséculaire – qu’il critiquait par ailleurs dans ses ouvrages de vulgarisateur scientifique[50]. Ainsi, la comète est comparée à une « épée formidable », un « éventail céleste prodigieux » ou encore à une « aurore boréale fantastique »[51]. Flammarion multiplie les effets de pathos qui enregistre la peur populaire face à un événement « mystérieux, extra-terrestre et formidable »[52]. Terrorisés, les hommes cherchent un abri en attendant le grand spectacle de la fin du monde. Or, il s’avère que les premiers calculs astronomiques ont été mal faits. Les scientifiques tentent de rassurer les populations, mais ce sont les journalistes qui continuent à semer la panique. Flammarion dépeint une société entièrement régie par l’empire des fake news : pour accroître la vente de leurs gazettes, les journalistes publient les annonces les plus anxiogènes. Malgré les tentatives des astronomes pour calmer les esprits, les bourses ferment, l’activité économique s’arrête, les hommes politiques fuient les Chambres – mais le pire n’a pas lieu : la comète détruit seulement le centre de l’Italie, et plus précisément, le Vatican. À travers cet épisode, on peut facilement deviner l’anticléricalisme de Camille Flammarion qui se permet de rejouer, sur un ton comique et blasphémateur, l’ancien motif de la comète en tant que punition divine[53], dirigée cette fois-ci vers le cœur même du catholicisme. Son scénario de fin du monde est définitivement sécularisé, mais en même temps, chez Flammarion, c’est la science qui prend la relève et se transforme en une nouvelle religion de l’humanité. Dans le roman, ceux qui n’ont pas écouté les scientifiques et qui se sont laissé guider par les faux prophètes, les journalistes, meurent dans la catastrophe à cause de la congestion cérébrale qui frappe massivement l’humanité. De fait, outre le clergé du Vatican, les seules victimes de la comète sont celles de la peur, ce contre quoi les scientifiques flammarioniens avertissaient par ailleurs[54].
Dans la deuxième partie du roman, dominée par une exposition didactique, cette scénographie catastrophiste de la comète sert à Flammarion de prétexte pour envisager différentes fins du monde possibles : la montée des eaux et la submersion des continents, la désertification de la planète, le refroidissement ou, au contraire, le réchauffement climatique. Il est significatif que dans aucune de ces hypothèses, l’agir humain n’est pris en compte en tant qu’agent destructeur de la planète. C’est toujours la nature qui est responsable du mal, ce qu’on voit dans la structure grammaticale de cette longue période anaphorique dans laquelle l’activité de la planète est soulignée – pas celle des hommes :
[…] [la Terre] peut rencontrer une comète dix ou vingt fois plus grosse qu’elle, composée de gaz délétères qui empoisonneraient notre atmosphère respirable. [...] Elle peut perdre l’oxygène qui nous fait vivre. Elle peut éclater comme le couvercle d’un volcan. Elle peut s’effondrer en un immense tremblement de terre. Elle peut abîmer sa surface au-dessous des eaux et subir un nouveau déluge plus universel que le dernier. Elle peut, au contraire, perdre toute l’eau qui constitue l’élément essentiel de son organisation vitale. [...]. Elle peut perdre, non seulement les derniers restes de sa chaleur interne, qui n’ont plus d’action à sa surface, mais encore l’enveloppe protectrice qui maintient sa température vitale. Elle peut un beau jour n’être plus éclairée, échauffée, fécondée par le Soleil obscurci ou refroidi. Elle peut, au contraire, être grillée par un décuplement subit de la chaleur solaire analogue à ce qui a été observé dans les étoiles temporaires. Elle peut…[55]
Aucune de ces hypothèses catastrophistes n’est à craindre dans un futur un tant soit peu proche – Flammarion vulgarisateur scientifique suppose en effet qu’au moins dix milliards d’années séparent l’humanité de la fin du monde. Le message est on ne peut plus rassurant : l’économie de la nature n’est aucunement bouleversée par l’agir humain, la menace n’est envisageable qu’à travers des modélisations astronomiques et géologiques qui relèvent de l’infiniment grand – et, surtout, de l’infiniment lointain. Et même si la troisième et dernière partie du roman met en scène ce futur qui se passe dans des milliards d’années – Flammarion fait revivre les personnages de l’épopée de Grainville, Omégare et Eva – après la mort de la Terre, ces derniers hommes vivront sur une autre planète grâce à une palingénésie cosmique qui leur permettra de coloniser le cosmos et de continuer la vie astrale.
Quoiqu’il soit tentant de voir une continuité entre notre conscience climatique et la réflexivité environnementale des siècles passés, force est de constater que le rôle de l’agir humain dans diverses théories du climat n’est pas compris de la même manière à travers les époques. Bien qu’il soit considéré aujourd’hui comme le début de l’anthropocène, le XIXe siècle ne pense pas la nature en crise – ce terme ne s’applique pas alors au climat et à la stabilité géologique de la planète. Dans la littérature dix-neuviémiste, c’est le terme de catastrophe qui ressort bien plus souvent. La crise, telle que nous la concevons aujourd’hui, est un phénomène qui s’étend sur le long terme et qui est inscrit au cœur même de notre économie capitaliste et de la politique globalisée[56]. En cela, le XIXe siècle semble bien plus optimiste : la catastrophe, plus brusque et imprévisible, laisse toujours place à la renaissance, qui est une perspective qui manque cruellement aujourd’hui.
S’il y a une inquiétude – celle qui concerne la gestion des ressources naturelles – chez les auteurs étudiés ci-dessus, elle a un fondement religieux et ne se conçoit pas hors du cadre d’une eschatologie. On l’a vu avec l’exemple de l’épopée de Grainville et l’essai de Huzar : si les deux auteurs se soucient du climat, leurs fins du monde sont à peine sécularisées. Toutefois, malgré ces obstacles épistémologiques, la littérature du XIXe siècle peut encore alimenter notre réflexion contemporaine : l’articulation étroite entre l’écologie et la religion, qui caractérise la littérature dix-neuviémiste, n’est-elle pas le propre d’une grande partie de nos discours journalistiques sur le climat qui s’appuie sur les sentiments de culpabilité individuelle, de péché pour lequel il faut se repentir en son for intérieur ? L’écologie, qui se transforme en une nouvelle religion des sociétés occidentales, n’est-elle pas par cela même menacée de devenir une nouvelle doxa qui, au lieu d’inciter à adopter de vraies actions politiques en faveur du climat, se transforme en un banal sujet de culture, ou, pire encore, en une stratégie de marketing ?
Par ailleurs, on peut observer qu’autant les savoirs climatiques du XIXe siècle sont définitivement dépassés, autant les schémas narratifs hérités de la littérature catastrophiste dix-neuviémiste façonnent toujours notre imaginaire de la crise écologique tel qu’il est mobilisé dans le cinéma ou la littérature contemporains[57]. La peur de l’apocalypse conjuguée avec la confiance, quasiment religieuse, en la science et l’ingénierie qui réitèrent la promesse du salut (par exemple par la colonisation d’autres planètes, ce dont rêvent aujourd’hui quelques firmes américaines), mettent à nu l’obsolescence de notre imaginaire de la crise et expliquent, dans une certaine mesure, pourquoi celle-ci signifie surtout indécision et pérennisation[58]. Tenter de fabuler la crise écologique à travers le scénario de la catastrophe universelle relève donc d’un leurre, ce que constatent d’ailleurs les critiques de l’apocalyptisme contemporain engagés en faveur du climat[59]. De fait, objet de pensée ambivalent, à la fois théorie scientifique et grand mythe romantique, le catastrophisme ne s’avère-t-il pas une forme désuète qui, au lieu de penser et panser la crise, promeut davantage l’immobilisme et une attitude d’attente passive vis-à-vis de la fin du monde ?
Bonnardot, Alfred, Fantaisies multicolores, Paris, Chez Castel libraire, 1859
Bonneuil, Christophe, Fressoz, Jean-Baptiste, L’Événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Paris, Seuil, 2013
Buffon, Georges-Louis Leclerc, de, « Époques de la nature » in Georges-Louis Leclerc de Buffon, Œuvres complètes de Buffon, Paris, Abel Ledoux, 1844, t. II, p. 71-184
Chakrabarty, Dipesh, « Le climat de l’histoire : quatre thèses », trad. de Charlotte Nordmann, Revue internationale des livres et des idées, janvier-février 2010, no 15, p. 22-31.
Crutzen, Paul, « Geology of Mankind », Nature, 3 janvier 2002, vol. 23, no 415, p. 23, https://doi.org/10.1038/415023a
Deneault, Alain, L’Économie de la nature, Montréal, Lux éditeur, 2019
Engélibert, Jean-Pierre, « La première apocalypse sans royaume : Le Dernier homme de Jean-Baptiste Cousin de Grainville », Licorne, no 129 « L’Apocalypse : une imagination politique », Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, p. 33-44
Flammarion, Camille, Astronomie populaire, Paris, Marpon et Flammarion, 1880
Flammarion, Camille, La Fin du monde, Ernest Flammarion, Paris, 1894
Fressoz, Jean-Baptiste, « Eugène Huzar et l’invention du catastrophisme technologique », Romantisme, 2010, vol. 4, no 150, p. 97-103
Fressoz, Jean-Baptiste, Locher, Fabien, « Le climat fragile de la modernité. Petite histoire climatique de la réflexivité environnementale », La Vie des idées, 20 avril 2010, URL : http://www.laviedesidees.fr/Le-climat-fragile-de-la-modernite.html
Fressoz, Jean-Baptiste, Locher, Fabien, Les Révoltes du ciel. Une histoire du changement climatique XVe-XXe siècle, Paris, Seuil, 2020
Fressoz, Jean-Baptiste, Louâpre, Muriel, « L’ère anthropocène : pour en finir avec la fin de l’histoire. Entretien avec Jean-Baptiste Fressoz », Écrire l’histoire, 2015, no 15, URL : http://journals.openedition.org/elh/589, https://doi.org/10.4000/elh.589
Grainville, Jean-Baptiste Cousin de, Le Dernier homme, Paris, Deterville, 1811
Huzar, Eugène, La Fin du monde par la science, Paris, Dentu, 1865 (3e éd)
Huzar, Eugène, La Fin du monde par la science, éd. J.-B. Fressoz et F. Jarrige, Paris, Ère, 2008
Kupiec, Anne, « L’énigme du Dernier Homme » in Le Dernier Homme, éd. A. Kupiec, Paris, Payot, 2010
Mercier-Faivre, Anne-Marie, Thoma, Chantal (dir.), Invention de la catastrophe au XVIIIe siècle : du châtiment divin au désastre naturel, Droz, Genève, 2008
Morin, Edgar, « Pour une crisologie », Communications, 2012, vol. 91, no 2, p. 135-152, https://doi.org/10.3917/commu.091.0135
Shellenberger, Michael, Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All, New York City, Harper Collins, 2020
Sukiennicka, Marta, « D’une découverte astronomique du futur : La Fin du monde de Camille Flammarion » in La découverte scientifique dans les arts, dir. A. Fayolle, Y. Ringuedé, Champs-sur-Marne, LISAA éditeur, 2018, p. 189-202
Sukiennicka, Marta, « L’apocalypse selon Eugène Huzar : entre les religions et la science » in Foi, croyance et incroyance au XIXesiècle, dir. A. Sadkowska-Fidala, T. Szymański, Wrocław, ATUT, 2019, p. 147-155

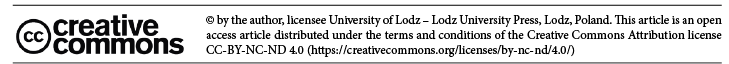
Received: 2021-11-02; Revised: 2022-02-07; Accepted: 2022-03-10.